Mis à jour le 26 janvier, 2021
Moonee a 6 ans et un sacré caractère.
Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents.
Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.
En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
Sean Baker s’était fait remarqué avec Tangerine, que nous avions découvert lors du festival américain de Deauville, un film ultra-pop, qui se distinguait par son fond, une caméra qui suit quelques unes des hautes figures d’un quartier de Los Angeles, très à la marge de la société -certains diraient des laissés-pour-compte ou des marginaux-, avec beaucoup de sympathie pour eux, mais aussi par sa forme: s’il dût exister un oscar pour le meilleur film de tous les temps tourné avec un iphone, Tangerine devrait assurément concourir.
Il n’est pas peu dire que nous étions donc impatients de voir ce que Sean Baker pourrait nous proposer lorsqu’il passerait à la caméra plus traditionnelle.
Les premières images, comme si souvent, donnent des indications qui ne cesseront de se confirmer au fur et à mesure du développement de cette histoire, douce amère, comme pouvait l’être Tangerine. La photographie édulcorée tient une place essentielle, tout comme les décors.
Nous sommes dans une amérique si réelle, si contemporaine, mais pourtant qui nous semble si fugace, si fabriquée. Zone d’activité commerciale où les constructions rivalisent de gigantisme, de néons, et peut-on le dire, de mauvais goût … Pourtant, tout cela mis ensemble, propose une composition photographique, pour celui qui y prête attention sous le bon angle – oblique pour mieux cerner la perspective-, non dénuée d’intérêt.
Sean Baker prend le parti du plan fixe, des couleurs pastels, et des allers retours incessants depuis et autour d’un collectif immobilier, pensé à première vue pour des touristes, mais où quelques habitants subsistent, jour après jour, semaine après semaine, en transit, dans l’attente d’un avenir qu’ils rêvent différent. Le décor ainsi proposé est assurément le premier des personnages de The florida project, son histoire, ce qu’il fait ressentir, l’animation qu’il en émane, la vie qui s’y organise.
A l’instar de Mustang, ou American Honey, le sujet central s’organise autour de l’élan de vie. Une résistance s’instaure contre un constat défaitiste qui considérerait que la situation présente sera la situation future, symbolisée très tôt par les chahuts d’enfants turbulents, dont les amusements ne sont pas du goût de tout le monde, et qui peuvent effectivement s’avérer inconséquents. Si le décor impose le cadre statique, les enfants forment eux le principal vecteur qui permet au spectateur d’observer, d’aller d’un bout à l’autre de ce quartier, d’aller d’un personnage à l’autre, d’une émotion à une autre, en somme, la structure dynamique. Ces deux choix formels vont ensuite permettre au réalisateur américain de poursuivre dans la direction déjà entrevue dans Tangerine, celle qui consiste à dresser un portrait de personnages en marge, d’une Amérique à la marge, sous un angle ostensiblement doux-amer qui se joue des a priori, pour mieux s’intéresser à ceux qui d’ordinaire n’intéressent que très peu.
L’entreprise peut se rapprocher de celle menée dans les 70 par quelques cinéastes italiens, qui s’intéressaient à la mutation des villes italiennes, à leurs frontières, à leurs habitants (Pasolini, ou Scola) et qui a sans nul doute inspiré cette année Matteo Garrone pour Dogman, autre film de lisière, de fossés.
Deux personnages forts nourrissent la dramaturgie. Une mère très passionnée peut-on dire, qui se moque des convenances, du qu’en dira-t-on, lutte contre l’enfer du quotidien. Très aimante envers sa fille, elle l’éduque de façon libre, loin des standards et modèles établis – quoi que Dolto n’aurait pas forcément renié ce modèle libre en soi. Elle se démène pour la nourrir, lui faire des cadeaux, la divertir.
Le divertissement est au centre même de sa pensée, la résistance passe par là. L’actrice Bria Vinaite propose ainsi une interprétation particulièrement intéressante de cette jeune femme dont on peut louer le courage, la liberté d’actions et de pensées comme blâmer l’insouciance, la vulgarité ou l’irresponsabilité. S’il vous faut une image supplémentaire pour vous faire une idée, pensez à Asia Argento.
L’autre personnage fort est interprété par Willem Defoe, très bon, dans un rôle intéressant, de gardien d’immeubles, gardien du temple, de la paix. Il doit en premier lieu assurer sa fonction, et il le fait avec professionnalisme. Il collecte les loyers, réclame les impayés, fait en sorte de maintenir la résidence en ordre, en marche, et il n’est pas peu dire que les habitants ne l’aident pas toujours à rendre les choses faciles, que ce soit les bêtises des enfants qui coupent l’électricité générale, les difficultés de certains des résidents à payer leur loyer, les mœurs limites, parfois dépravés de certains qui peuvent en heurter d’autres, mais aussi les personnages louches qui rôdent et s’invitent dans la résidence. Sa tâche est loin d’être aisée, et lui demande de faire preuve d’autorité. Il sera le méchant peut-on penser classiquement, si en tout cas il nous était donné à voir un drame social. Mais très vite, l’homme se découvre au delà de la fonction, non sans ambiguïté. Il pourra être perçu tel un guide, en quelques instants père de substitution, quand il se montrera compréhensif, tolérant , quand il ne jettera pas un regard trivialement accusateur mais choisira d’être aidant. Lui même, tout comme le spectateur observe le drame qui malgré tout se noue; son regard est le deuxième vecteur que nous propose Sean Baker pour mieux observer, penser.
The Florida project s’avère au final, même s’il n’est pas sans défaut – dans son rythme ou ses insistances notamment- ambitieux par son horizon artistique, et nous continuerons de suivre les prochains travaux (tableaux?) de Sean Baker.















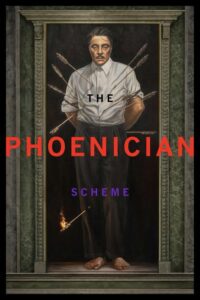


Soyez le premier a laisser un commentaire