Mis à jour le 22 août, 2019

Deux films en un

Partie I
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur « l’art dégénéré » organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre.
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu’il cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé.
Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…

Partie II
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin de leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. Accepté dans une prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est plus contraint aux diktats du « réalisme socialiste », Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu’à en repousser les limites. Mais la pratique de son art fait remonter en lui des souvenirs d’enfance longtemps enfouis qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur Seeband.
De très belles intentions
Diffusé en salle en deux parties, presque deux films qui se suivent mais proposent des intentions artistiques légèrement différentes, L’oeuvre sans auteur de Florian Henckel von Donnersmarck, est assurément un projet très ambitieux. Celui qui a connu la renommée internationale avec La Vie des autres et qui a commis The tourist a voulu frapper fort, tenter le come-back tonitruant, dans son pays, mais aussi, dans la mesure du possible, de façon plus universelle.
Il a opté pour un récit aux très hautes ambitions: tout à la fois narrer, en s’inscrivant dans les pas et les yeux d’un jeune enfant qui deviendra homme une histoire un peu oubliée des crimes des SS, rappeler l’Histoire de la division de l’Allemagne en deux pays; RFA et RDA, confronter l’apprentissage de l’art sous Hitler, sous le régime communiste est-allemand, avec la vision avant-gardiste, diamétralement opposée de l’école de Düsseldorf, mais aussi évoquer un drame personnel traumatisant et proposer une histoire d’amour simple et universelle.
Avant toute chose, il cherche à multiplier les portraits, celui de son héros et de son antagoniste, celui d’un pays, sous l’angle de la Grande Histoire, de la petite histoire, et de l’histoire de l’art, celui d’un artiste et de son rapport à l’art, celui d’un couple, celui des différents protagonistes qui traversent ces époques et ce récit.
La complexité consiste toute à la fois à trouver le bon équilibre entre ces différents portraits, mais aussi à les articuler les uns les autres, à assurer un liant naturel, le tout en ayant la contrainte temporelle du format acceptable pour passer dans les salles. Certains exploitants font le choix de diffuser une seule des deux parties du film, lors même qu’elles forment un tout manifeste, nonobstant qu’un accent légèrement différent soit mis sur l’art dans la seconde partie, plus exactement, que le tempo change.
Ces hautes ambitions si elles avaient toutes été atteintes, si tous les écueils liés à celles-ci avaient su être évités, feraient de L’oeuvre sans auteur assurément une oeuvre de haut rang, et son auteur n’en serait que plus reconnu. Notre sentiment a pu souvent varier lorsque nous avons découvert le film, certains passages nous ont semblé très réussis, quelques idées de mises en scènes ou au niveau du scénario nous ont semblé plus qu’intéressantes, quand d’autres points nous décevaient davantage. Commençons donc notre critique par ces quelques points négatifs avant de mettre en avant les éléments qui auraient du permettre à L’oeuvre sans auteur de repartir de la dernière Berlinale avec quelques récompenses et lui permettront peut être de glaner quelques Oscars.

Un habillage « académique »
Le défaut le plus évident du film, qui se remarque dés son prologue, vient de sa forme. Comme le défi de remonter le temps et les époques se montre de taille, Florian Henckel von Donnersmarck(HVD) opte très tôt pour des repères très marqués, pour que le parcours du spectateur soit, d’une certaine mesure, fléché. Nous saurons donc précisément, et tout au long du film, où et quand l’action se situe. Le récit en lui même étant de toute évidence très emmêlé, puisque l’on découvre plusieurs protagonistes en parallèle, le réalisateur allemand décide de ne pas brouiller les repères spatio-temporels. D’aucuns auraient pu imaginer un récit qui égarerait volontiers le spectateur comme s’y attacherait par exemple une forme chorale, pour mettre quelques uns de ses neurones en éveil. Ce parti-pris en soi, a fortiori, se comprend et peut même se justifier, d’autant que les liens entre personnages ne semblent de prime abord que fort peu évidents et l’effet de surprise, un peu plus tard dans la narration, fonctionnera lorsque ceux-ci seront amenés à être révélés. Ceci étant dit, tout cinéaste se confronte dans ses intentions artistiques à la question de la tonalité d’ensemble: le ton sur ton ou le contraste. Doit-il, dans la forme qu’il retient, aider le spectateur à comprendre, à ressentir les émotions des personnages ou au contraire, partir du principe qu’il raccrochera au fil, que son empathie lui permettra de ressentir avec les personnages ? Les moments de doute, de peur, de rupture, de fuite, mais aussi les plaisirs, les désirs, les communions sont ils à souligner par effet de mise en scène, à appuyer, ou bien au contraire, sont-ils à lire dans les yeux, les gestes ou à entendre dans les paroles des protagonistes ?
Si quelques images bien senties, quelques propositions de mise en scène composent effectivement des métaphores signifiantes – lorsque par exemple le tourbillon que forment les 2 corps enlacés du couple amoureux s’entremêle d’éléments narratifs d’un tout autre ordre -, HVD considère hélas la musique comme un élément essentiel de sa narration et non de son art … Une personne qui se contenterait d’écouter la musique du film pourrait sans trop de difficultés vous en résumer la dramaturgie … Pour ne rien vous cacher, nous eûmes ici apprécié qu’HVD élevât ses ambitions artistiques au niveau de celles de son projet d’ensemble; à notre sens, la forme académique retenue s’avère contre-productive: là où elle devrait permettre de mieux capter l’attention du spectateur, elle tend au contraire à la relâcher, ce qui, sur un film qui nécessite une forme longue, nuit nécessairement au rythme d’ensemble perçu.
La contrainte temporelle : les transitions trop soudaines
Au vu de l’ampleur des thèmes à traiter (la période nazie à Dresde, les premières années de l’Allemagne de l’Est, l’art à Dresde sous ces 2 périodes, puis à Düsseldorf au début des années 60), qui nécessite pour ne pas virer commun de s’arrêter quelque peu, le film ne pouvait raisonnablement pas tenir dans les très classiques 90 minutes si chers aux distributeurs et aux exploitants pour assurer des grilles de programmation bien carrées. Un format long, voire très long ne pouvait être que de mise et on s’étonne encore que le format série cinématographique n’ait pas été le format retenu: de la sorte, le réalisateur eut pu composer sans contrainte et retenir le rythme qui lui semblait le plus juste. Contrainte de production ou du réalisateur, peut être également pour pouvoir être sélectionné à la Berlinale, le format 3h10 -découpé en 2 longs métrages- aurait pu s’avérer bénéfique à l’écriture [écrire sous la contrainte parfois aide à se concentrer sur des éléments bien ciblés, le cadre proposé nourrit la créativité plus qu’il ne la bride]. Hélas, les nombreuses ellipses temporelles, les raccords parfois peu évidents ou trop brutaux, les transitions mal amenées les précédant ne vont pas dans ce sens; ici le format semble un cadre bien trop rigide ayant pour conséquence des coupes, des sacrifices de développement, de scènes dont on se dit qu’elles auraient été fort utiles.

Des personnages féminins au second plan
Parmi ses coupes, nous supposons que nombre d’entre elles concernent la personne d’Ellie Seeband interprétée par Paula Beer, tant cette dernière, pourtant esquissée dans ses premières apparitions, nous semble insuffisamment dégrossie. Sans tomber dans une quelconque caricature, ce portrait de femme dont le jeune artiste Kurt Barnert va s’éprendre, de façon fidèle et presque éternelle, et qui est sensé lui rappeler sa tante, Elisabeth May, autre personnage féminin central de l’histoire, s’arrête complètement en chemin: nous ne serons d’elle que deux ou trois choses: amoureuse, passionnée de mode, elle craint son père. Pourtant, qu’il eut été pertinent de développer ce personnage qui offrait idéalement un regard oblique sur les deux personnages masculins centraux, qu’il eut même été pertinent de développer ses traits de ressemblances avec Elisabeth May, et peut être même de pousser le vice jusqu’à offrir le rôle à une seule et unique actrice.

Si le portrait d’Elisabeth May est dans la première partie du film plutôt adroitement dessiné; nous savons ce qu’elle pense, ce en quoi elle croît, pour qui elle vibre, mais aussi ses valeurs, si nous pensons même par un jeu de fausse piste plutôt adroit qu’elle sera l’héroïne centrale du récit – son histoire le sera, mais pas elle -; le très peu de développement de la psychologie de son double choque d’autant plus que par ailleurs le réalisateur fait le choix de mettre en avant sa sensualité, dans des scènes de nues qui, se multipliant, semblent bien plus superflues que nécessaires.

Le bon et le méchant, improbable rencontre
A n’en pas pas douter, outre ses thématiques historiques, resserrées sur l’Allemagne entre 1933 et 1960, les fenêtres par lesquelles celles-ci sont narrées (l’histoire dans l’histoire), un point fondateur à L’oeuvre sans auteur relève probablement de la confrontation entre deux protagonistes masculins centraux. L’un pourra être assimilé au bon, notre héros Kurt Barnert , quand l’autre, son adversaire, le professeur Karl Seeband, interprété par Sebastian Koch, sera le méchant. L’originalité vient ici sur deux plans.
Le premier tient de l’intensité des personnages. Le « méchant » ne tarde que peu à montrer sa « méchanceté ». Celle-ci, après une première hésitation qui introduit un léger suspense – le sort de notre première héroïne lui étant dévolu d’emblée – ne fera presque plus aucun doute tout au long du film. Même si quelques rapides fausses pistes semblent vouloir nous dire qu’à contexte différent son comportement pourrait être autre, elles sont très vites lavées: l’homme agit en permanence par intérêt personnel, par calcul, en son âme et conscience, recherche la gloire et la reconnaissance. Notre méchant est donc très méchant, mais qu’en est-il du héros, du bon ? Étrangement, ce dernier présente une caractéristique assez contraire aux héros habituels … Son effacement permanent. Quoi qu’éduqué par sa tante Elisabeth à ne jamais baisser les yeux, cette maxime ne sera réellement vérifiée dans le récit que face à la gêne que peut présenter la nudité d’une femme, bien plus que face aux situations désagréables, que, dans l’ensemble, il fuira. Car notre héros, discret de nature, ne brille pas par son courage, ou son ambition. Il traverse les époques. Ses convictions ont beau être à l’opposé de celles véhiculées, imposées, que ce soit par les autorités (Le Reich, les autorités communistes) ou les hauts-représentants (les professeurs d’art), jamais notre héros ne relaiera un quelconque esprit de rébellion, de révolte. Bien au contraire, sans faire trop de zèle, il entre dans une certaine acceptation, dans un certain fatalisme, qui lui ferait presque oublier ses aspirations premières. Le scénario se charge de faire en sorte que son destin le rattrape, mais très rarement celui-ci ne sera provoqué, à quelques exceptions prêt – le choix de sa compagne et le choix de partir à Düsseldorf seront probablement ses deux seules réelles décisions. Kurt Barnert présente certes quelques vertus bien utiles à nous le rendre attachant, sa loyauté, sa relative détermination, ses dons artistiques [considérés comme tels par tous les protagonistes, énoncée comme vérité indéfectible, et mis maladroitement en évidence par une capacité à très jeune dessiner une femme nue], et surtout son sentimentalisme; il n’en reste pas moins un héros particulièrement faible. S’il est possible d’y noter un point de vue moral d’HVD, un goût pour le politiquement correct, ou une aversion pour le héros fort [ qui présente sur le plan psychologique des similitudes avec son adversaire], il semble bien que ce choix du caractère faible trouve ses raisons dans les intentions réalistes: pour traverser ces époques, y survivre, l’effacement, la discrétion, le renoncement sont les seules voies pour qui ne cherche pas à collaborer, quand l’affirmation d’idées personnelles et, en ceci, considérées dangereuses mène à une condamnation inéluctable. Ainsi notre première héroïne sera précisément victime de sa force de caractère.

Le second plan d’originalité que nous réserve le scénario, quant à la confrontation héros/adversaire, tient à ce que cette rencontre soit non seulement retardée – notre héros n’apparaît réellement qu’au deuxième tiers du récit, lorsqu’il devient adolescent, son adversaire est lui introduit un peu plus tôt et réapparaît en même temps que naît réellement à l’écran Kurt Barnert, adolescent orphelin de sa tante- mais aussi et surtout à ce que cette rencontre tient du miracle, ou plus exactement du cauchemar très improbable. Ficelle scénaristique évidente mais obligatoire pour lier les différentes thématiques, la difficulté revient à la masquer; à en taire les intentions, à surprendre le spectateur, pour que la dramaturgie en soit renforcée sans que l’apparat réaliste n’en soit lésé. Ce challenge s’avère uniquement partiellement relevé de notre point de vue, précisément car l’introduction de l’adversaire, si marquée, ne laissait aucun doute sur le fait qu’il devait réapparaître sous une forme ou une autre dans la vie de notre héros …

La petite histoire oubliée par laquelle rappeler la Grande
De la même façon que Benoît Jacquot, par exemple, nous narrait intelligemment Marie-Antoinette de biais dans Les adieux à la reine, ou pour l’auto-référencer, HVD nous narrait la Stasi à travers le métier de son héros dans La vie des autres, il choisit cette fois-ci, et l’idée est très bonne, de s’intéresser à un détail de l’Histoire, puis à ses conséquences par le prisme du traumatisme pour traverser les différentes époques dont le film souhaite se faire l’écho. Il s’agira de s’intéresser au triste sort réservé aux personnes considérées mentalement non pures/saines sous le régime nazi, à un cas particulier d’une jeune fille présentant pour certains des signes de schizophrénie, pour d’autres des signes d’intelligence, d’éveil à l’art ou de conscience à l’art, doublé d’une fantaisie et d’un anticonformisme, puis, dans un second temps, aux répercussions traumatiques (mais aussi à la poursuite de son idéal) de sa disparition pour sa famille, et en premier chef, son neveu qu’elle éduquait et qui nourrissait pour elle une véritable fascination.
Le fait n’est pas si connu, et mérite assurément d’être mis en lumière. Le régime nazi, dans sa logique d’épuration de la race, s’en prenait aux Juifs, aux tsiganes, aux personnes souffrant de troubles génétiques (trisomiques 21, …) notamment, nous le savions tous, mais il s’attaquait également aux personnes souffrant d’une maladie psychiatrique. Dit autrement, il était possible pour un psychiatre de décider de la vie ou de la mort d’une personne qu’il jugeait, lui, sur des critères non déterminés (quand on sait que la frontière entre maladie psychiatrique développée et bonne santé malade est très mince, et que bien souvent les hyper névrosés sont bien plus dangereux pour la société que ne peuvent l’être les psychotiques, cela rajoute de la perversion à l’atrocité première qui consiste à éradiquer une population toute entière sur la base d’un critère de race). Porter ce détail à l’écran a valeur de mémoire, et il s’agit là d’une entreprise intéressante.
A moindre titre, il est intéressant également de mentionner l’intérêt de convier l’enseignement de l’art, à 3 époques et dans 3 contextes historiques différents. Si le traitement qui en est fait s’avère au final assez caricatural, la critique qui en ressort est intéressante; peu importe l’époque, les écoles d’art partent du principe que l’art qui les ont précédé n’était pas de l’art. Au sein des écoles, des interdits s’érigent, des codes sont à respecter, et enseignants comme élèves se font les apôtres fidèles, et parfois de façon très dictatoriales, c’est à dire sans aucune place pour la contestation, de ses mouvements de pensées, de ses règles. Si la pensée avant-gardiste de l’école de Düsseldorf est ainsi légèrement épargnée, elle n’en reste pas moins critiquée.

Une belle intrigue, maîtrisée et épique
Le résultat formel de L’oeuvre sans auteur, au delà de toutes considérations analytiques trop poussées, est un film qui propose deux parties bien distinctes, la première comporte un souffle épique indéniable, bien aidée par son introduction en matière, la force du personnage féminin décrit – celui d’Elisabeth May-, son anticonformisme, sa liberté d’agir et de pensées, ses goûts pour la vie et l’art, puis par le développement d’une histoire tragique avec des composantes psychologiques et sociologiques. Le spectateur y trouve une matière à rester captif, à divertissement mais aussi, parce que le récit comporte des rebondissements dramatiques, à s’émouvoir du sort réservé au héros, et surtout à s’intéresser à son devenir. L’intrigue, fut-elle académique et prévisible, n’en reste pas moins maîtrisée et donc valable.

L’art au centre du récit
La seconde partie du film donne à voir un tout autre développement. Si le fil conducteur reste suivi, si les nœuds dramatiques, et notamment la question du traumatisme restent au centre des intentions, trois nouvelles composantes viennent s’insérer, au point de proposer une bascule formelle. La première de cette composante est celle de la construction d’un homme, qui trouvant sa voie, par hasard ou détermination, passera par différents stades. Ce traitement, sans être mauvais, ne comporte pas de relief particulier, comme évoqué précédemment, par faute d’un charisme bancal. La seconde composante qui en est un corollaire, concerne la construction d’une histoire d’amour, l’installation dans la société, mais aussi l’évolution artistique. La place qui est réservée à ce développement nous semble ici bien trop faible, et plutôt qu’un développement, le film nous donne à voir des raccourcis brutaux et triviaux. La troisième composante, et sur laquelle le réalisateur a contrario s’attarde, concerne le rapport à l’art. Il prend ici des risques, notamment car le style du film change, laissant la place à des scènes plus étirées, où l’action s’efface au profit de la précision du geste, de la pensée. Sans s’aventurer dans un hommage ou dans une réflexion cinématographique – notamment les mises en abyme d’un cinéaste peintre narrant l’art d’un peintre, ou le scan du processus de création d’une oeuvre; le titre du film en eut été assurément changé- sans non plus se risquer à un cinéma peinture ou à un cinéma vérité (nous sommes très loin de l’entreprise de Rivette avec la belle noiseuse par exemple, ou plus récemment celle de Doillon avec Rodin), notons le mérite d’HVD de proposer sa vision personnelle de l’art, de son enseignement,et de prendre son temps. Si, comme nous l’avons déjà évoqué, cette vision n’est pas sans raccourcis, sans parti-pris critiquables, la réflexion proposée tient la route, le traitement qui lui est appliqué comprend quelques très beaux instants et rappelle l’ambition d’ensemble.

Il convient de souligner que la place centrale réservée à l’art tient de l’intention originelle d’HVD. Celui-ci a été fortement marqué par sa visite, à l’âge de dix ans, de l’exposition avant-gardiste « Zeitgeist » au Martin Gropius Bau de Berlin. Son goût pour l’art y fut alors renforcé par sa découverte de l’oeuvre du peintre allemand Gehrard Richter, qui a inspiré le personnage Kurt Barnert. Le titre même du film provient de l’oeuvre de Gehrard Richter, dont certains critiques de peinture eurent à dire qu’elle n’avait pas de point de vue, que le peintre créait machinalement en excluant toute matière biographique.

Le développement de ce point de vue sur l’art, s’il paraissait quelque peu improbable passé le premier long métrage, fait en fait écho à l’ouverture du film, réussie. Outre le goût d’Elisabeth May, et son enseignement du dessin au tout jeune Kurt Barnert, une scène y marque: la visite d’une exposition « l’art dégénéré ». On y retrouve, entre autres, des peintures de Picasso ou Chagall, considérés comme « malades » par le régime nazi qui interdît l’art moderne pour imposer un art officiel. Cette exposition, inaugurée à Munich en 1937, a voyagé à traversé l’Allemagne et l’Autriche et a réuni 3 millions de visiteurs. La reconstitution de cette manifestation ne fut pas sans encombres pour HVD et l’équipe du film… Certaines œuvres, depuis détruites, comme Les Invalides de guerre d’Otto Dix, ont été reproduites d’après des photos et en collaboration avec les archives des artistes en question.

Un film ambitieux, bancal mais recommandable
Au final, L’oeuvre sans auteur cumule les très bons points mais aussi les défauts que l’on retrouve en général chez de jeunes auteurs trop fougueux, insuffisamment concentrés sur leurs sujets et qui se dispersent. Son ambition est fort louable, le mélange de genre tenté en lui même à lui seul mérite d’être souligné, tout comme la force des différents thèmes brassés, mais s’il fallait ne retenir qu’une seule raison pour vous encourager à le découvrir, nous retiendrions, au final, qu’une ambition plus simple, celle d’un réalisateur qui vous parle de peinture, et qui au travers de son héros, vous parle très probablement de lui.







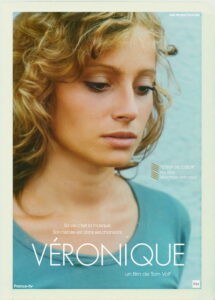


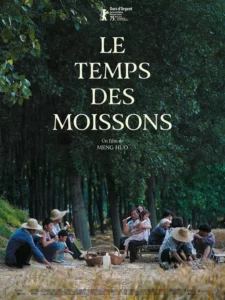
Soyez le premier a laisser un commentaire