Mis à jour le 29 janvier, 2017
Le pitch : Kat Connors (Shailene Woodley) a 17 ans lorsque sa mère (Eva Green) disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…
Il a été proposé à Gregg Araki l’adaptation de White bird in blizzard (Un oiseau blanc dans le brouillard) de Laura Kasishke et il l’a acceptée. Ce choix ainsi que la manière dont la manière dont il a adapté le roman sur grand écran a eu de quoi étonner. Surtout pour le public français pour qui Araki = Kaboom et basta. Pourtant, il l’affirme haut et fort : c’est son film le plus personnel. D’ailleurs quand il est venu nous présenter son film à Deauville, il était tout autre que le post-adolescent autoproclamé de 51 ans (!) que nous avions vu 3 ans avant, pour la présentation de Kaboom, justement. A ce moment là, nous lui avions demandé quand et où s’arrête l’adolescence, non seulement en raison de son obsession de de cette thématique et de sa volonté, un peu comme Larry Clark, d’en être un (d’adolescent) tout autant, oui même à 51 ans. En attestaient le débardeur loose branchouille et les pecs sculptés qu’il arborait à l’époque.
Cette année 2014, Gregg Araki a affirmé son entrée dans l’âge adulte (à 54 ans !), en chemise à manches courtes et cravate. « Vous savez, les gens changent, je n’ai plus l’immaturité ni la vision que j’avais à l’époque de The doom generation où j’avais juste envie de faire un gros doigt d’honneur au système. »

Il est des raisons proclamées et évidentes de l’aspect personnel pour Araki de White bird in a blizzard : il a légèrement décalé l’époque du film pour la caler sur l’époque de son adolescence, et la musique (toujours capitale et parfaite dans ses films) y est pour beaucoup, nous immergeant, façon madeleine de Proust, sur les traces de cette parcelle de vie vécue. Il entend faire un film à la American Beauty (sic) : montrer l’horreur du rêve américain des classes aisées vivant dans les zones pavillonnaires. Le reste du « personnel » est plus difficile à deviner ou à connaître : il ne nous en a pas plus dit. Donc on ne peut que juste imaginer que Eve (le personnage principal) c’est lui.
Venons en à l’oeuvre en elle-même. Gregg Araki choisit un sujet « sérieux » sinon « grave », mais en ajoutant sa petite patte personnelle : acteurs qui n’ont pas l’âge de leurs personnages (des adultes qui interprètent des ados et une jeune femme interprétant un quadra), des personnages queers qui n’existaient pas dans le roman, un côté clinquant qui est son talent : l’amour des couleurs, des formes, jusqu’à celle des gâteaux, une « plastique » cinématographique qui n’appartient qu’à lui-même. Il se permet même de changer la fin, dans un twist complètement kaboomesque, qui a cueilli la salle, riant et applaudissant d’un tel revirement.
La patte Araki fait les points forts et les points faibles du films. Jamais Eva Green n’avait eu un si beau rôle : bluffante, extrême, hantée par des spectres du cinéma qui défilent, de manière subliminale, sous nos yeux : Liz Taylor dans Qui a peur de Virginia Wolf ?, Bette Davis dans Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?… Elle est pathétique au bon sens du terme, faisant de son personnage l’un des plus beaux du film -ce qui n’était pas gagné, si on s’en tient juste au personnage du roman. Le film n’est pas glaçant et intense comme l’était Under the skin, pour la raison qu’Araki prend moins le sujet -fictionnel- au sérieux. C’est pourquoi des instants cruciaux et bouleversants se muent en second degré comique, court-circuitant les intentions qu’avaient Laura Kasishke. Pour autant, le film n’est pas une grosse marade défoulatoire et irrévérencieuse comme Kaboom. Il est plus pudique (pour du Araki) : un vocabulaire cru, une paire de seins entrevue, des situations comico-scabreuses qui déçoivent le public français qui en voudrait plus, mais choque le prude public américain (dixit le réalisateur lui-même). White bird se situe exactement au milieu de ces deux extrêmes de sa filmographie.
Il n’en demeure pas moins que White bird est à voir absolument : c’est un excellent film, l’un des meilleurs de l’année à notre goût, mais qui laisse justement un arrière-goût de regret quand on sait, que si Araki ne s’était pas laissé aller à ses défauts, il aurait pu donner un poignant chef-d’oeuvre.











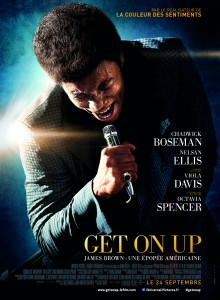



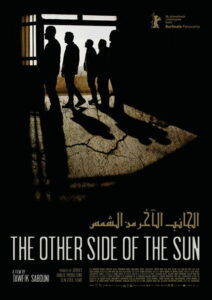
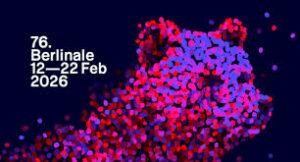


Soyez le premier a laisser un commentaire