Il y a deux ans, Le Mag Cinéma fêtait Halloween en vous proposant un montage d’extraits de ses films d’horreur préférés.
https://www.youtube.com/watch?v=b-CaymmdhcA
Quelques jours avant de célébrer le retour des morts et autres goules putréfiées, votre revue revient sur quelques œuvres horrifiques connues et moins connues, plus ou moins bien considérées mais dont la vision saura à coup sûr vous glacer le sang et vous permettre de profiter dignement de cette étrange soirée.
Psychose 2 – Un retour réussi
Si lors de sa sortie en 1983, Psychose 2 (Psycho II) fut un véritable succès au box-office américain, peu de spectateurs français ont gardé grand souvenir de ce film. Difficile en effet d’imaginer une suite au chef-d’œuvre matriciel d’Alfred Hitchcock, qui apparaît sur bien des points comme un modèle indépassable. Grossière erreur, car la version de Richard Franklin tient assez bien la comparaison avec celle du maître du suspense. Le principal intérêt de cette suite réside dans l’emploi particulièrement significatif de la maison des Bates. La plongée personnifie l’étrange manoir, tandis que la caméra s’infiltre à l’intérieur des chambres et propose au spectateur une visite guidée extrêmement détaillée des lieux. Le jeu d’Anthony Perkins n’a quant à lui rien perdu de son malaise d’antan. En psychotique plus ou moins guéri, l’acteur retrouve l’ambiguïté d’un rôle qui aura eu raison de l’ensemble de sa carrière (trois ans plus tard, il passera derrière la caméra pour Psychose 3). Autre qualité de la version de Franklin : faire de son original une espèce de souvenir aux réminiscences visuelles. La séquence de la douche qui ouvre le film se prolonge à travers la couleur, tandis que tel mouvement d’appareil ou telle position de la caméra renverra à une image du précédent film. Un rappel heureusement jamais appuyé mais qui fera toujours écho dans l’esprit du spectateur, un peu à la manière d’un rêve dont on ne saisit plus très bien les contours sans pour autant avoir oublié sa saveur. On soulignera aussi l’intelligence du scénario de Tom Holland qui maintient (presque) jusqu’au bout une incertitude propice aux hypothèses les plus maladives.
Le fantôme de Milburn – Atmosphère, atmosphère
La distribution du Fantôme de Milburn (Ghost Story, 1981) a de quoi surprendre n’importe quel cinéphile averti. Fred Astaire, Melvyn Douglas, John Houseman et Douglas Fairbanks Jr. en vieux messieurs au charme désuet friands d’histoires d’horreur, vont progressivement subir les attaques d’une fantôme revancharde. Du côté de la fiche technique, ce n’est pas mal non plus, puisque aux côtés du réalisateur John Irvin, on trouve le chef-opérateur Jack Cardiff connu pour son travail sur Les Chaussons rouges (The Red Shoes, Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948), Le Narcisse noir (Black Narcissus, Michael Powell et Emeric Pressburger, 1947), La Comtesse aux pieds nus (Joseph L. Mankiewicz, 1954), ou encore Pandora (Albert Lewin, 1951), excusez du peu !
Spécialiste du Technicolor, le film profite de l’excellence de Cardiff pour les couleurs chaudes. Les intérieurs contrastent ainsi parfaitement avec l’atmosphère polaire du dehors. La neige recouvrant le sol confère aux plans d’extérieurs une texture désaturée qui convoque tout à la fois la cristallisation du souvenir et l’impossibilité de recouvrir totalement les traumas du passé. Le scénario de Lawrence D. Cohen – adapté du roman de Peter Straub, publié en 1979 – demeure assez classique dans son fond mais voit sa structure retravaillée par les éclats formels du film. Ainsi de la bande-musicale composée par Philippe Sarde qui, accompagnant les images de Irvin et Cardiff, confère au métrage une certaine langueur mélancolique souvent proche de l’onirisme que l’on retrouve par ailleurs à travers les interprétations contenues mais tout à fait sensibles des acteurs. On retiendra par exemple les yeux embués de larmes de Astaire, se résignant difficilement à accepter un destin auquel ses démons du passé ne cesseront de l’aliéner.
Arsenic et vieilles dentelles – Mourir… de rire
Pour Michel Cieutat : « Arsenic et vieilles dentelles n’est pas un film de Capra. » (Frank Capra, Rivages, 1988, p. 181). Difficile en effet de retrouver quelques traces du style du célèbre réalisateur hollywoodien dans ce film qui se rapproche d’une pièce de théâtre filmée. On découvre néanmoins certains traits burlesques qui peuvent renvoyer aux années de formation de Capra au sein des studios Hal Roach. Ceux-ci apparaissent pleinement à travers le jeu très expressif de Cary Grant qui s’en donne à pleine joie, jouant des postures désarticulées, des double-take dilatés, et de plusieurs regards-caméra particulièrement détonants. La pièce de Joseph Kesserling dont le film est adapté offre de nombreux rebondissements qui sauront surprendre et amuser le spectateur. Ce récit narrant la découverte par un critique littéraire de la nature criminelles de ses gentilles tantes, vieilles dames affables s’il en est, provoque le rire et (parfois) l’effroi. On se rappellera de cette séquence où trois personnages cherchent à enterrer dans la même tombe deux cadavres différents et qui se propose comme un joli exercice de mise en scène où l’ombre du fantastique l’emporte sur l’éclairage high-key de la comédie (photographie signée Sol Polito). Cette hybridation générique associée à la distance affirmée de Capra vis-à-vis de son sujet lui permet même de subvertir certaines de ses thématiques les plus chères, révélant en cela un autre pan de son identité artistique. Remarquons par ailleurs la présence de Peter Lorre qui retrouve ici l’identité angoissée de son rôle de criminel de M, le Maudit, jouant de son accent prononcé et de son regard meurtri pour appuyer le contre-emploi du genre auquel il se voit ici assigné.
Épouvante sur New York – Godzilla dans la grosse pomme
On passera sous silence le scénario improbable de ce film de monstres, mais on soulignera tout de même le soin apporté à la caractérisation de certains personnages. Ainsi de Jimmy Quinn (Michael Moriarty), criminel à la petite semaine dont les ambitions démesurées viendront se heurter à son sens du devoir et à ses responsabilités de citoyen.
Mis en scène par Larry Cohen, spécialiste des films de genre à petits budgets, Épouvante sur New York (Q, 1982) profite grandement de l’expérience de son réalisateur. La piètre qualité des effets spéciaux en stop-motion est en effet rattrapée par le grand réalisme des scènes de rue. Tout à fait l’aise en extérieurs, Cohen filme New York à la manière d’un documentaire. En résulte certains moments tout à fait réussis comme lorsque le sang d’une des victimes du mystérieux serpent ailé vient s’écouler sur des passants affolés. Je songe aussi à ces instants qui s’échappent du contexte narratif pour n’apparaître que comme des témoignages d’un quotidien urbain. La musique free-jazz accompagnant ces scènes confère au film une valeur expérimental. Le style de Cohen se rapproche alors des premiers Cassavetes.
Evil Dead 3 – Les Monthy Python au pays de George Romero
Evil Dead 2 (1987) se présentait, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Andrevon, comme « un essai transformé » du premier opus réalisé par Sam Raimi en 1981 (100 ans et plus de cinéma et de science-fiction, Rouge Profond, 2013, p. 317). Evil Dead 3 : L’Armée des ténèbres (Evil Dead 3 : Army of Darkness, 1992) s’éloigne quant à lui considérablement de son modèle d’origine. Le futur réalisateur de la franchise des Spider Man entraîne Ash (Bruce Campbell), son héros, dans l’univers sombre du Moyen Âge. Armé de son bras-tronçonneuse, celui-ci devra mettre la main sur le fameux Necronomicon et combattre les forces du Mal bien décidées à en finir avec lui. Ouvertement tourné vers la comédie – actualisant en cela l’humour moins visible mais pourtant bien présent des précédents épisodes – Evil Dead 3 se divise entre remarques cinglantes et séquences de haut-vol. Ainsi de ce miroir brisé duquel s’échapperont des dizaines de petits Ash, venant piquer l’arrière-train du héros et l’ébouillanter de l’intérieur.
Les squelettes sortis de terre font sans doute référence à ceux conçus par Ray Harryhausen pour Jason et les Argonautes (Jason and the Argonauts, Don Chaffey, 1963), tandis que l’excentricité de Bruce Campbell rappelle celle des animaux de Tex Avery. Caricaturale, le film de Raimi n’oublie pas pour autant de mener à bien son récit, s’éloignant en cela des futures franchises parodiques qui, une fois leurs références ôtées, n’ont plus grand chose à offrir à leur public. Sorte de Sacré Graal au pays de La Nuit des morts-vivants, Evil Dead 3 clôture d’une très belle manière l’une des sagas horrifiques les plus singulières de l’histoire du cinéma.
Angoisse – Au défi du cadrage
Parmi les cinématographies européennes dont l’histoire mériterait d’être redécouverte, l’Espagne occupe l’une des premières places. Et, en matière de fantastique, le cinéma ibérique se pose là. Des fantasmagories de Segundo de Chomon aux comédies horrifiques d’Alex de la Iglesia en passant par l’œuvre monumentale de Jesus Franco, il n’est pas difficile de rencontrer l’insolite à l’intérieur de cette filmographie prolifique. En apparence, pourtant, Angoisse (Angustia, Bigas Luna, 1987) n’a d’espagnol que le nom de son réalisateur. Si l’on se penche du côté de la distribution, on trouve en effet le nom de Zelda Rubinstein (principalement connue pour son rôle de médium dans le Poltergeist [1982] de Tobe Hooper) et celui de Michael Lenner dont le visage rond et l’allure bonhomme entraperçus dans l’une de ses quelques cent-cinquante apparitions sur le grand ou le petit écran n’a pu laisser le spectateur insensible. C’est en effet l’Amérique que Bigas Luna souhaite filmer, une Amérique fantasmée, rêvée, et dont les limites correspondent à celles d’un cinéma de quartier.
Sorte de version ténébreuse de Sherlock Junior (Buster Keaton, 1924) les rapports tissés par le film dans le film d’Angoisse structure l’ensemble du long métrage. À la relation hypnotique partagée par le fils sociopathe et sa mère dominatrice répond le rapport réunissant le monde de l’écran et celui de la salle. Si le raccord conditionne d’abord le dialogue entretenu par les deux espace-temps, la fusion finit par être totale. L’obsession du tueur pour les yeux de ses victimes dépasse alors le seul cadre de la fiction pour incarner un motif formel qui s’intègre au discours du réalisateur. Il faut voir, et bien voir pour comprendre ce qui se joue ici. En toute logique, le dénouement prendra lieu face à l’écran, le champ-contrechamp dénonçant la matérialité de celui-ci pour lui substituer la valeur d’un espace de passage, propice à la traversée des mondes. L’ultime niveau de lecture se situe donc du côté de notre propre réalité, si réalité il y a, bien sûr.
Quelques années avant la sortie du pirandellien Freddy sort de la nuit (New Nightmare, Wes Craven, 1994), Angoisse affirme la possibilité de réfléchir les qualités d’un médium pour lequel les frontières entre le cauchemar et le réel n’ont jamais été aussi poreuses.
Le Cercle Infernal – Angoisse maternelle
Le mouvement de caméra sur les immeubles londoniens ouvrant le film rappelle celui du Locataire (1976), tandis que la coupe garçonne de Mia Farrow et l’identité névrosée de son personnage renvoient à son rôle de mère tourmentée dans Rosemary’s Baby (1968). C’est dire si les références du Cercle Infernal (Full Circle, 1977) sont polanskiennes ! Le film du britannique Richard Loncraine peine pourtant souvent à atteindre le niveau de ses modèles. Si la musique de Colin Towns et la photographie vaporeuse de Peter Hannan convoquent une certaine léthargie propice à l’enclenchement de l’horreur, celle-ci tarde souvent à apparaître. Un choix de mise en scène dont souffre quelque peu le rythme du film, ainsi que l’espace fermé du huis-clos qui perd quelque chose de son atmosphère angoissante et hallucinatoire. On gardera pourtant à l’esprit certaines scènes de haut-vol, comme celle voyant le visage de Mia Farrow caressé par la main d’un enfant dans la pénombre d’une chambre, ou encore le moment où se résout le conflit de l’humaine et du fantôme à travers un pacte d’adoption à la douceur sanglante. On regrettera néanmoins que le scénario de Harry Bromley Davenport, adapté du roman de Peter Straub, ait trop souvent privilégié l’évocation orale sur la forme visuelle tant le récit pouvait se faire matière à certaines représentations particulièrement malaisantes.
Le Mort-vivant – Retour à la terre
Bob Clark est sans nul doute l’un des cinéastes dont l’œuvre mérite le plus d’être reconsidérée à sa juste valeur. Si sa filmographie contient un certain nombre de films alimentaires, la décennie soixante-dix fut particulièrement fructueuse pour lui, puisque la même année de 1974 sortirent deux films qui, bien que peu connus, apparaissent aujourd’hui comme deux incontournables du cinéma d’horreur (rappelons par ailleurs qu’en 1979, Clark signera avec Meurtre par décret [Murders by Decree] l’une des meilleurs adaptations à mon sens des aventures de Sherlock Holmes). Alors que Black Christmas anticipe sur la future vague du slasher officiellement inaugurée en 1978 par le Halloween de John Carpenter, Le Mort-vivant (Dead of Night) offre une variation tout à fait saisissante atour de la figure du zombie.
Le film de Clark raconte l’histoire d’une Amérique à l’intérieur de laquelle les pères ne reconnaissent plus leurs fils. Revenu du Vietnam, le jeune Andy Brooks (Richard Backus) n’est pas le héros de guerre escompté, mais un laissé pour compte ravagé par un appétit de chair fraîche. Mort pour la nation, le soldat veut à présent se repaître de son sang. La fracture est ici essentielle et s’oppose de manière bienvenue aux récits fédérateurs et à l’esprit conservateur des récentes productions horrifiques (Conjuring ; Dans le noir).
De façon tout à fait intéressante, le scénario de Alan Ormsby décale les perspectives habituelles pour favoriser la perception de Charles (John Marley), le père d’Andy. D’abord déçu par le comportement de son fils, puis terrorisé par ses actes criminels, Charles ne peut se résoudre à le dénoncer aux autorités. La tragédie décrite par Le Mort-vivant dépasse alors le cadre du genre pour s’orienter vers un discours hautement contestataire. La valeur contextuelle du film, prenant par instant certains accents existentiels, en fait le pendant horrifique des Visiteurs (The Visitors, 1972) d’Elia Kazan ou du Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter, 1978) de Michael Cimino. Sorti deux ans avant la fin du conflit, les images de ce soldat totalement déphasé avec sa vie passée ne pouvait qu’interpeller le public de l’époque. Sous couvert de son argument fantastique, Bob Clark insiste sur les dégâts causés par la guerre sur l’esprit des jeunes recrues. Par le biais du montage parallèle, le réalisateur oppose les clichés photographiques de l’album de famille à la réalité transfigurée du présent. Le zombie décrit par le cinéaste n’est pas celui de La Nuit des morts-vivants (Nights of the Living Dead, 1968) de George Romero, son errance affleure à peine la surface du sensible mais privilégie plutôt la rupture morale, sinon spirituelle, du protagoniste. Progressivement contaminé par une purulence létale (magnifique maquillage signé par le célèbre Tom Savini), le zombie se refuse à continuer le combat et préfère retourner à la terre. La tombe n’apparaît plus alors que comme un espace de quiétude salvatrice, éloignée des turbulences du monde des vivants.
Pour les lecteurs soucieux de parfaire leurs connaissances en matière de cinéma fantastique, on ne peut que leur conseiller de se reporter à la lecture du monumental 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, encyclopédie passionnée et érudite dirigée par le prolixe Jean-Pierre Andrevon et superbement mis en page par l’excellente maison d’édition Rouge Profond.


















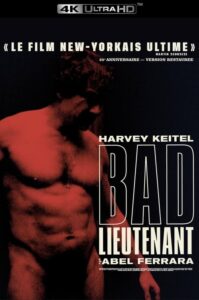




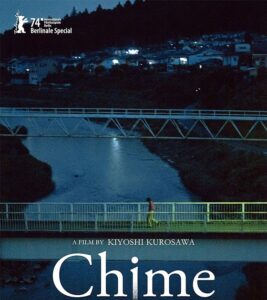
Soyez le premier a laisser un commentaire