Mis à jour le 29 mai, 2016
En quoi un américain se différencie-t-il d’un soviétique ? Dans les années cinquante la question devient prégnante et alerte l’ensemble de la population américaine. La paranoïa généralisée de la guerre froide réactive la problématique de l’altérité mais la complexifie en atténuant ses traits au profit d’un conflit plus intérieur. Potentiellement, tout individu peut être un espion vendu à la solde du communisme : parent, professeur, médecin, personnalité artistique ou même politique, personne n’est à l’abri du soupçon. Hollywood profitera de ce climat pour lancer des séries de films où la propagande se dissimule derrière l’innocence du divertissement. La science-fiction est peut être le genre qui sut le plus profiter de cette période trouble, en dénote l’explosion quantitative des films produits à l’époque. Pas difficile de reconnaitre derrière l’invasion des petits hommes verts le présage d’une menace bien terrienne. À l’infini du cosmos répondent les frontières idéologiques du globe terrestre. Parmi ce corpus abondant de films, il n’est pas aisée de trouver une production de qualité. À force de recherches, le cinéphile pourra pourtant dénicher quelques perles parmi lesquelles le désormais classique L’invasion des profanateurs de sépultures (Invasion of the Body Snatchers, 1956). Produit par Walter Wanger, L’invasion des profanateurs de sépultures restera le seul film de science-fiction jamais réalisé par le prolifique Donald Siegel (plus connu sous le diminutif de Don Siegel). Plutôt habitué aux thrillers, le cinéaste profite du scénario de Daniel Mainwaring pour s’éloigner du carcan imposé par le genre et signe une œuvre hybride et novatrice. Si les critiques et historiens ont souvent souligné le travail d’écriture de Daniel Mainwaring aux dépens de la mise en scène de Siegel, la ressortie en salles cette semaine de L’invasion des profanateurs de sépultures prouve les indéniables qualités esthétiques de ce curieux film d’exploitation.
Soupçon visuel
C’est à n’y rien comprendre. De retour à Santa Mira, le docteur Miles Bennell (Kevin MacCarthy) doit répondre aux inquiétudes de ses patients. Celles-ci semblent irrationnelles : tel petit garçon soupçonnera sa mère de ne plus être la même, tandis qu’une nièce accusera son oncle de s’être subitement transformé, et qu’une épouse s’inquiétera du comportement étrange de son mari. Pourtant, en apparence, les accusés sont restés les mêmes. Secondé par Dana (Becky Driscoll), Miles cherchera à résoudre ce mystère et devra se rendre à l’évidence : ses patients disaient vrai. La transformation a donc bien eu lieu, en attestent les corps retrouvés par le docteur, corps remplacés par d’autres, identiques aux premiers. Cette substitution corporelle floute les contours de la réalité et oblige à reconsidérer ses certitudes. Le hors-champ, espace traditionnel de la menace, infiltre le champ, qui, par conséquence, ne propose plus le cadre rassurant de la transparence hollywoodienne. Don Siegel supprime donc la concordance de la vision et de la connaissance propre au classicisme hollywoodien en plaçant dans son plan une insoupçonnable vérité se parant du costume de l’accoutumé. Rapidement, le spectateur remet en cause ce qui lui est montré. La représentation perd peu à peu de sa probité. Si l’image ment, les choix esthétiques se feront agents de vérité. La musique de Carmen Dragon prend une valeur contrapuntique, révèle la menace du quotidien par une dramatisation de l’anecdotique. La déformation de l’angle de prise de vue crée chez le spectateur un malaise, comme si son rôle était de comprendre l’envers des choses et non plus d’accepter l’ordre établi.
Échapper à l’image
La subjectivité des rescapés permettra de combattre la prétendue objectivité du discours officiel. La projection des peurs de Miles sur les corps disparus s’oppose au discours scientifique du psychiatre, stipulant le leurre et la vérité de l’image : si les cadavres ne sont pas là c’est qu’ils n’y ont jamais été. Miles et son amante doivent alors fuir l’image officielle, à présent soulignée par l’artifice du cadre dans le cadre, dupliquant la présentation en re-présentation. Le paradoxe veut que les cadavres, doubles se substituant aux habitants de la petite ville, soient préservés dans des cosses. Libérés de leurs cocons les corps restent inertes, allongés sur le sol, avant de s’éveiller. Face à son double, Miles plante la fourche sur sa propre image afin d’empêcher sa disparition. L’outil planté dans la chair marque la volonté d’un retour à l’ordre, la verticalité de l’objet s’opposant à l’horizontalité du prétendu cadavre. La course-poursuite qui s’engage fait des deux héros les proies de la communauté. Le film de Donald Siegel annonce les morts-vivants de Romero, ces créatures à la fois proches et éloignées de nous, différentes et semblables, archétypes de l’Autre, ce grand inconnu qui nous ressemble. En le supprimant, l’image reflétée se brise, et c’est en cela que la scène montrant Miles assassinant son double est saisissante. Ce que craint le héros est l’uniformisation, car sous ses yeux la communauté se transforme en collectivité. À la consommation se substitue la production, l’individualisme est remplacé par la masse. Le principal tort de la substance extraterrestre est donc d’être idéologique, d’imposer une nouvelle conscience à celui qu’elle pénètre, une conscience de soi qui équivaut à celle de l’autre.
Pour échapper à cette contre-nature, les deux amants devront se réconcilier avec la terre, enfoncer leurs corps dans la boue. Leur échappée les conduit dans les montagnes, comme si le retour à la nature pouvait les libérer de la menace extra-terrestre, c’est-à-dire à ce qui est extérieur à la Terre, différent d’elle, opposé à ses mécanismes primaires. Les corps sont fourbus, le sommeil présente un danger, un seul instant d’inattention et la contamination pourra être pleinement opérante. Les gros plans de Siegel filmés en courte focale amplifie l’horreur des évènements : Miles assiste impuissant à la transformation de Dana, à l’évolution du Mal qui gangrène progressivement ses proches.
Avec L’invasion des profanateurs de sépultures, Don Siegel signe une œuvre aux multiples facettes, dont le discours visuel permet d’illustrer la paranoïa de sa génération. Fondateur, le film annonce les thrillers paranoïaques des années soixante-dix et, sans compter ses deux remakes directs (en 1978 et en 1993, respectivement réalisés par Philip Kaufman et Abel Ferrara), continue d’influencer de l’intérieur la production contemporaine, qu’elle appartienne au genre de la science-fiction ou non. Preuve de l’universalité propre à tout chef-d’œuvre.








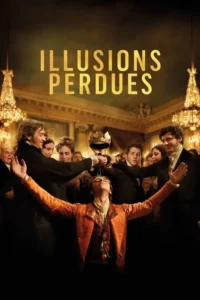
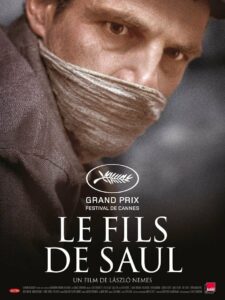







Soyez le premier a laisser un commentaire