Mis à jour le 3 février, 2018
La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence…
Cannes est le lieu de tous les possibles, de toutes les attentes, de tous les espoirs. Nous nous y rendons tous les yeux grands ouverts, à la fois dans un esprit de découverte, de grande curiosité, mais aussi dans l’envie de revivre un choc digne de ceux qui ont éveillé nos sens, ont fait naître en nous une passion cinéma. Le spectre de la palme d’or s’agite. Nous avons tous nos favoris, nos a priori, nos pronostics qui obéissent à des sympathies – très humaines – que l’on a pu nourrir par le passé.
Quand une sélection est quelconque à Cannes, en tout cas quand elle n’est pas exceptionnelle comme le fut celle de 2011 par exemple – qui suivait la purge de 2010; le sentiment fanatique peut d’autant plus facilement prendre le pas sur une neutralité qui devrait être de réserve.
Voilà, nous attendions de Lynne Ramsay un chef d’oeuvre. Car Lynne Ramsay est une grande cinéaste, une artiste exigeante, qui accorde de l’importance à la forme, dans une recherche esthétique permanente, mais aussi au fond. Son rapport au cinéma est celui qui nous inspire, qui nous aspire.
L’impression que nous laisse le film est double; une insatisfaction, ce sentiment de n’être pas passé loin, et une satisfaction, celui de la belle oeuvre. You were never really here est assurément beau. Peut être pas autant que The Assassin de Hsao Hsien, mais sans aucune concurrence possible, le film à Cannes qui bénéfice du plus grand soin dans la photographie, des plus belles lumières, du plus bel habillage. Il s’agit de cadres bien entendu, mais de couleurs et de contrastes avant toute chose. La poésie ne s’invite pas dans le récit, mais la succession de très belles images comprend son lot de féerie, quand bien même le sujet est la violence.
Ramsay de surcroît, lors même qu’elle s’attaque à un terrain des plus épuisés, marque les esprits en proposant une nouvelle façon de filmer la violence. Particulièrement bien vu, élégant, You were never really here peut nous rappeler dans ses effets l’impression qu’avait pu nous produire Pulp Fiction, celle d’un coup de maître, d’un trait de génie. Tarantino exposait la violence, de façon très frontale, très exagérée, mais la maquillait d’un humour permanent de sorte qu’elle passe au second plan, de sorte que le choquant en devienne des plus convenables, des plus appréciables également. Ramsay, elle, prend le parti inverse, elle met l’accent non pas sur l’acte violent, qu’elle ne filme jamais jusqu’à son terme, mais sur ce qui le précède. Et elle parvient à chaque fois à faire ressortir la violence du geste, le plus souvent en filmant l’état de folie, la perte de contrôle, de repères, la frénésie. Ce point est une parfaite réussite.
Quand il s’agit de rapprocher You were never really here d’autres modèles, à aucun moment il ne nous est pas venu à l’esprit de citer Scorcese et Taxi Driver, qui fait lui aussi partie de nos films de chevet. Encore une fois le parti pris – raccourci – commercial nous semble bien trompeur … S’il y a un vague rapprochement thématique possible entre les deux héros, quant à la prépondérance de l’aspect psychiatrique, il nous est bien plus naturel de rapprocherYou were never really here du maitre de la schizophrénie à l’écran, David Lynch. Car Ramsay clairement s’essaye également à réinventer la narration, entre prolepse et analepse, à croiser réel et fiction, à confronter présent, passé et avenir. L’assemblage du film s’apparente à un puzzle complexe dont l’équilibre tient à très peu, à un fil ambitieux et tenu, qui demande au spectateur toute sa concentration. Le mystère s’invite au milieu des tensions, un suspense naît. L’exercice est là encore réussi, peut être pas autant que Lost highway, mais en venir à oser cette comparaison est déjà un très bel hommage.
Alors oui, sur ces deux critères, et parce que Ramsay a su une nouvelle fois faire preuve d’excellence, notre avis est sans réserve; niveau palme d’or.
Sauf qu’un film est un tout, et que les critères d’excellence peuvent se multiplier, parfois, ils ne suffisent pas à rendre un film inoubliable. L’inspiration – que l’on chéri tant – elle même n’est pas suffisante, plus précisément, elle se doit d’être parfaitement linéaire, sans trou d’air. Hélàs, c’est bien ici que le bât blesse. Si Ramsay sur le plan visuel, esthétique, technique, narratif a confirmé, une nouvelle fois, tous les espoirs que l’on plaçait en elle, il est un plan qui vient ruiner tout notre argumentaire jusqu’à présent plutôt dythirambique.
Il s’agit de fond. Pour revenir sur la métaphore du puzzle, il peut y avoir un grand plaisir, une grande satisfaction à mettre bout à bout chaque pièce pour reconstituer le tableau principal. Quand celui-ci vient à être entièrement reconstitué, ce que le spectateur parviendra à faire sans que cela ne soit trop appuyé un tout petit peu avant la scène finale, très intense et habile, vient le temps où on l’acccroche au mur et le contemple. Et là, le sujet devient nu, il n’est plus orné, masqué, tous les voiles se sont tour à tour effacés, la résolution est nette. Pour peu que ce que l’on découvre ne nous inspire rien (une photo puzzle de montgolfières ou de chiens de montagnes par exemple), notre tentation sera rapidement de décrocher du mur l’oeuvre originelle. Ainsi de You were never really here … l’histoire reconstituée nous interpelle aucunement, pis, nous avons l’impression de l’avoir vu mille fois, et parfois traité avec plus de précisions ou de subtilité. A mettre la gomme sur la forme, Ramsay s’est sans nul doute égarée sur le fond. A notre grande désillusion …. You were never really here est un bel objet, une jolie prouesse, un film qui mérite sans nul doute des accessits mais aucunement le chef d’oeuvre que l’on aurait aimé …


























































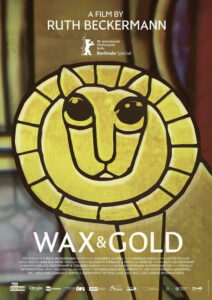



Soyez le premier a laisser un commentaire