Original, farfelu et lynchien tout a la fois, les qualificatifs ne manquent pas nécessairement pour qualifier l’OFNI que nous propose Rebecca Zlotowski. D’une trame enquêtrice que n’aurait pas forcément reniée Simenon, la réalisatrice de Planétarium nous rappelle, en lui donnant une coloration hautement improbable, son attirance, partagée avec Brisseau, pour le cinéma qui mêle allègrement le rationnel et l’irrationnel, questionnant en permanence la réalité de notre monde tel qu’on le perçoit. Vous entendrez peut être que le film ne respire pas la jeunesse, notamment parce qu’il s’intéresse à une psychiatre établie, au morne quotidien, et répète un motif déjà aperçu ici ou là, d’évolution progressive mais pourtant … Jodie Foster endosse un rôle qui aurait parfaitement convenu à Charlotte Rampling, dans un casting entièrement français, où l’on retrouve des valeurs sûres comme Mathieu Amalric, Virginie Efira, Vincent Lacoste et Daniel Auteuil rien que cela,; elle donne corps à son personnage avec beaucoup d’application, de sincérité, et de fantaisie. Sa performance, très éloignée des autres rôles qu’on peut lui connaître, se remarque, Zlotowski parvenant ici à un résultat plus convaincant que son précédent essai avec une star américaine, Natalie Portman, moins convaincante dans Planetarium, plus en retrait.

Après une ouverture effectivement plutôt académique, pour planter un décor dont on peine à identifier s’il est plus proche de Woody Allen ou d’Alfred Hitchcock, entre intrigue psychologique qui s’intéresse à une psychiatre (nous pourrions aussi évoquer Moretti) et trame policière où la composante psychologique tient la première place, le récit s’engouffre ensuite dans des interstices improbables, des à-côtés dont nous venons à nous demander s’ils ne proposent pas une nouvelle direction, n’instaurent pas une nouvelle couleur au film, à l’effet tout à la fois déconcertant, mais aussi, et l’intention en est manifeste, comique. Nous prenons ainsi un certain plaisir à voir les personnages interprétés par Foster et Auteuil se chercher, de façon impromptue et hasardeuse, une nouvelle jeunesse, et se comporter quasiment comme des enfants, qui ne mesurent pas nécessairement le risque de leurs agissements, et au contraire, s’en réjouissent. Leur romance retrouvée, permet à Daniel Auteuil de se rappeler à ses bons souvenirs d’acteur comique, tout en facéties, – nous retrouvons presque le bébel des sous-doués qui aurait vieilli bien tranquillement ! -. Son personnage joue une fonction pour le personnage principal comme pour le film, de révélateur (le désir renaît), voire de réflecteur – effet miroir, voire appui.


Rebecca Zlotowski s’amuse notoirement à démultiplier les pistes comme les formes, quelques belles images s’invitent, d’escaliers labyrinthiques, de flous créés par des ambiances orageuses nocturnes. Si le film n’instaure pas une ambiance à proprement parler Lynchienne, Rob préférant pour la bande originale des expérimentations diverses à l’ambiance hypnotique de Badalamenti, la direction photo elle aussi refusant d’instaurer un unique univers lui préférant une déambulation et une diversité permanente, comme nous le disions, le film se joue d’une confrontation permanente entre le rationnel et l’irrationnel, la psychanalyse se trouvant doubler dans sa fonction par des méthodes hypnotiques – autre source d’amusement -, la personne la plus cartésienne et rigide en apparence, Lilian Steiner, cette femme qui ne s’excuse pas, ne cherche pas à plaire, qui nous est présentée acariâtre et fermée, mais aussi en crise existentielle, d’un coup d’un seul se mue en personnage échappé de Twin peaks, envoûtée, profondément troublée, presque perdue, quand ses certitudes dans le réel se voient supplantées par d’autres certitudes, qui la dépassent littéralement. Elle interprète. Comme son métier l’invitait naturellement à le faire sur ses patients. Zlotowski s’amuse de cette confusion, elle assume totalement le mashup très improbable, offrant différents niveaux de lecture, et, de façon étonnante et ambivalente, parvient malgré le burlesque, la fantaisie et le désordre narratif à retomber sur ses pattes et tenir un fil particulier, par effet de va et vient, qui nous ramène toujours à l’ouverture et à la remise en question de son personnage principal, de ses convictions, interrogeant le réel, le présent, et ouvrant la porte à une grande illusion – n’est-ce pas la nature même cinématographique ? A l’instar de ce que l’on pouvait noter dans un autre film qui s’y essayait, Madeleine Collins, les influences lynchiennes affleurent sans nécessairement prendre toute la place, sans absolutisme. L’affiche pourrait tout aussi bien évoquer X files, à la mécanique relativement proche. Original à défaut d’être inoubliable, ludique et singulier, aux antipodes de toute intention naturaliste, Vie privée présente cet atout rare de ne jamais se laisser prédire, de dérouter, jusqu’au plus petit chemin forestier reculé, et d’en tirer sa sève.


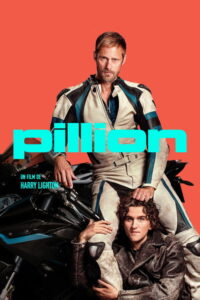

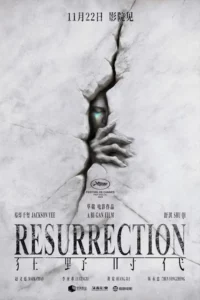
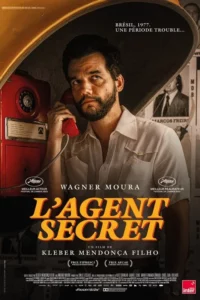
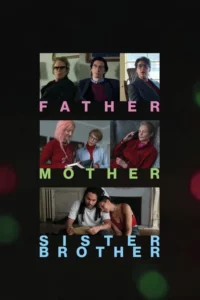

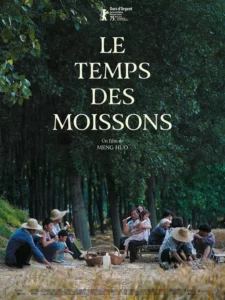
Soyez le premier a laisser un commentaire