Mis à jour le 3 janvier, 2026

À 23 ans, Hippolyte Charlut incarne cette génération de techniciens français qui refuse de cantonner son ambition au seul hexagonale. Formé à l’ESRA, il a franchi l’Atlantique pour plonger dans l’écosystème new-yorkais, passant du bénévolat sur des plateaux indépendants à la place de focus puller rémunéré. Entre adaptation linguistique, rythme infernal et persévérance quotidienne, son parcours interroge la persistance du mythe hollywoodien : dans un cinéma américain plus compétitif que jamais, le rêve reste-t-il à portée de ceux qui osent le traverser ?
Le Mag Cinéma (L.M.C.): Bonjour Hippolyte , tu embrasses le rêve de percer dans le cinéma américain et d’y faire carrière, peux-tu nous dire depuis combien de temps tu nourris ce rêve et par quelle étape tu es déjà passé pour te donner les moyens de réaliser tes ambitions ?
Hippolyte Charlut (H.C.): À l’origine, je n’avais aucune connexion avec le monde du cinéma. J’étais plutôt un passionné de sport, et c’est un peu par chance que j’ai mis le pied dans l’univers de l’audiovisuel. Au lycée, j’ai décidé de suivre une option audiovisuelle pendant deux ans pour gagner quelques points supplémentaires au baccalauréat. C’est durant cette période que j’ai acquis les fondamentaux, mais surtout que j’ai eu l’opportunité de tester, d’expérimenter et de commencer à filmer. Rapidement, cette découverte s’est transformée en une véritable passion.
Après cela, j’ai intégré une école de cinéma où j’ai passé trois années enrichissantes. Ces années m’ont permis de perfectionner mes compétences techniques, de mieux appréhender le fonctionnement des plateaux de tournage et de confirmer ma passion pour ce milieu. Mon école offrait également une quatrième année à New York, une chance que j’ai saisie pour explorer un nouvel environnement, apprendre différemment et vivre ma première expérience à l’international.
Sur place, j’ai eu l’opportunité de travailler sur plusieurs projets qui ont été cruciaux pour mon parcours. Ces expériences m’ont ouvert les yeux sur mon désir d’aller plus loin, de rester plus longtemps et de continuer à apprendre au contact de l’industrie américaine. C’est à ce moment-là que le rêve de bâtir une carrière aux États-Unis est devenu un objectif tangible. Aujourd’hui, je poursuis ce chemin avec la volonté de continuer à évoluer, à découvrir et à me forger une place durable dans le cinéma américain.
L.M.C. Y-a-t-il un film ou une personne en particulier qui a été le point de départ pour toi, et auquel tu reviens souvent ?
H.C. Il est indéniable qu’un projet et plusieurs rencontres ont marqué un tournant décisif dans ma vie. Le film « Manhattan Cowboy, réalisé par Killian Couëffé, a été un moment clé. C’est à travers ce projet que j’ai réalisé que je souhaitais vraiment m’installer aux États-Unis. Le producteur, Arthur Dupuis, avait une solide expérience des tournages américains et de la vie à New York. Il est devenu une véritable référence pour moi ; j’ai pu lui poser toutes mes questions, tant sur le travail que sur la vie quotidienne en tant que Français dans cette ville. Ses retours d’expérience ont été d’une grande valeur.
Le tournage lui-même a été une expérience enrichissante. Les différents lieux de tournage m’ont permis de découvrir des coins de New York que je n’avais jamais explorés auparavant, et j’ai eu la chance de travailler avec un matériel de qualité dans des conditions professionnelles exigeantes. Tout cela a renforcé mon désir de m’ancrer durablement dans cet environnement.
Parallèlement, grâce à mon école, j’ai pu entrer en contact avec des anciens élèves des promotions précédentes, notamment Pierrick Reiss. Il m’a énormément soutenu sur le plan technique, répondant à mes questions sur le métier d’assistant caméra, les attentes sur les plateaux et les moyens de progresser. Il m’a tendu la main à un moment crucial de mon parcours, et je lui en suis profondément reconnaissant.
Enfin, au cours de cette année, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs directeurs de la photographie, comme Félix Bailly, Evan Miller et Jeff Malo. Ce sont des professionnels qui continuent de me solliciter pour des projets, de me recommander auprès d’autres équipes et de me prodiguer des conseils. Leur confiance et leur soutien sont essentiels dans mon évolution professionnelle.
L.M.C. Pourquoi Hollywood, et pourquoi le cinéma américain ? Y’a-t-il une période ou un genre du cinéma américain qui te marque plus qu’une autre ? Le nouvel hollywood peut être ?
H.C. Pour être franc, mon attrait pour le cinéma américain ne découle pas d’une réflexion théorique ou d’un mouvement spécifique au départ. Mes premières expériences marquantes en tant que spectateur ont été des films tels que Star Wars ou Transformers. Ces œuvres emblématiques, profondément ancrées dans l’univers d’Hollywood, m’ont impressionné par leur ampleur visuelle, leur maîtrise technique et l’importance accordée à l’image. Sans vraiment m’en rendre compte à l’époque, c’est là que mon intérêt pour la création d’images a pris racine.
Par la suite, Hollywood et, plus largement, le cinéma américain se sont imposés de manière très concrète, surtout lorsque j’ai eu la chance de me rendre à New York grâce à mes études. Sur place, j’ai découvert une approche de travail très directe et exigeante, où la technique sert l’efficacité et le récit. Cela résonne particulièrement avec moi en tant qu’assistant caméra.
Au fil du temps, j’ai également appris à apprécier des périodes comme le Nouvel Hollywood, notamment pour la liberté créative accordée aux équipes et la façon dont la technique et la narration évoluent ensemble. Cependant, ce qui me touche le plus aujourd’hui, ce n’est pas un genre ou une époque en particulier, mais plutôt l’énergie du cinéma américain. Sa capacité à produire rapidement et en grande quantité, avec des équipes bien structurées, tout en laissant une véritable place à l’ambition artistique.
C’est cet équilibre entre exigence technique, rythme de travail et diversité des projets qui m’a donné envie de m’investir durablement dans cet univers.
L.M.C. D’une manière générale, quel est ton rapport au cinéma, dirais-tu que tu es un passionné et quelles ont été les oeuvres et les artistes qui ont crée le déclic chez toi ?
H.C. Mon rapport au cinéma est sans doute un peu atypique par rapport à l’image traditionnelle du « cinéphile ». Pour moi, c’est avant tout le processus de création qui me passionne, plutôt que le produit final. Je n’ai jamais eu ce moment d’illumination où je me suis dit « c’est exactement ce que je veux faire » en regardant un film ou un artiste en particulier. Ce qui m’a vraiment captivé, c’est la manière dont une équipe technique donne vie à une histoire à travers l’image.
En tant qu’assistant caméra, j’ai forgé mon regard sur le terrain. J’ai appris à apprécier le cinéma en étant sur les plateaux, en réalisant à quel point chaque détail, que ce soit la mise au point, le rythme, l’anticipation des mouvements ou la communication avec le chef opérateur peut influencer la qualité d’une scène. C’est là que ma passion s’est véritablement épanouie.
Bien sûr, certains films m’ont marqué sur le plan visuel, notamment de grandes productions américaines qui mettent en avant la technique et l’esthétique, comme Star Wars ou Transformers. Cependant, au-delà des œuvres ou des artistes, ce sont surtout les rencontres professionnelles qui ont été déterminantes : des directeurs de la photographie et des chefs d’équipe avec qui j’ai eu l’occasion de travailler, qui m’ont transmis une rigueur, une exigence et une vision du plateau.
Aujourd’hui, je dirais que ma passion pour le cinéma est très concrète : elle se traduit par un souci du travail bien fait, par la précision et par la capacité à servir un projet et une équipe. C’est cette approche, profondément ancrée dans la réalité du plateau, qui me définit le mieux.
L.M.C. Que penses-tu du cinéma américain indépendant, et comment le comparerais-tu au cinéma indépendant français ?
H.C. Je n’aborde pas le cinéma indépendant avec une perspective théorique ou esthétique trop académique. En tant qu’assistant caméra, mon regard est essentiellement pratique et centré sur le plateau. Ce que j’observe, c’est que le cinéma indépendant, qu’il soit américain ou français, a la capacité de produire des images tout aussi puissantes et mémorables, même avec des ressources limitées.
À mon avis, la véritable distinction réside davantage dans la manière de travailler. Aux États-Unis, même pour des projets indépendants, il existe souvent une organisation très structurée et une culture de plateau très professionnelle, avec des rôles bien définis. En revanche, en France, le cinéma indépendant peut parfois adopter une approche plus flexible et artisanale, ce qui peut également engendrer une forme de créativité différente.
En ce qui concerne les images, les décors et les environnements jouent un rôle crucial. Les paysages, l’architecture et les ambiances américaines offrent des cadres visuels très différents de ceux que l’on trouve en France, influençant ainsi le rendu à l’écran. Cependant, dans les deux cas, ce qui confère de la force à un film indépendant, c’est avant tout l’intention, l’équipe et l’engagement de chacun dans le projet.
En fin de compte, je ne dirais pas que l’un est supérieur à l’autre. Ce sont deux approches distinctes, chacune avec ses propres contraintes et richesses. Travailler dans ces deux environnements m’a surtout permis d’élargir ma vision du cinéma et du travail sur le plateau.
L.M.C. Que penses-tu de la vitalité du cinéma américain de nos jours en comparaison avec le cinéma européen, y vois-tu toujours des connexions comme il pouvait y avoir précisément entre le Nouvel Hollywood ou la nouvelle vague ?
H.C. Je pense que le cinéma américain et le cinéma européen demeurent très dynamiques aujourd’hui, bien qu’ils évoluent selon des dynamiques distinctes. Les liens entre les deux continuent d’exister, même s’ils ne se manifestent plus aussi clairement que par le passé, comme avec le Nouvel Hollywood ou la Nouvelle Vague.
À cette époque, il y avait une volonté manifeste de rupture, de prise de risques tant sur le plan formel que narratif, et ces mouvements communiquent intensément entre eux. De nos jours, les échanges sont plus subtils, mais tout aussi réels. On peut les observer à travers les festivals, les coproductions internationales, les équipes multiculturelles et la circulation incessante des techniciens et des artistes entre l’Europe et les États-Unis.
Sur le plateau, je remarque surtout une convergence dans les méthodes de travail et les références visuelles. De nombreux cinéastes indépendants américains continuent de puiser leur inspiration dans le cinéma européen, en appréciant son sens du cadre, du rythme et de l’intimité. Parallèlement, le cinéma européen commence à intégrer certaines logiques américaines en matière de narration, de production et d’efficacité technique.
Ainsi, je dirais que la vitalité est bien présente des deux côtés, mais qu’elle se manifeste de manière différente. Les grands mouvements peuvent sembler moins nommés ou théorisés, mais les influences croisées sont constantes et très concrètes sur le terrain. Aujourd’hui, ce dialogue se construit moins par des manifestes et davantage par la collaboration, les parcours individuels et les expériences sur le plateau.
L.M.C. Il y a en France de nombreuses voix qui colportent leur désamour du cinéma français, on note réellement une progression du french cinema bashing, parfois par des gens qui n’y connaissent vraiement pas grand chose en cinéma français, par préjugé, puisqu’ils consomment de la série américaine sur les plateforme en grande quantité … que penses-tu de cette façon manichéenne de voir les choses, y adhères-tu ?
H.C. Je ne partage pas du tout cette vision manichéenne. Selon moi, opposer le cinéma français au cinéma américain n’a pas vraiment de sens, surtout de nos jours. Ces deux univers sont très distincts, chacun avec ses propres logiques de production, de financement et de diffusion qui ne se ressemblent pas du tout.
Je pense qu’une partie de la critique du cinéma français provient effectivement de comparaisons biaisées. Beaucoup de gens consomment une multitude de séries américaines, souvent réalisées avec des budgets considérables, des équipes nombreuses et des formats adaptés aux plateformes, puis ils les comparent à des films français qui n’ont ni les mêmes ressources, ni les mêmes ambitions, ni parfois les mêmes objectifs artistiques.
Le cinéma français a ses limites, c’est vrai, mais il possède également une véritable force : une liberté d’expression, une place accordée aux auteurs, et une diversité de propositions qui existent précisément parce que le système permet une certaine prise de risque. Tout n’est pas toujours réussi, mais tout n’est pas non plus standardisé.
En tant que technicien, je constate surtout la présence de talents, d’équipes dévouées et d’une réelle exigence de travail des deux côtés. La qualité ne dépend pas du pays, mais des personnes, du contexte et du projet. Réduire le débat à des affirmations comme “le cinéma français est nul” ou “le cinéma américain est supérieur” empêche surtout de saisir ce que chaque modèle peut apporter et pourquoi ils peuvent être complémentaires plutôt qu’en opposition.
L.M.C. Qu’as-tu pensé de la palme d’or attribuée à Sean Baker pour Enora, et que penses-tu des films américains réalisés par des français, comme Leterrier à une époque, ou Coralie Forgeat récemment, qui s’inscrivent résolument dans le genre d’une part, mais aussi qui utilisent beaucoup les effets spéciaux ?
H.C. La Palme d’or décernée à Sean Baker semble parfaitement en phase avec l’évolution actuelle du cinéma indépendant américain. Son œuvre illustre qu’il est possible de créer un cinéma profondément humain, ancré dans la réalité, sans avoir besoin de budgets colossaux ou d’effets spéciaux spectaculaires. Cela rappelle que la force d’un film réside dans son regard, ses personnages et sa mise en scène, bien avant la technologie.
En ce qui concerne les films américains réalisés par des cinéastes français, comme Louis Leterrier à une époque ou plus récemment Coralie Fargeat, il est fascinant de voir comment ils s’approprient les codes du cinéma de genre et de l’industrie américaine, notamment par une utilisation plus affirmée des effets spéciaux. Cela contraste avec l’image traditionnelle du cinéma français, souvent perçu comme ayant une approche très limitée des VFX, presque comme un marqueur identitaire.
Il existe parfois l’idée que l’utilisation d’effets spéciaux pourrait trahir une certaine pureté du cinéma, comme si un bon film devait nécessairement s’en passer. Personnellement, je trouve cette perspective un peu réductrice. Les effets spéciaux sont avant tout des outils. Lorsqu’ils sont bien utilisés, ils ouvrent des horizons créatifs immenses, permettent d’explorer de nouveaux imaginaires et offrent aux réalisateurs une liberté supplémentaire.
Je pense que cette évolution est bénéfique. Elle ne remet pas en question la capacité d’un film à être puissant sans effets spéciaux, mais elle démontre qu’il reste encore tant à inventer et à expérimenter. Pour les réalisateurs français, cela peut être très inspirant : se dire « maintenant que ces outils sont à ma disposition, qu’est-ce que je peux raconter de nouveau ? » plutôt que de se cantonner à un cadre préétabli.
L.M.C. Beaucoup de cinéastes de renom, qui traversent l’Atlantique ne parviennent pas à transposer leurs oeuvres, et parfois y font leur plus mauvais film (de Kassovitz à Wong Kar Wai), d’autres y parviennent davantage (Almodovar récemmment), tu as une explication ?
H.C. Il n’existe pas de formule magique pour expliquer pourquoi certains cinéastes réussissent mieux que d’autres à faire le grand saut vers Hollywood. Chaque film représente un risque, et il est impossible de prédire avec certitude son succès, surtout dans un contexte culturel et industriel différent.
S’installer à Hollywood signifie souvent faire face à des défis très variés : un système plus rigide, des enjeux financiers plus importants, des attentes de marché plus élevées et parfois une liberté artistique réduite. Certains réalisateurs parviennent à naviguer dans ce nouvel environnement, à jongler avec ces contraintes tout en préservant leur identité, tandis que d’autres peuvent se sentir en décalage avec leur façon de travailler ou de raconter des histoires.
Le timing et les rencontres jouent également un rôle crucial. Un projet peut échouer non pas en raison du talent du cinéaste, mais parce qu’il arrive à un moment inopportun, avec des attentes mal orientées ou sans les bonnes personnes pour le soutenir. À l’inverse, lorsque les conditions sont favorables, comme cela a été le cas récemment avec Almodóvar, la transition peut se faire plus aisément.
En fin de compte, chaque film est une aventure unique. Traverser l’Atlantique n’assure ni succès ni échec : cela ajoute simplement une couche de complexité à un métier qui, par essence, reste imprévisible.

L.M.C. Tu vis aujourd’hui aux Etats-Unis, peux-tu nous parler de ce qui t’a le plus surpris quand tu es arrivé, mais aussi des grandes différences que tu peux constater aujourd’hui avec ce que tu as pu connaître en France, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou au niveau de la manière d’enseigner, de vivre le cinéma ou d’y travailler ?
H.C. Ce qui m’a le plus frappé en arrivant aux États-Unis, et plus particulièrement à New York, c’est l’intensité omniprésente. La vie y est nettement plus coûteuse qu’en France, que ce soit pour le logement, la nourriture ou les transports, ce qui nous pousse rapidement à nous adapter, à devenir plus organisés et autonomes. Le climat m’a également marqué : il peut faire très beau pendant de longues périodes, puis se transformer radicalement avec des hivers neigeux, des étés caniculaires, et même des épisodes d’inondations. On ressent vraiment que la ville vit au rythme de ces contrastes.
La vie quotidienne présente aussi des différences notables, notamment en ce qui concerne la santé. La relation avec les médecins, les assurances et les soins est beaucoup plus complexe et stressante qu’en France, et c’est clairement l’un des aspects auxquels il faut s’habituer en arrivant.
En ce qui concerne la nourriture, il existe une multitude de choix et de cultures variées, mais au quotidien, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous par rapport à la France. Il faut parfois faire des recherches pour bien manger, surtout quand on a un emploi du temps chargé.
Sur le plan de l’enseignement et du travail dans le cinéma, les différences sont très marquées. Aux États-Unis, l’apprentissage est beaucoup plus interactif : on pose constamment des questions, on échange, on débat, et les étudiants sont encouragés à s’exprimer. En France, on tend souvent vers un modèle plus traditionnel, où l’on écoute davantage qu’on ne questionne.
Lors des tournages, j’ai également constaté une approche très pragmatique et efficace. Les équipes sont rapides, bien organisées, et il existe une véritable culture du “problem solving”. Chacun est attendu pour être force de proposition, tout en respectant une hiérarchie bien définie. Cette énergie, combinée au rythme effréné de New York, m’a énormément appris et continue de me faire évoluer tant sur le plan professionnel que personnel.
L.M.C. Ton acclimatation aux Etats-Unis a-t-elle été un chemin semé d’embûches ?
H.C. Mon adaptation aux États-Unis a été un véritable parcours semé d’embûches. Le premier défi a été la langue : je n’étais pas très à l’aise avec l’anglais, et il a fallu que je m’ajuste rapidement, surtout sur les tournages où le vocabulaire technique diffère presque totalement de celui que l’on utilise en France. Apprendre le nom de chaque équipement, chaque outil, et comprendre les termes spécifiques sur le plateau a exigé beaucoup d’efforts de ma part.
Dans la vie quotidienne, j’ai également dû apprendre à exprimer clairement mes pensées, à formuler mes problèmes et à gérer les démarches administratives, le tout dans une langue qui n’était pas la mienne.
Il y a eu des moments de frustration, avec des espoirs déçus, des promesses non tenues, des arnaques, et le départ de certains amis vers la France faute d’opportunités. Cependant, toutes ces expériences m’ont également rendu plus fort et plus autonome, m’enseignant la persévérance nécessaire pour continuer à progresser dans l’industrie.
L.M.C. Est-ce que le monde du cinéma américain te semble ouvert ou fermé ? en rapport avec le cinéma français ? L’american dream te semble toujours une réalité aujourd’hui ?
H.C. Je pense que l’univers du cinéma américain est fascinant, avec ses propres caractéristiques. En comparaison avec le cinéma français, tout semble plus vaste : la ville, les ressources techniques, les projets en cours. La demande est immense, et pour être franc, je n’ai jamais été aussi occupé en trois semaines à New York qu’en trois ans à Paris. Les journées sont souvent très longues, atteignant parfois 12 heures, et peuvent même s’étendre à 14, 15, voire 16 heures.
L’« American Dream » est toujours bien vivant. Auparavant, je frôlais l’industrie du bout des doigts ; aujourd’hui, cela fait deux ans que je suis pleinement impliqué, et je n’ai encore rien vu de ce qui m’attend. Les possibilités d’évolution sont infinies, avec tant de choses à explorer et à apprendre. Chaque jour, je croise des personnes différentes, ce qui ouvre sans cesse de nouvelles perspectives.
L.M.C. Peux-tu nous parler plus précisément de tes premiers pas dans le cinéma américain, les premières difficultés que tu as pu rencontrer notamment ?
H.C. Mes débuts dans le cinéma américain ont été un véritable défi. La première difficulté a été la langue : il ne s’agissait pas seulement de maîtriser l’anglais courant, mais aussi de comprendre le jargon technique utilisé sur les plateaux. Parfois, quelqu’un me demandait de « grab the dolly arm », et je restais perplexe, ne sachant pas immédiatement de quoi il s’agissait, car ce n’est pas le même terme qu’en français.
Ensuite, le rythme de travail est effréné. Les journées peuvent facilement atteindre 12 heures, et parfois même 14 ou 16 heures, sans compter les trajets qui peuvent durer entre 30 minutes et 1h30. Il faut également s’adapter à des conditions variées : tourner sous la pluie, la neige, ou par une chaleur écrasante, tout en gérant des problèmes techniques avec du matériel qui peut parfois faire défaut.
Malgré toutes ces épreuves, il y a une immense satisfaction à la clé de chaque projet. Voir son nom au générique d’un film projeté sur grand écran, rencontrer des équipes extraordinaires, participer à des projets uniques, découvrir des lieux fascinants comme des penthouses à Manhattan ou des voitures de sport sur les tournages tout cela me rappelle pourquoi je suis ici et pourquoi je suis passionné par ce métier. Chaque jour apporte son lot de nouvelles expériences et de découvertes, et c’est ce qui me pousse à aller de l’avant.
L.M.C. En France, nous avons le cinéma d’auteur, et le culte du réalisateur artiste. Aux Etats-Unis, l’approche est très différente, et les producteurs ont beaucoup plus la main mise sur les films. Tu l’as déjà constaté ? Et qu’en penses-tu personnellement ?
H.C. En tant que technicien, je n’ai pas eu l’occasion d’être directement impliqué dans les décisions de production ou dans les interactions entre réalisateurs et producteurs. Par conséquent, je ne peux pas vraiment faire une comparaison approfondie de ces différentes approches. Mon expérience se concentre principalement sur le travail technique sur le plateau, et c’est dans ce domaine que je déploie toute mon énergie et ma passion.
L.M.C. Les temps de tournage aux Etats-Unis sont réputés plus courts, et les horaires de travail beaucoup plus extensibles sur un tournage tu confirmes ?
H.C. Les journées de tournage aux États-Unis sont souvent très étendues, généralement d’environ 12 heures, et peuvent facilement s’allonger jusqu’à 16 heures ou plus, en fonction des projets. Ce rythme soutenu peut sembler exigeant, mais il est également ce qui permet d’obtenir des résultats tangibles et d’avancer rapidement dans le milieu.
L.M.C. Tu as fait l’école de Cinéma ESRA, avec laquelle tu as pu nourrir ton rêve de cinéma américain. Peux-tu nous parler du programme spécifique dans lequel tu t’es inscrit et de ce en quoi ce programme a facilité ton insertion professionnelle ?
H.C. L’ESRA m’a avant tout permis de poser des bases solides, tant techniques que théoriques, pour évoluer dans le monde du cinéma. Le programme spécifique à New York a été une véritable porte d’entrée dans l’industrie américaine : j’y ai découvert le fonctionnement des tournages, appris le vocabulaire technique utilisé aux États-Unis, et compris comment communiquer efficacement sur un plateau.
Cependant, au-delà de l’enseignement, c’est vraiment dans la pratique que tout se joue : il est essentiel de se lancer, d’accepter de faire des erreurs, d’apprendre et de persévérer. L’école fournit les fondations, mais c’est l’engagement et la curiosité de chaque élève qui feront toute la différence. Un autre atout précieux est le réseau d’anciens élèves : échanger avec ceux qui ont déjà fait leurs preuves aux États-Unis offre des conseils pratiques et un soutien que l’école seule ne pourrait jamais fournir.

L.M.C. Aujourd’hui, tu as plusieurs films à ton actif, est-ce que trouver du travail devient pour toi plus facile ? Peux-tu nous parler un peu de l’importance du réseau là-bas, et de la manière dont tu t’es fait connaître ?
H.C. Je ne dirais pas que la recherche d’emploi devient nécessairement plus simple, mais avec le temps, j’ai appris à résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Je maîtrise désormais mieux le matériel, les caméras, les objectifs et le déroulement d’un tournage.
En ce qui concerne le réseau, il est absolument crucial à New York. J’ai commencé par solliciter des conseils auprès d’anciens élèves de mon école et de tous les Français que j’ai croisés à NYC. Puis, j’ai frappé à toutes les portes des sociétés de production, déposant des CV et expliquant que, bien que je ne puisse pas travailler légalement pour le moment, j’étais prêt à offrir mon aide gratuitement. Grâce à cette initiative, j’ai été appelé sur plusieurs tournages et j’ai pu recueillir les coordonnées de nombreuses personnes à qui j’ai ensuite proposé mes services.
Parallèlement, j’ai pris contact avec des sociétés de location de matériel afin d’apprendre les noms des caméras, des objectifs et des accessoires utilisés aux États-Unis. Après plusieurs mois de bénévolat, j’ai finalement obtenu mon numéro de sécurité sociale, ce qui m’a permis de travailler légalement. Grâce aux nombreuses personnes rencontrées sur les tournages, j’ai pu commencer à travailler, à gagner ma vie et à continuer à progresser dans l’industrie.
L.M.C. Y-a-t-il eu des rencontres déjà déterminantes ?
H.C. Oui, j’ai eu la chance de vivre plusieurs rencontres marquantes. Certaines de mes collègues sont devenues de véritables amies, et j’ai également eu l’opportunité de croiser des professionnels déjà bien établis dans l’industrie, comme des directeurs de la photographie, des réalisateurs de renom, ou encore des techniciens ayant contribué à des films emblématiques ou collaboré avec des célébrités.
Il m’est arrivé d’être encore plus fasciné par les échanges avec un technicien qui, d’un point de vue purement technique, m’expliquait les coulisses de la réalisation d’un film, plutôt que de discuter avec le réalisateur lui-même. C’est un peu le rêve d’un petit garçon qui passait des heures à regarder des films à la télévision : se retrouver un jour sur un plateau de tournage, face à ceux qui œuvrent derrière la caméra, c’est une source d’excitation et d’inspiration inégalée.
L.M.C. Tu as occupé différentes fonctions que l’on note sur les génériques des films où l’on retrouve ton nom (derrière la caméra ou au montage) ? As-tu une idée fixe du métier que tu souhaites exercer ou au contraire, es-tu un touche à tout, qui aimerait pourquoi pas aussi réaliser ses propres films ?
H.C. Grâce à l’éducation que j’ai reçue, j’ai eu l’opportunité d’explorer tous les rôles sur un plateau de tournage, ce qui m’a permis d’acquérir des compétences fondamentales dans divers domaines. Avant de me spécialiser, j’ai pris le temps d’expérimenter plusieurs postes afin de mieux appréhender chaque facette de ce métier, ce qui m’a aidé à faire un choix éclairé. Cela m’a conduit à me concentrer sur le rôle d’assistant caméra et de focus puller, tout en gardant une curiosité intacte et une ouverture à d’autres expériences qui pourraient enrichir mon parcours. Qui sait, peut-être qu’un jour, j’aurai la chance de réaliser mes propres films.
L.M.C. D’une manière générale, tu es parti pour t’établir aux Etats-Unis, si on se donne rendez-vous dans 5 ans, qu’aimerais-tu avoir accompli d’ici là ?
H.C. Dans cinq ans, j’espère avoir solidifié ma présence aux États-Unis en obtenant mon visa, ce qui me permettra de poursuivre ma carrière sur divers tournages et de rencontrer de nouvelles personnes dans l’industrie. Mon souhait est d’explorer une variété de productions — qu’il s’agisse de séries, de longs-métrages, de publicités, de courts-métrages ou d’événements sportifs, afin de découvrir le domaine qui me passionne le plus.
Par la suite, j’aspire à devenir membre de l’Union des Camera Operators, ce qui me donnerait accès à des projets plus ambitieux tout en m’assurant une certaine stabilité professionnelle. Enfin, j’aimerais investir dans un bon équipement personnel, afin de pouvoir travailler de manière autonome tout en maintenant un niveau de professionnalisme élevé.
L.M.C. Y’a-t-il un(e) ou des cinéastes avec lesquels tu souhaites tourner plus que tout au monde ?
H.C. Il y a sans aucun doute certains réalisateurs avec qui j’aimerais énormément collaborer, surtout ceux qui ont profondément influencé mon enfance et nourri mon imagination : Michael Bay, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Christopher Nolan… des figures emblématiques du cinéma, n’est-ce pas ? Avoir l’opportunité de travailler avec eux serait un rêve devenu réalité, tant pour l’apprentissage que pour participer à des projets qui me mettraient vraiment au défi.
En tant que technicien passionné par l’image, je rêve également que certains grands directeurs de la photographie, avec qui je partage une connexion professionnelle comme Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Greig Fraser, ou même des talents émergents comme Oren Soffer, connus pour leur vision unique — puissent un jour entendre parler de moi, que ce soit par l’intermédiaire de leurs équipes ou à travers des projets à venir. Ce serait tout simplement incroyable de pouvoir travailler ou apprendre aux côtés de directeurs de la photographie de ce calibre.
L.M.C. Des comédiens.nes peut-être aussi ?
H.C. En ce qui concerne les acteurs, j’ai toujours eu une admiration particulière pour ceux qui ont marqué mon enfance, tels que Shia LaBeouf et Megan Fox dans Transformers, Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal dans Prisoners, ou encore Elijah Wood, Ian McKellen et Viggo Mortensen dans Le Seigneur des Anneaux. Ce serait vraiment incroyable d’avoir l’opportunité de collaborer ou d’apprendre à leurs côtés sur des projets à venir.
L.M.C. Prends-tu le même plaisir à travailler sur des clips, des courts métrages, des moyens métrages ou des longs ?
H.C. Absolument, chaque projet représente pour moi une aventure singulière, et il n’existe jamais deux expériences identiques. J’apprécie vraiment le travail sur des clips, des courts, des moyens ou des longs métrages. Cependant, je constate qu’une complicité plus forte se développe souvent lors des projets de moyens et longs métrages. Cela s’explique par le temps que nous passons ensemble, qui nous permet de mieux nous connaître et de vivre ensemble un événement ou une aventure, renforçant ainsi les liens au sein de toute l’équipe.
L.M.C. Où nos lecteurs peuvent-ils découvrir ton travail ?
H.C. De nombreux projets sur lesquels je travaille sont encore en post-production ou en cours de présentation dans des festivals, ce qui fait que je ne peux pas encore les partager publiquement. Cependant, je suis en train de créer un site internet où vous pourrez bientôt découvrir l’ensemble de mon travail. En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à certaines de mes réalisations sur Instagram : @hippocharlut, ou à me contacter directement par email à [email protected].


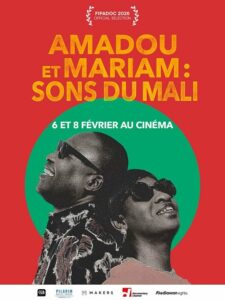


Soyez le premier a laisser un commentaire