Mis à jour le 29 janvier, 2017

Il y a sans doute un avant et un après Rosemary’s Baby. Réalisé en 1968, le cinquième long métrage de Roman Polanski sut marquer les esprits et exerce aujourd’hui encore une influence non négligeable sur la nouvelle génération du cinéma d’horreur américain.
C’est en 1967, que Ira Levin publie Rosemary’s Baby, un second roman qui devient rapidement un best-seller. Presque immédiatement, William Castle, réalisateur connu des amateurs de cinéma d’horreur, achète les droits de l’ouvrage et entreprend de le mettre en scène en totale autonomie. Charles Bluhdorn, propriétaire de la Paramount, le convainc alors de produire le film pour son studio et d’engager le jeune Roman Polanski pour le réaliser. À l’époque, Polanski n’a mis en scène qu’un seul film pour un studio hollywoodien : Le Bal des vampires (1967), comédie horrifique parodiant avec justesse et talent l’atmosphère des productions de la Hammer. Perfectionniste, le cinéaste s’adapte mal aux normes hollywoodiennes, ne parvenant pas à respecter le plan de tournage et dépassant le budget initialement prévu . Qu’importe, pressentant le succès à venir, la Paramount accepte les excès du réalisateur et le film sortira sans retouches ni coupures . Cette première transgression, bien que factuelle et habituelle, prouve la prégnance du style polanskien sur Rosemary’s Baby. La ressortie en salle cette semaine de ce chef-d’œuvre inclassable nous donne l’occasion de vous en proposer une lecture.
Un jeu de dupes

Que le spectateur soit prévenu : tout synopsis relatif à Rosemary’s Baby ne pourra que l’induire en erreur. Dès l’ouverture, Polanski semble s’amuser de nos attentes. La musique composée par Christopher Komeda prend la forme d’une berceuse chantonnée par une voix féminine, tandis que le lettrage du générique se colore d’un rose sirupeux. L’attente signale l’imminence du basculement, le réalisateur semblant prendre un malin plaisir à détourner les formes génériquement attendues. C’est l’identification qui permet ce jeu de dupes. Notre regard se confond avec celui de Rosemary (Mia Farrow), jeune femme venant d’emménager avec son mari (John Cassavetes) dans un appartement new-yorkais. Comme elle, nous sommes prêts à croire à la joliesse du mariage, à désirer l’arrivée d’un enfant, à tolérer la gentillesse un peu appuyée de voisins envahissants. Puis, comme elle, nous en viendrons à douter, à imaginer que notre entourage n’est peut-être pas ce qu’il prétend être. La vision subjective contraint la certitude et force à reconsidérer chaque détail, chaque évènement, dans son entièreté.

En cela, Rosemary’s Baby annonce les thrillers paranoïaques des années soixante-dix, et retrouve une verve critique propre au cinéma européen des années soixante. Il y a quelque chose de buñuelien dans la manière dont Polanski dépeint la société aisée américaine. Derrière la reconnaissance familière, le cinéaste cherche l’ignominie en gros plans. La caméra parcourt l’appartement des jeunes époux en une série de travellings qu’arrêtent les corps en attente, rejouant les scènes d’une vie conjugale que Polanski parvient à surprendre dans leur plus douloureuse réalité. Œuvre frontalière, Rosemary’s Baby ouvre un passage entre la modernité européenne des années soixante et le renouveau du cinéma américain des années soixante-dix. Un art du passage qui constitue la manière même du film.
Une traversée

Héritier et matriciel, Rosemary’s Baby retrouve la faille de Répulsion (1965) et annonce le huis-clos du Locataire (1976). Outre quelques résurgences indicielles, ces trois films partagent une structure difficilement identifiable. Si le rose vire au rouge sang, si l’amour se transforme en cruauté et si la maternité devient monstrueuse, le basculement de l’un à l’autre n’est jamais appuyé. Anthropologique, la caméra de Polanski perçoit les comportements de ses personnages comme symptômes d’un mal intérieur. C’est à travers les rêves de Rosemary que se produit le fantastique, fantasmes qu’interrompt le vraisemblable du réveil. L’ambiguïté structure le déroulement de l’intrigue et met en doute la fiabilité des images. La paranoïa de l’héroïne joue le rôle d’un prisme défigurant l’espace et le temps du film. Révélateur ou falsificateur, le point de vue est indécis, instable, soumis au dialogue incessant de la raison et de la folie. La traversée de Polanski passe de l’extérieur à l’intérieur, des façades d’immeuble aux murs de l’appartement, de la félicité du visage à l’horreur des entrailles. À la faveur d’un gros plan oxymorique, les extrêmes se rejoignent et la distance s’absout. Rosemary contemple sa progéniture maléfique et avec une tendresse ironique, Polanski projette sur le visage de la jeune femme l’achèvement d’une traversée.

Comme par contamination, le film de Polanski suppose un transfert, un cheminement, un passage à l’intérieur d’un espace-temps délimité, qu’il soit celui d’un appartement, d’une relation amoureuse, ou d’une œuvre artistique. Sur la surface codifiée du genre, le réalisateur trace la figure d’une obsession toute personnelle qui sera reconduite de film en film. L’œuvre de Polanski ne peut se lire qu’à travers le regard de son auteur ; aussi nous conseillons au lecteur qui souhaiterait en savoir plus sur la manière et les méthodes du maître, de se reporter à son autobiographie intitulée Roman par Polanski, publiée en 1984 chez Robert Laffont.



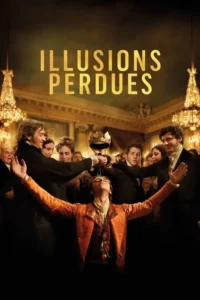
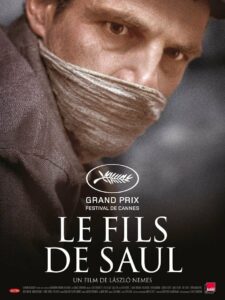

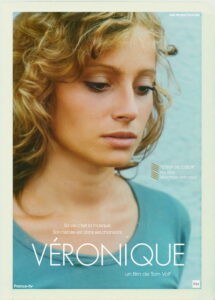
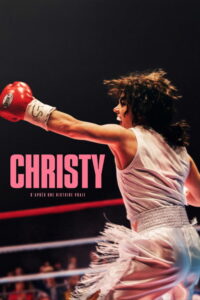





Soyez le premier a laisser un commentaire