Mis à jour le 29 mai, 2016
Clint Eastwood et le western, longue histoire. Celle-ci commence en Italie aux côtés de Sergio Leone. Face à la caméra, Eastwood devient l’homme sans nom. Tranquille mais dangereux, silencieux, voire mutique, mais charmeur, l’acteur excelle dans le mystère et l’ambiguïté. En lui convergent les contraires devenus complémentarités essentielles. Le visage marqué, les yeux perpétuellement plissés, Eastwood assène ses répliques de la même manière qu’il appuie sur la gâchette, avec efficacité et maitrise. Quelques années plus tard, l’acteur passe derrière la caméra. Dans Un frisson dans la nuit (Play Misty for Me, 1971), Eastwood assure la double tâche de réalisateur et d’interprète principal. Ce dédoublement, aujourd’hui habituel, sera reconduit dès son second long métrage, L’Homme des Hautes Plaines (High Plains Drifter, 1973). Ressorti en salles cette semaine, ce western n’est pas seulement une variation autour du style de Leone, mais une véritable œuvre personnelle, à la fois genèse de la future manière du maître et synthèse de son héritage symbolique.
Un travail d’amplification
Solitaire, le cavalier traverse le plan large. Sa route n’a rien d’une quête mais tient plutôt de l’errance éternelle. Le personnage de Eastwood se calque sur la silhouette de ses précédents avatars westerniens tout en débordant ses contours. Toujours avare de paroles, l’étranger accepte de protéger une petite ville contre la vengeance de trois malfrats. Aucune générosité ici mais un intérêt dont la trivialité apparente dissimule une cause plus profonde. Eastwood et ses deux scénaristes, Ernest Tidyman et Dean Riesner (non crédité au générique), rejouent le schéma classique du quidam devenu protecteur de la loi, façon Henry Fonda dans My Darling Clementine (La Poursuite infernale, John Ford, 1946).
Mais l’entreprise est d’emblée corrompue par la relativité essentielle qui travaille les rapports sociaux et existentiels des personnages. La justice qu’incarne le héros n’a pas l’objectivité de la loi, elle s’origine plutôt dans un attachement au passé conférant au personnage une aura spectrale. On retrouve ici l’un des tropes des caractères leoniens que Eastwood parvient à pousser à son culmen à travers une série d’actes difficilement justifiables. L’Homme des Hautes Plaines provoque la rencontre de deux mythologies distinctes mais thématiquement reliées : celle, naturaliste, du western italien et celle, plus idéelle, du western classique hollywoodien. L’hybridité use du premier pour désamorcer les prétentions du second, travail de sape non exempt d’une certaine dose d’ironie et de parodie. La résolution du film n’est pas celle d’une situation initiale progressivement développée mais plutôt l’accès à une réminiscence qui touche au cœur de la communauté.
Un corps, des visages
L’étranger traverse la petite ville à travers un travelling discontinu. Le mouvement est sans cesse empêché par l’intervention de regards scrutateurs, marqueurs d’un lien trouble entre le héros et les membres de la communauté. Méfiants ou inquiets, les visages ne sont que des façades que Eastwood saura révéler. L’acte de subversion passe d’abord par une mise en scène carnavalesque, orchestrée de main de maître. Le nain devient shérif et maire, la ville se colore en rouge, modification symbolique que viendra confirmer le panneau à son entrée : « Hell », bienvenue en enfer. Vision hallucinée et chroma flamboyant, le tour que joue le héros aux habitants se dévoile sur la longueur. Certains cadrages – contre-plongée saisissante, compositions géométriques – rappellent le style de Leone, mais leur agencement exprime une rupture et une contiguïté qui sont le propre de Eastwood-réalisateur.
Le retour d’une scène primitive se veut lacunaire, imprécis. Il faudra la convoquer sans cesse, faire alterner les points de vue, pour qu’enfin la vérité advienne. L’Homme des Hautes Plaines est un western du temps, non de l’espace. En dénote le parcours du héros, traversant sans cesse la ville, reproduisant les mêmes gestes afin de soigner l’amnésie du groupe. Désolidarisé, ce dernier révèle son vrai visage. Plus de légitimité, seulement des pulsions : le désir l’emporte et signale l’horreur d’autrefois. Visiteur d’un passé proche, Eastwood n’expie jamais mais ravive seulement les braises de la faute originelle. Paradoxe et ambiguïté qui feront la force de son cinéma, de Josey Wales hors-la-loi (The Outlaw Josey Wales, 1976) à Gran Torino (2009) en passant par Minuit dans le jardin du bien et du mal (Midnight in the Garden of Good and Evil, 1997) et Mystic River (2003).
Voir L’Homme des Hautes Plaines c’est pénétrer dans l’interstice du western. Eastwood s’échappe du reflet pour affirmer la présence d’un regard plus destructeur que jamais. Si le lecteur souhaite en savoir plus sur l’œuvre du cinéaste, nous ne pouvons que lui conseiller la lecture de l’essentiel Clint Eastwood. Une légende, biographie écrite par Patrick McGilligan, traduite par Muriel Levet et publiée en France aux éditions du Nouveau Monde. Ajoutons l’excellent ouvrage d’entretiens menés par le regretté Michael Henry Wilson, Eastwood par Eastwood, publié par les Cahiers du cinéma.









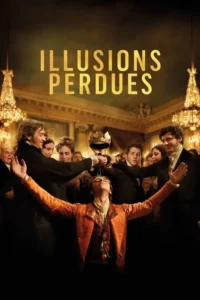
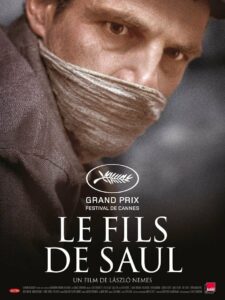







Soyez le premier a laisser un commentaire