Sofia Coppola fait partie de ces quelques cinéastes à l’univers visuel si identifiable que quelques minutes d’un film suffisent à attester de leur signature. A l’instar d’un Ken Loach, cet hérisson nous aurait-dit Michel Ciment, une constance revient également quant aux thématiques abordées, il ne suffit que de très peu d’éléments pour là aussi reconnaître la signature. Sur la forme, un film de Sofia Coppola convie presque toujours des couleurs pastel, une décoration rose bonbon, une omni présence de lumières douces, de rayons de lumière qui traversent des intérieurs, en voile ou en halo, une très grande minutie au niveau de la décoration (on peut même parler de prévalence), une ambiance musicale sophistiquée, affirmée et omniprésente. Sur le fond, il s’agit le plus souvent d’accorder la part belle aux sensations, de s’attacher à des petits riens parfois bien plus dévastateurs qu’ils ne le paraissent de prime abord, de questionner le rapport au père, le passage à l’adulte de jeunes filles habituées aux univers de poupée, plus généralement d’interroger les apparences, et ses corollaires, le détail vestimentaire, la coquetterie, le rapport à la beauté, qui parfois remplit le vide d’une existence, d’une princesse insatisfaite.
Sofia Coppola, pourrions nous dire en substance, propose un formalisme parfaitement antagoniste de celui de David Fincher, à se demander si les retrouver tous deux en compétition à Venise tenait réellement du hasard. En confiant l’adaptation de son livre Elvis & moi (Elvis and I) à Sofia Coppola, Priscilla Presley, qui vient de perdre sa fille, ne s’y est probablement pas trompé. Qui mieux que la fille de Francis Ford pouvait tout à la fois faire ressortir les deux composantes majeures de cette histoire d’amour si particulière: sa part de rêve et sa part de cauchemar. Qui mieux qu’elle pouvait tout à la fois mettre en lumière, sur des plans parfaitement égaux, le sublime et le laid, le réel et le fantasmé, le sincère et le prémédité, la douceur et la violence, sans que l’un ne prenne le pas sur l’autre, sans que les effets ne s’en atténuent ? La tentation de tourner le récit sur Elvis Presley, ou sur l’Amérique tout entière, de ranger le personnage de Priscilla au rang de faire valoir, de fenêtre privilégiée pour observer au plus prêt le plus mythique des chanteurs américains, son rôle d’ambassadeur de l’American Dream aurait fait chavirer tout autre réalisateur, attiré par la puissance du mythe, à cette caverne d’Ali Baba, ce matériau quasi inépuisable que Luhrmann n’a fait qu’effleurer…
Le conte de fées aurait volé en éclat, tout comme le portrait de cette enfant remplie d’innocence, sous l’emprise de son admiration, et qui apprend à se découvrir elle-même. Vivre son rêve ne sera pas sans conséquence, la privant d’une existence normale, d’un rapport à l’autre simple, vivant une situation vue par les autres comme un immense privilège, synonyme de bonheur assuré. La vie de Priscilla a tout de la prison dorée, celle-là même qui hante Sofia Coppola depuis sa plus tendre enfance, et qui relie donc très naturellement les deux femmes.
Coppola nous sert donc du Coppola, du grand Coppola pourrait-on même dire, au vu de l’effort mis sur les costumes, les décors, le maquillage, les lumières, l’image, l’ambiance sonore et musicale (Crimson and Clover, de nombreuses reprises d’Elvis au piano, évocatrices de la main de fer dans le gant de velours d’Elvis). La mise en scène majestueuse, comme la précision narrative – la reconstitution dans le détail-, participent à la douceur ambiante, trompeuse (principe même de la prison dorée). Son envers renvoie aux traumatismes, aux désillusions, à la violence subie, et retournée pour pouvoir s’en extraire.



Autre atout indéniable du film, le jury de la Mostra ne s’y est du reste pas trompée, Sofia Coppola a trouvé une jeune actrice remarquable, que ce soit par la précision de sa gestuelle ou de ses regards, la sensibilité qui peut s’en dégager, Cailee Spaeny, honorée d’un Lion d’argent de meilleur interprète.

Certains s’offusqueront certes que le style prenne le dessus sur le mythe Elvis, que Coppola se désintéresse quelque peu de la psychologie du King, mais l’aurez-vous noté, le film se nomme Priscilla (et non pas Elvis and I), et donc pourquoi reprocher à une artiste d’avoir suivi l’intention première qu’elle s’était donnée, d’avoir suivi un chemin parfaitement personnel ?









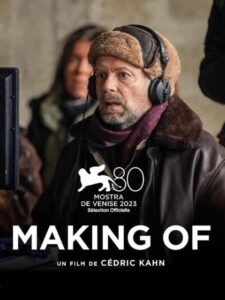
Soyez le premier a laisser un commentaire