Mis à jour le 27 septembre, 2016
En 1933, dans sa préface à l’édition française de Sanctuaire (Sanctuary, 1931), André Malraux décrivait le roman de William Faulkner comme « l’intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier ». Cette belle comparaison pourrait tout à fait s’appliquer à En quatrième vitesse (Kiss Me Deadly, 1951), véritable fleuron du cinéma américain des années cinquante et l’un des plus beaux films réalisés par Robert Aldrich. Chez l’un comme chez l’autre, l’argument policier est détourné au profit d’une réflexion stylistique et humaniste portée par une forme âpre et tortueuse. Sa restauration, logiquement fêtée par une ressortie en salles, finit de prouver l’importance de ce film au sein de l’histoire du cinéma. Au cœur de ce voyage, en effet, la nuit semble tragiquement infinie.
Violence et passion
Né en 1918 à Cranston dans le Rhode Island, Robert Aldrich commence sa carrière comme assistant-réalisateur pour la RKO. Pendant ces onze années d’assistanat, qu’il considérait comme les plus importantes de son éducation hollywoodienne, Aldrich apprend son métier aux côtés de Jean Renoir, Lewis Milestone, Joseph Losey, Fred Zinnemann, Richard Fleischer ou encore Charles Chaplin. À la RKO, le futur réalisateur prend goût pour les séries B réalisées avec de petits budgets qui, loin de présenter une contrainte, forcent l’inventivité des scénaristes et des cinéastes. Après un travail de producteur, puis de réalisateur à la télévision, Aldrich crée sa propre compagnie : « The Associates and Aldrich ». Ce parcours reflète la ténacité de Aldrich qui, avant de passer derrière la caméra, s’est essayé à plusieurs métiers de la profession. Son désir d’indépendance et de maitrise lui permettent de traverser les décennies. De 1953 à 1981, Aldrich met en scène près d’une trentaine de longs métrages, participant ponctuellement à leur écriture, presque toujours à leur production. Au début des années cinquante, le réalisateur s’affirme à travers une approche sans concession. Dans sa sobriété même, la forme exprime une violence sourdre et aveugle. Jamais esthétisée, la brutalité d’En quatrième vitesse actualise les pulsions latentes du film noir des années quarante et ouvre le genre policier à une nouvelle ère. Prise dans un cercle vicieux, la cohérence échappe toujours à la raison. Par mépris pour leur matériau de base (un roman de série signé par Mickey Spillane, publié en 1953), Aldrich et son scénariste Albert Isaac Bezzerides éludent les évènements pour les adapter au rythme du montage. Aldrich découpe, dilate, vise l’action en son sens le plus cinématographique.
L’apparente absence de déterminismes force la comparaison avec Le Grand Sommeil (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946) co-scénarisé par Raymond Chandler et William Faulkner. Pour Philip Marlowe et Mike Hammer, l’aventure est erratique et l’espace urbain se confond avec un univers carcéral. Plus proche de Dana Andrews que de Humphrey Bogart, Ralph Meeker est un corps fourbus, une surface de projection réceptive et soumise. L’action, forcément absurde, provoque les rencontres les plus insolites. Aldrich compose ici un véritable bestiaire. Voix tonitruante, regard torve, faciès bouffis et tuméfiés hantent les compositions d’un film qui prend l’allure d’une peinture de Jérôme Bosch.
Pour Jean-Baptiste Thoret (Le cinéma américain des années 70), l’existentialisme politique d’En quatrième vitesse annonce les thrillers paranoïaques du Nouvel Hollywood. Le fameux pronom « them » convoque une critique ouverte et plurielle. L’allusion à la menace nucléaire s’anoblit de certaines considérations métaphysiques. L’ouverture de la boîte de Pandore évide le plan d’une lumière aveuglante et semble brûler la matière même du film. La lecture inversée du générique prend ici tout son sens. Narration et technique, forme et fond sont tous ensemble pris dans le même engrenage tragique. La temporalité décrite par Aldrich doit être perçue comme à rebours, c’est-à-dire imprenable et instable. Les évènements ont déjà eu lieu et réapparaitront. Qu’importe, le baiser ne pourra toujours être que mortel.
La chair et le sang
À propos du Grand Couteau (The Big Knife, 1955), François Truffaut décrivait l’esprit d’Aldrich comme relatif à « une haine forcenée de la vulgarité primant l’objectivité psychologique. » (Cahiers du cinéma, n°51, octobre 1955). Pour justifiable qu’elle soit, la réflexion trufaldienne se doit d’être nuancée. La vulgarité honnie par Aldrich ne tire pas vers un quelconque rejet de la forme. On doit mentionner à ce propos le travail du chef-opérateur Ernest Laszlo. Collaborateur de Aldrich sur sept films, Laszlo confère à ses plans une dimension caricaturale qui épouse parfaitement la réflexion du film. Les grands angles et les gros plans renforcent plus qu’ils ne déforment les visages des protagonistes. Derrière cette esthétique audacieuse se dissimulent assurément quelques problématiques morales. On rejoint alors l’esprit de la fable, la représentation prenant valeur de discours. Aldrich, lui, coupe, cisaille, fétichise son plan. Les jambes courant sur l’asphalte font écho aux lignes blanches délimitant l’espace. Le cinéaste fonctionne par métonymie, la partie pour le tout. Comme Allan Dwan le fera quelques années plus tard dans Deux rouquines dans la bagarre (Slightly Scarlet, 1956), les jambes tronquées marquent la menace. Un élément du décor vient amputer une partie du corps, le cadre fonctionnant par cases distinctes mais néanmoins concomitantes. Peut-on alors réellement parler d’ « objectivité psychologique » ? Aldrich appuie au contraire la subjectivité malade de ses personnages. La vivacité toute relative de Mike Hammer fonctionne par à-coups, un peu à la manière d’une arme qui s’enraye ou d’une automobile qui cale. Le style d’Aldrich c’est l’onomatopée, le bruit et la fureur mis au service de la chair et du sang. La sueur perle et la voix hurle, tandis que la respiration haletante scande un rythme tout intérieur que souligne la bande-sonore du film. La musique traverse les espaces et les plans, configure des raccords en apparence aussi hasardeux que les notes improvisées du jazz-man.
L’argument narratif est bel et bien dépassé. À l’enquête plutôt terre à terre se substitue la virulence céleste d’une poésie épique. Tout brûle à la fin d’En quatrième vitesse. Tant mieux. Le dénouement n’en sera que plus tragique encore.
Enregistrer








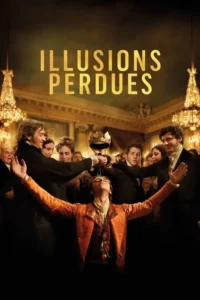
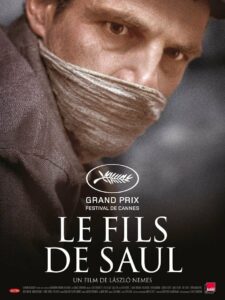





Soyez le premier a laisser un commentaire