Pedro Almodovar, le Festival de Cannes le connaît bien. Membre du jury en 1992, voilà le réalisateur espagnol catapulté président pour cette nouvelle édition. Il faut dire qu’en dix-sept ans, Almodovar a participé six fois à la compétition. En 1999, première nomination et premier prix (celui de la mise en scène pour Tout sur ma mère), avant de récidiver sept ans plus tard avec Volver (Prix du scénario). À vingt jour de l’ouverture du Festival, Le Mag cinéma vous propose un petit coup de projecteur sur l’œuvre de ce cinéaste hors-normes.
Le Profane et le Sacré

Né en 1949 en Castille, Pedro Almodovar entre dans le monde du travail comme employé aux Téléphones. Ses premiers projets, il les réalisent en totale indépendance, armé de sa super 8 ou d’une caméra 16mm. Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier (1978-1980), son premier long métrage professionnel s’inscrit en plein dans la tendance de la movida (mouvement culturel espagnol post-franquiste). Empreint de fougue et de liberté, son tempérament lui ouvre les portes de l’underground ibérique.
Almodovar se complait dans le profane et dérange la critique institutionnelle. Dans les ténèbres (1983) mêle religion, drogue et sexualité débridée… tout un programme que le cinéaste reprendra sans cesse. Sa culture est plus rock que pop, plus tournée vers la réalité que vers l’idéalisation des marges. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? (1984) entrelace l’enquête sociale à une veine plus surréaliste. Le succès de La Loi du désir (1986) le sacre réalisateur-phare de la communauté homosexuelle et lui permet de monter sa propre société de production, « El deseo ». Au début des années quatre-vingt-dix, sa réputation n’est plus à faire, Talons aiguilles (1991) lui permettant même de remporter le César du meilleur film étranger. Réalisateur du paradoxe, son style se veut délié, sa mise en scène démocratique. S’il accueille l’étrange à bras ouverts, quitte à le sacraliser, Almodovar sublime peu, ne tombe jamais dans l’exposition gratuite.

Le réalisateur réfléchit le parcours de ses désaxés. La question des genres rencontre sans cesse la problématique sociale. Le héros aux multiples identités de La Mauvaise éducation (2004) répond à Pepa, Lucia, Candela, Maris, Femmes au bord de la crise de nerfs (1988, plus gros succès du cinéma espagnol), autant que le quotidien des habitants des banlieues madrilènes fait écho à l’errance de la Manuela de Tout sur ma mère (1999).

Almodovar dédouble ses égéries (Carmen Maura, Cecilia Roth, Rossy de Palma, Penélope Cruz, entre autres) et ses références. De la précision de Hitchcock au raffinement des mélodrames de Cukor, en passant par les musicals de Minnelli, son œuvre s’offre comme la synthèse d’une nostalgie cinéphile (forcément subjective) et d’un humour noir typiquement espagnol (voir l’exemple de Luis Garcia Berlanga dont le magnifique Bourreau [1963] mérite d’être redécouvert).

Son goût prononcé pour l’aplat chromatique force la comparaison avec les arts plastiques. À l’instar de Robert Ledgard (Antonio Banderas), le chirurgien de La Piel que habito (2011), Almodovar travaille les chair, laque leur surface pour mieux dévoiler les apparences. Dans son excellente Histoire du cinéma espagnol (Armand Colin, 2005), Jean-Claude Seguin surnomme Almodovar le « messager de l’Espagne contemporaine ». On l’aura compris, ce sculpteur des sociétés et des anatomies revêt différents visages pour un cinéma unique, s’adaptant aux goûts changeants des époques tout en préservant sa singularité première.

Pour nos lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur l’œuvre d’Almodovar, nous leur conseillons de se reporter à l’excellent livre d’entretiens de Frédéric Strauss, Conversations avec Pedro Almodovar, publié aux éditions des Cahiers du cinéma. [amazon_link asins=’2866424735′ template=’ProductCarousel’ store=’lemagcinema-21′ marketplace=’FR’ link_id=’535db7ca-2b53-11e7-a0df-63d3afa27848′]



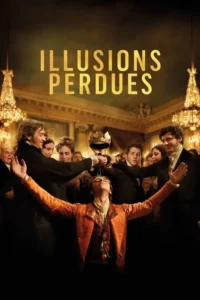
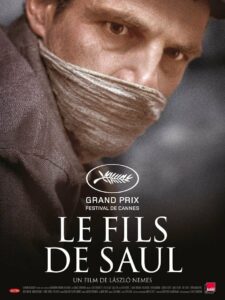




Soyez le premier a laisser un commentaire