
Sélectionné dans la catégorie « Meilleurs effets visuels », Doctor Strange (Scott Derrickson) aura supplanté l’irrévérencieux Dead Pool (Tim Miller) dans la course aux Oscars. Unique représentant de son genre, le film de Scott Derrickson aura fort à faire face à l’esprit traditionnel affiché par l’animation de Kubo et l’Armure magique (Travis Knight), l’hyperréalisme du Livre de la jungle (Jon Favreau), les titanesques déflagrations de Deepwater (Peter Berg), ou encore les vaisseaux spatiaux de Rogue One (Gareth Edwards). Cette nomination tombe à pic, nous permettant de revenir sur le dernier rejeton de l’écurie Marvel et de dresser un état des lieux du film de super-héros en ce début d’année 2017.
Logique sérielle

Décidément, tous les personnages de l’univers Marvel semblent destinés à apparaître sur le grand écran. En 2002, la sortie de Spider-Man (Sam Raimi) avait su relancer la mode des supers-pouvoirs, des capes, des collants moulants et autres mutations génétiques. La mise en scène de Sam Raimi avait fait entrer le genre dans une nouvelle ère. Se substituant aux traditionnelles matte paintings, les techniques du numérique offraient la possibilité de créer un imaginaire en accord avec les lois antigravitationnelles des mondes super-héroïques. À cette innovation technique répondait la tendance post-moderne du cinéma américain des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix nourri d’un humour au second degré, d’images et de répliques référencées. Cet ensemble d’éléments, assez originaux à l’époque, prirent rapidement la forme d’exigences codifiées dont la réitération constante fit inévitablement perdre quelque chose de leur inventivité. Logique commerciale oblige, la réussite du premier Spider-Man appela une suite, puis une autre, avant que n’arrivent en masse les procédés de la prequel, du reboot, et des rencontres en tous genres (Avengers [Joss Whedon, 2012] qui réunit certains des héros les plus populaires de l’univers Marvel, tout comme le récent Civil War [Anthony et Joe Russo, 2016], ou encore Batman v Superman [Zack Snyder, 2016] qui représente l’affrontement des deux figures emblématiques de la maison DC Comics) permettant de relancer en toute impunité des aventures pourtant déjà usées jusqu’à la corde. Ce principe n’est pas nouveau et rappelle l’approche sérielle propre aux genres du classicisme hollywoodien. On peut ainsi penser au cycle de monstres initié par la Universal au début des années trente et qui continua d’exister jusqu’au milieu des années cinquante à travers des productions plus abracadabrantesques les unes plus que les autres (voir la dégénérescence Abbott et Costello). Parmi ces nombreux films, certains chefs-d’œuvre, de nombreux ratés et quelques réussites parvenant difficilement à rehausser le niveau de l’ensemble.

À propos du cinéma fantastique, Gérard Lenne avait assez tôt remarqué que la fin d’un genre était annoncée par le développement d’une veine parodique à l’intérieur de celui-ci. La sortie de Deadpool, grotesque et graveleux à souhait, pouvait prétendre à un pareil débordement pseudo-ludique, ne se révélant en fin de compte que faussement cynique. A contrario, Doctor Strange cherche à réaffirmer la primauté de la tradition. Nouveau héros pour de nouvelles aventures ? Pas si sûr.
Synthèse brouillonne

Le personnage créé par Steve Ditko peut apparaître comme la caution métaphysique de l’univers Marvel. Nourri de théories philosophiques, le comics publié au début des années soixante, offrait à son lecteur un univers visuel détonnant dans lequel la dualité de l’esprit et de la matière jouait à plein. Plutôt que de s’attarder sur les possibilités cinétiques offertes par son modèle, la production de Scott Derrickson reprend les formules éculées du genre sans les approfondir pour autant. La figure du Docteur Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) rappelle celle de Tony Stark, le génial inventeur d’Iron Man, le charisme de Robert Downey Jr. en moins ; la dimension mystique imprégnant son parcours renvoie tour à tour aux films d’arts martiaux et à l’univers syncrétique de Star Wars ; tandis que l’atmosphère cosmique du sujet lorgne du côté du Thor de Kenneth Branagh (2011). La comparaison avec ce dernier film s’arrête là. Car si la production de Branagh avait intelligemment su développer le motif du basculement inter-mondes, celle de Derrickson n’offre aucune passerelle sensible, sinon un cheminement instable, maladroit, voire à certains moments chaotique. Pas sûr que la faute soit totalement imputable au réalisateur. Doctor Strange veut bien faire, trop bien faire pour ne pas laisser apparaître les intentions des producteurs à l’origine du projet. Se révèle ici certains impératifs inhérents au film de super-héros. Ou bien celui-ci profite du tempérament artistique d’un cinéaste-auteur à la personnalité marquée (exemple de Sam Raimi, de Kenneth Branagh, de Ang Lee [Hulk, 2003], ou de Christopher Nolan dont les trois Batman prouvaient s’il le fallait encore que chez lui le minimalisme rime presque toujours avec pauvreté visuelle), ou bien la faible popularité de la bande-dessinée adaptée permet de s’éloigner de son sujet pour créer une production en tout point originale (exemple des Gardiens de la Galaxie [James Gunn, 2014] qui aura su exploiter avec brio les potentialités musicales du soap opera). Entre les deux, difficile de trouver sa place sans tomber dans l’académisme. Un écueil auquel Doctor Strange n’aura su, ou pu, échapper.
Un film d’animateurs

Restent donc ces fameux « effets visuels » qui valurent au film de Derrickson sa nomination aux Oscars. Saluons sur ce point le travail des animateurs de Industrial Light & Magic (ILM) qui prouvent une fois encore leur excellence en matière de post-production. Celle-ci dépasse l’argument du film pour émailler sa structure de moments convoquant une certaine plénitude visuelle propre à l’effet clip. On retiendra ainsi cette première séquence hypnotique où des centaines de mains viennent contaminer l’espace du plan, un passage happant pendant un moment l’attention du spectateur.
Réduite à peau de chagrin, l’histoire invite, sans forcément le vouloir, à de pareilles béances esthétiques. On est pas loin de l’atmosphère surréaliste des films expérimentaux de Jean Cocteau, les formes de synthèse habitant l’inconscient de Stephen Strange n’ayant rien à envier au château de La Belle et la Bête (1946) ou aux reflets d’Orphée (1950). Le travail d’ILM retrouve l’énergie pop qui accompagna les premières publications du tandem Stan Lee–Jack Kirby au cours des années soixante (Les Quatre Fantastiques ; Hulk ; Thor ; Les X-Men) et qui continue de travailler de l’intérieur leurs adaptations cinématographiques les plus contemporaines. Les effets visuels entraînent une réflexion sur l’image, sa surface et sa possible pénétration. Débarrassés de leurs enveloppes charnelles, les corps lévitent, traversent les murs, luttent dans l’infra- du cadre. Démultiplié de l’intérieur, le plan s’ouvre et rappelle certaines propriétés consubstantielles à l’image cinématographique. Tous ces éléments constituent à eux seuls une unité, un microcosme à part, préférable à l’ensemble du métrage. De ce point de vue, que reste-t-il alors ? Un film d’animateurs sans doute. Un grand film, assurément.

Pour en savoir plus sur le sujet, on se reportera utilement à la lecture du numéro de la Collection Théorème dirigée par Claude Forest consacré aux super-héros et à leurs mutations cinématographiques.
[amazon_link asins=’2878544609′ template=’ProductCarousel’ store=’lemagcinema-21′ marketplace=’FR’ link_id=’453210c7-f836-11e6-b522-15c4bb85d563′]



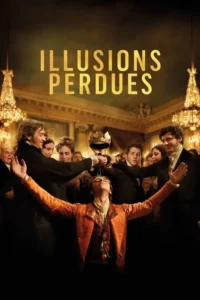
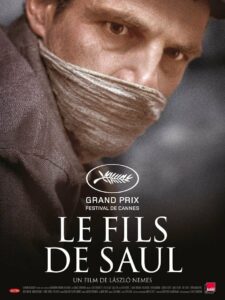



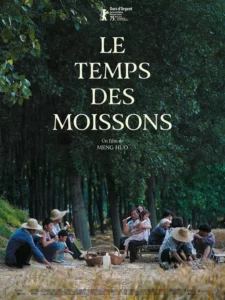

Soyez le premier a laisser un commentaire