Jean-Luc Godard, comme chacun sait, avant de devenir le cinéaste que le monde entier reconnaît comme l’un des maîtres incontestés, utilisait sa plume pour analyser les films, transmettre sa passion du cinéma. Ce n’est peu dire que Godard était un cinéphile convaincu, lorsqu’il officiait aux cahiers du cinéma. Aussi, alors que ces derniers vivent des temps terribles, nous republions un écrit de Godard au sujet de Bergman. Vous pourrez constater que Godard, le critique, préfigurait Godard, le cinéaste. Son point de vue est essentiellement sensible, il utilise des grilles de lecture et d’analyse qui laissent une large place à l’interrogation, à la magie; il transmet une passion, s’émerveille lui même de la variété des cinémas, questionne ses propres goûts, et utilise la comparaison pour mieux cerner ce qui le saisit. Relire ses critiques nous conforte dans notre propre chemin, critiquer un film, c’est avant toute chose parler de ce que l’on a vu, de ce que l’on a ressenti, tenter d’appliquer une grille de lecture appropriée et proposer une analyse, dans laquelle certains se retrouveront, d’autres moins. Se remettre en cause également, affiner son jugement, ne pas le sacrifier à des raccourcis, sentir son époque enfin, détecter le novateur, la copie, l’ambition, le talent … comme lui, nous cherchons chaque jour à cerner les mystères qui peuvent faire dire « ça, c’est du cinéma«
Bergmanorama
Dans l’histoire du cinéma, il y a cinq ou six films dont on aime à ne faire la critique que par ses seuls mots : « C’est le plus beau des films ! » Parce qu’il n’y a pas plus bel éloge. Pourquoi parler, en effet, plus longuement de Tabou, Voyage en Italie, ou du Carrosse d’or ? Comme l’étoile de mer qui s’ouvre et qui se ferme, ils savent offrir et cacher le secret d’un monde dont ils sont à la fois l’unique dépositaire et le fascinant reflet. La vérité est leur vérité. Ils la portent au plus profond d’eux-mêmes, et, cependant, l’écran se déchire à chaque plan pour la semer à tous vents. Dire d’eux c’est le plus beaux des films, c’est tout dire. Pourquoi ? Parce que c’est comme ça. Et ce raisonnement enfantin, le cinéma seul peut se permettre de l’utiliser sans fausse honte. Pourquoi ? Parce qu’il est le cinéma. Et que le cinéma se suffit à lui-même. De Welles, d’Ophüls, de Dreyer, de Hawks, de Cukor, même de Vadim, pour vanter leurs mérites, il nous suffira de dire : c’est du cinéma ! Et quand le nom de grands artistes des siècles passés vient par comparaison sous notre plume, nous ne voulons rien dire d’autre. Imagine-t-on, par contre, un critique vantant la dernière oeuvre de Faulkner en disant : c’est de la littérature ; de Stravinsky, de Paul Klee : c’est de la musique, c’est de la peinture ? Encore bien moins, d’ailleurs, de Shakespeare, Mozart ou Raphaël. Il ne viendra pas davantage à l’idée d’un éditeur, fût-ce Bernard Grasset, de lancer un poète par le slogan : ça, c’est de la poésie ! Même Jean Villar, lorsqu’il rafistole Le Cid, rougirait de mettre sur les affiches : ça, c’est du théâtre ! Alors que « ça, c’est du cinéma ! » mieux que le mot de passe, reste le cri de guerre du vendeur, tout aussi bien que de l’amateur de films. Bref, d’entre tous ses privilèges, le moindre, pour le cinéma, n’est certes pas d’ériger en raison d’être sa propre existence, et faire, par la même occasion, de l’éthique son esthétique. Cinq ou six films, ai-je dit, + 1, car Sommarlek est le plus beau des films.
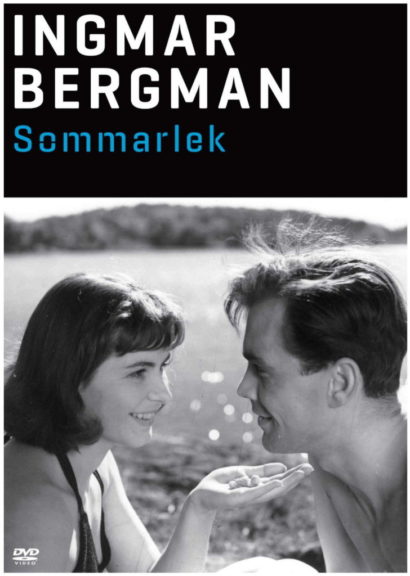
Le dernier grand romantique
Les grands auteurs sont probablement ceux dont on ne sait que prononcer le nom lorsqu’il est impossible d’expliquer autrement les sensations et sentiments multiples qui vous assaillent dans certaines circonstances exceptionnelles, devant un paysage étonnant, ou lors d’un événement imprévu : Beethoven, sous les étoiles, en haut d’une falaise battue par la mer ; Balzac, quand, vu depuis Montmartre, il semble que Paris vous appartient ; mais désormais, si le passé joue à cache-cache avec le présent sur le visage de celle ou celui que vous aimez ; si la mort, lorsque humiliés et offensés vous parvenez enfin à lui poser la question suprême, vous répond avec une ironie toute valéryenne qu’il faut tenter de vivre ; désormais donc, si les mots été prodigieux, dernières vacances, éternel mirage, reviennent sous lèvres, c’est qu’automatiquement vous avez prononcé le nom de celui qu’une deuxième rétrospective à la Cinémathèque française vient définitivement, pour ceux qui n’avaient vu que quelques-uns de ses dix-neuf films, de consacrer comme l’auteur le plus original du cinéma européen moderne : Ingmar Bergman.

Original ? Le Septième sceau ou La Nuit des forrains, passe ; à la rigueur Sourires d’une nuit d’été ; mais Monika, mais Rêves de femmes, mais Vers la félicité, tout au plus du sous Maupassant, et quant à la technique, parlons-en, des cadrages à la Germaine Dulac, des effets à la Man Ray, des reflets dans l’eau à la Kirsanoff, des retours en arrière comme il n’est plus permis d’en faire tellement c’est démodé : « non, le cinéma, c’est autre chose« , s’écrient nos techniciens patentés ; et, d’abord, c’est un métier.
Hé bien, non ! le cinéma n’est pas un métier. C’est un art. Ce n’est pas une équipe. On est toujours seul ; sur le plateau comme devant la page blanche. Et pour Bergman, être seul, c’est poser des questions. Et faire des films, c’est y répondre. On ne saurait être plus classiquement romantique.
Certes, de tous les cinéastes contemporains, il est sans doute le seul à ne pas renier ouvertement les procédés chers aux avant-gardistes des années trente, tels qu’ils traînent encore dans chaque festival de films expérimentaux ou d’amateurs. Mais c’est plutôt hardiesse de la part du metteur en scène de la Soif, car, ce bric-à-brac, Bergman le destine en parfaite connaissance de cause à d’autres fins. Ces plans de lacs, de forêts, d’herbes, de nuages, ces angles faussement insolites, ces contre-jours trop recherchés, ne sont plus dans l’esthétique bergmanienne des jeux abstraits de la caméra ou des prouesses de photographe ; ils s’intègrent, au contraire, dans la psychologie des personnages à l’instant précis où il s’agit, pour Bergman, d’exprimer un sentiment non moins précis ; par exemple, le plaisir de Monika traversant en bateau Stockholm qui s’éveille, puis sa lassitude en inversant le trajet dans Stockholm qui s’endort.

L’éternité au secours de l’instantané
A l’instant précis. En effet, Ingmar Bergman est le cinéaste de l’instant. Chacun de ses films naît dans une réflexion des héros sur le moment présent, approfondit cette réflexion par une sorte d’écartèlement de la durée, un peu à la manière de Proust, mais avec plus de puissance, comme si l’on avait multiplié Proust à la fois par Joyce et Rousseau, et devient finalement une gigantesque et démesurée méditation à partir d’un instantané. Un film d’Ingmar Bergman, c’est, si l’on veut, un vingt-quatrième de seconde qui se métamorphose et s’étire pendant une heure et demi. C’est le monde entre deux battements de paupières, la tristesse entre deux battements de cœur, la joie de vivre entre deux battements de mains.
D’où l’importance primordiale du « flash-back » dans ces rêveries scandinaves de promeneuses solitaires. Dans Sommarlek, il suffit d’un regard à son miroir pour que Maj Britt Nilsson parte comme Orphée et Lancelot à la poursuite du paradis perdu et du temps retrouvé. Utilisé quasi systématiquement par Bergman dans la plupart de ses œuvres, le retour en arrière cesse alors d’être l’un de ces « poor tricks » dont parlait Orson Welles pour devenir, sinon le sujet même du film, du moins sa condition sine qua non. Par-dessus le marché, cette figure de style, même employée comme telle, a dorénavant l’avantage incomparable d’étoffer considérablement le scénario, puis qu’aussi bien elle ne constitue et le rythme interne et l’ossature dramatique. Il n’est que d’avoir vu n’importe lequel des films de Bergman pour remarquer que chaque retour en arrière s’achève ou débute toujours « en situation », en double situation devrais-je dire, car le plus fort est que ce changement de séquence, comme chez Hitchcock au meilleur de sa forme, correspond toujours à l’émoi intérieur des héros, autrement dit, provoque le rebondissement de l’action, ce qui est l’apanage des plus grands. Nous prenions pour de la facilité ce qui n’était qu’un surcroît de rigueur. Ingmar Bergman, l’autodidacte décrié par « ceux du métier« , donne ici une leçon aux meilleurs de nos scénaristes. Nous allons voir que ce n’est pas la première fois.
Toujours en avance
Quand parut Vadim, nous l’applaudîmes d’être à l’heure juste alors que la plupart de ses confrères retardaient encore d’une guerre. Quand nous vîmes les grimaces poétiques de Giulietta Massina, nous applaudîmes de même Fellini dont la fraîcheur baroque sentait bon le renouveau. Mais cette renaissance du cinéma moderne, cinq années plus tôt, le fils d’un pasteur suédois l’avait déjà portée à son apogée. A quoi rêvions-nous donc quand sortit Monika sur les écrans parisiens ? Tout ce que nous reprochions encore de ne pas faire aux cinéastes français, Ingmar Bergman l’avait déjà fait. Monika, c’était déjà Et Dieu créa la femme, mais réussi de façon parfaite. Et ce dernier plan des Nuits de Cabiria, lorsque Giulietta Massina fixe obstinément la caméra, avons-nous oublié qu’il est déjà, lui aussi, dans l’avant-dernière bobine de Monika ? Cette brusque conspiration entre le spectateur et l’acteur qui enthousiasme si fort André Bazin, avons-nous oublié que nous l’avions vécue avec mille fois plus de force et de poésie, lorsque Harriett Andersson, ses yeux rieurs tout embués de désarroi rivés sur l’objectif, nous prend à témoin du dégoût qu’elle a d’opter pour l’enfer contre le ciel. N’est pas orfèvre qui veut. N’est pas en avance sur les autres qui le crie sur les toits. Un auteur véritablement original est celui qui ne déposera jamais ses scénarii à la société du même nom. Car est neuf, nous prouve Bergman, ce qui est juste, et sera juste ce qui est profond.

Or, la profonde nouveauté de Sommarlek, de Monika, de la Soif, du Septième Sceau, c’est d’être avant tout d’une admirable justesse de ton. Pour Bergman, certes, oui, un chat est un chat. Mais il l’est pour bien d’autres, et c’est là la moindre des choses. L’important est que, doué d’une élégance morale à toute épreuve, Bergman peut s’accommoder de n’importe laquelle des vérités, même la plus scabreuse (le dernier sketch de l’Attente des femmes). Est profond ce qui est imprévisible, et chaque nouveau film de notre auteur déroute souvent les plus chauds partisans du précédent. On attendait une comédie, et ce fut un mystère du moyen âge qui survint. Leur seul point commun est souvent cette incroyable liberté des situations à laquelle Feydeau rendrait des points, tout comme Montherlant pourrait en rendre à la vérité des dialogues, au moment d’ailleurs, suprême paradoxe, ou Giraudoux ferait de même quant à leur pudeur. Il va sans dire que cette aisance souveraine dans l’élaboration du manuscrit se double, dès que ronronne la caméra, d’une maîtrise absolue dans la direction des acteurs. Ingmar Bergman, en ce domaine est l’égal d’un Cukor ou d’un Renoir. Certes, la plupart de ses interprètes, qui font d’ailleurs quelquefois partie de sa troupe théâtrale, sont en général de remarquables comédiens. Je pense surtout à Maj-Britt Nilsson, dont le menton volontaire et les moues de mépris ne sont pas sans rappeler Ingmar Bergman. Mais il faut avoir vu Birger Malmsten en jouvenceau rêveur dans Sommarlek, et le retrouver, méconnaissable, en bourgeois gominé dans la Soif ; il faut avoir vu Gunnar Björnstrand et Harriett Anderson dans le premier épisode de Rêves de femmes, et les retrouver, avec un autre regard, de nouveaux tics, un rythme du corps différent dans Sourires d’une nuit d’été, pour se rendre compte du prodigieux travail de modelage dont est capable Bergman, à partir de ce « bétail » dont parlait Hitchcock.
Bergman contre Visconti
Ou scénario contre mise en scène. Est-ce si sûr ? On peut opposer un Ales Joffé et un René Clément par exemple, car il n’est question que de talent. Mais quand le talent frôle de si près le génie qu’on obtient Sommarlek et Nuits blanches, est-ce bien utile de disserter à perte de vue pour savoir qui est en fin de compte supérieur à l’autre, l’auteur complet ou le pur metteur en scène ? Peut-être que oui, après tout, car c’est analyser deux conceptions du cinéma dont l’une vaut peut-être mieux que l’autre.

Il y a, en gros, deux genres de cinéastes. Ceux qui marchent dans la rue la tête baissée et ceux qui marchent la tête haute. Les premiers, pour voir ce qui ce passe autour d’eux, sont obligés de relever souvent et soudain la tête, et de la tourner tantôt à gauche, tantôt à droite, embrassant d’une série de coups d’oeils le champ qui s’offre à leur vue. Ils voient. Les seconds ne voient rien, ils regardent, fixant leur attention sur le point précis qui les intéressent. Lorsqu’ils tourneront un film, le cadrage des premiers sera aéré, fluide (Rossellini), celui des seconds serré au millimètre (Hitchcock). On trouvera chez les premiers un découpage sans doute disparate mais terriblement sensible à la tentation du hasard (Welles), et chez les seconds des mouvements d’appareils, non seulement d’une précision inouïe sur le plateau, mais qui ont leur propre valeur abstraite de mouvement dans l’espace (Lang). Bergman ferait plutôt partie du premier groupe, celui du cinéma libre. Visconti, du second, celui du cinéma rigoureux.
Pour ma part, je préfère Monika à Senso, et la politique des auteurs à celles des metteurs en scène. Que Bergman, en effet, plus qu’aucun cinéaste européen, Renoir excepté, en soit le plus typique représentant, à qui en douterait encore, La Prison lui en apporterait sinon la preuve, du moins le symbole le plus évident. On connaît le sujet : un metteur en scène se voit proposer par son professeur de mathématiques un scénario sur le diable. Pourtant, ce n’est pas à lui que surviendront des séries de mésaventures diaboliques, mais bien à son scénariste auquel il a demandé une continuité. Homme de théâtre, Bergman admet de mettre en scène les pièces des autres. Mais homme de cinéma, il entend rester seul maître à bord. Au contraire d’un Bresson et d’un Visconti qui transfigurent un point de départ qui leur est rarement personnel. Bergman crée ex nihilo aventures et personnages. Le Septième Sceau est moins habilement mis en scène que Nuits blanches, ses cadrages sont moins précis, ses angles moins rigoureux, nul ne le niera ; mais, et là est le point capital de la distinction, pour un homme d’un talent aussi immense que Visconti, faire un très bon film, en fin de compte, est affaire de très bon goût. Il est sûr de ne pas se tromper, et dans une certaine mesure, c’est facile. Il est facile de choisir les rideaux les plus jolis, les meubles les plus parfaits, de faire les seuls mouvements d’appareil possibles, si l’on sait d’avance que l’on est doué pour ça. De la part d’un artiste, trop bien se connaître, c’est un peu céder à la facilité.
Ce qui est difficile au contraire, c’est d’avancer en terre inconnue, de reconnaître le danger, de prendre des risques, d’avoir peur. Sublime est l’instant, dans Nuits blanches où la neige tombe à gros flocons autour de la barque de Maria Schell et Marcello Mastroianni ! Mais ce sublime-là n’est rien à côté du vieux chef d’orchestre de Vers la félicité qui, allongé sur l’herbe, regarde Stig Olin regardant amoureusement Maj-Britt Nilsson sur sa chaise longue, et pense : « Comment décrire un spectacle d’une si grande beauté ! » J’admire Nuits blanches, mais j’aime Sommarlek.
Cahiers du cinéma n° 85 – juillet 1958
source : La politique des auteurs – Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma – 2001






Soyez le premier a laisser un commentaire