Mis à jour le 23 décembre, 2017
Comme pour ses cinéastes de chevet, Bertrand Tavernier consacre deux épisodes de sa série documentaire Voyages à travers le cinéma français à des réalisateurs oubliés ou méconnus. L’exercice qui consistait à distinguer les premiers des seconds était délicat et l’emmena à faire des choix arbitraires. Nous avons donc jugé opportun de vous livrer notre synthèse des épisodes 6 et 7 dans une unique publication.
En huit épisodes – près de sept heures et demie de projection -, Bertrand Tavernier, cinéaste-cinéphile, poursuit sa plongée dans le cinéma français des années 1930 à 1970, entamée en 2016 avec son film Voyage à travers le cinéma français.
Les cinéastes oubliés
Bertrand Tavernier porte son attention sur cinq cinéastes oubliés et consacre à chacun d’eux un exposé d’une dizaine de minutes.
La filmographie de Maurice Tourneur a, par son originalité, égalé en influence celle de David W. Griffith. Dès 1932, Au nom de la loi et Les gaités de l’escadron surprenaient par leur précision documentaire des faits relatés. En 1935, Tourneur jouait sur les ruptures de tons en mêlant comédie, néoréalisme et scènes de film noir dans Justin de Marseille. Un an plus tard, le portrait amoral et insidieux d’un arriviste cynique incarné par Maurice Chevallier titré Avec le sourire était fait du même alliage. Tavernier indique ici que le scénario de ce film avait été écrit par Carlo Rim. Louis Verneuil crédité scénariste au générique n’était l’auteur que de quelques paragraphes du script.
Anatole Litvak a signé plusieurs réussites dont Le traitre (1951), évocation crépusculaire de la chute de l’Allemagne nazie. Entre 1942 et 1945, il contribua aux côtés de Frank Capra à la réalisation de plusieurs épisodes de la série documentaire Pourquoi nous combattons. Et, alors que tous ses films américains avaient été écrits par des scénaristes communistes ou progressistes, il fut contraint de quitter les États-Unis au début du maccarthysme.
De la période française de Litvak, Tavernier retient notamment Cœur de Lilas (1932) mais aussi L’équipage (1935), la première des cinq collaborations du cinéaste avec Joseph Kessel. Dans le premier, la mise en scène très inventive joue avec les sons comme celle de Jean Renoir dans La chienne (1931). Les longs travellings en extérieur étaient la marque de fabrique du cinéaste qui, selon Elia Kazan, avait été le seul à avoir su les imposer à la Warner des années 30. Litvak avait aussi pour habitude de ne jamais déléguer à son chef-opérateur le choix des angles et des cadres. Les remarquables séquences de combats aériens de L’équipage témoignent encore aujourd’hui de son savoir-faire.
Tavernier ne tarit pas d’éloges à l’évocation de Raymond Bernard. Les croix de bois (1932) est une œuvre exceptionnelle au réalisme dépouillé, sans pittoresque, sans longues tirades mais avec des faits, des images et… des sons qui créent l’atmosphère sonore de la guerre. Ici, Raymond Bernard innovait en insérant des bruits d’explosion entre les mots prononcés par des acteurs qui avaient quasiment tous fait la première Guerre Mondiale. Les séquences d’attaques nocturnes figurent parmi les plus grandes scènes de guerre de l’histoire du cinéma.
Tavernier considère que Les misérables (1934) est la meilleure adaptation à l’écran du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Ce film est porté par un casting idéal : Harry Baur, Charles Vanel et les Thénardier campés par Charles Dullin et Marguerite Moreno. Et, au-delà de quelques cadrages obliques, son « péché mignon », Raymond Bernard se montrait très inspiré dans de nombreuses scènes dont certaines filmées à la main (enterrement du général, prise des barricades).
Le traitement réservé à René Clair est plus synthétique. Il prend corps dans les beaux mouvements d’appareil observés dans Sous les toits de Paris (1930). Il se poursuit dans un Paris populaire désormais disparu filmé dans 14 juillet (1932). Le portrait de ce cinéaste « officiel » vu avec « condescendance » trouve un prolongement dans celui de Georges van Parys. Ce dernier avait composé plusieurs musiques pour Clair dont celles du Million (1931) et les variations sur une gamme ascendante qui ornent Les belles de nuit (1952). Parmi les compositions les plus célèbres de ce mélodiste et parolier, Tavernier cite les musiques de Casque d’or (1952, Jacques Becker), Madame de… (1953, Max Ophuls) et Les diaboliques (1955, Henri-Georges Clouzot).
Georges van Parys avait aussi collaboré avec Jean Boyer. Dans Circonstances atténuantes (1939), il écrivit la mélodie qui accompagna la chanson Comme de bien entendu restée célèbre et dont l’auteur des paroles n’était autre que le cinéaste lui-même.
Discrédité par une fin de carrière « paresseuse », Boyer n’en reste pas moins un excellent metteur en scène de comédies, souvent musicales. Parmi ses meilleures réussites, Tavernier retient plus particulièrement Un mauvais garçon (1936), Prends la route (1937) et Nous irons à Paris (1950).
Les cinéastes méconnus
Tavernier introduit l’épisode consacré aux cinéastes méconnus par une scène de La terre qui meurt, deuxième film en couleur de l’histoire du cinéma français. Ce long-métrage fut réalisé en 1936 par Jean Vallée, déjà auteur un an plus tôt et toujours en couleur de Jeune fille à marier. Les images de La terre qui meurt obtenues par l’utilisation du procédé Francita sont étonnantes. Elles paraissent beaucoup plus modernes que celles des films en couleur des années 40 et 50. Les photogrammes, le ton quasi documentaire du film et la qualité des dialogues écrits par Charles Spaak servent une autre modernité, celle d’un propos toujours très actuel sur le monde paysan. Outre Vallée, Tavernier évoque trois autres réalisateurs méconnus.
Pierre Chenal était metteur en scène, scénariste mais aussi fin cinéphile. En 1937, il réalise deux films notables : L’alibi où il confronte de façon inattendue Louis Jouvet à Erich von Stroheim et L’homme de nulle part dont certaines scènes anticipent le néoréalisme italien. Mais Tavernier met en avant aussi et surtout le remarquable Rafles sur la ville (1958) qui fait partie des meilleurs films noirs des années 50. Michel Piccoli y endosse un rôle singulier alors que Charles Vanel y joue, à contre-emploi, un tueur dénué de tout scrupule sur une partition très jazz écrite par Michel Legrand.
Concernant Henri Calef, Tavernier souligne le caractère collectif de son long-métrage Jericho réalisé en 1946. Ce film sans personnage principal est peuplé d’une quarantaine de rôles parlants. Chaque destin individuel, depuis les résistants jusqu’aux collaborateurs, est pris en compte. L’heure de la vérité (1964) est le film pendant de Jericho. Le scénario coécrit par Henri Calef, Maurice Clavel et Edgar Morin (et dialogues sous pseudonyme) étonne par son sujet et par le rapport bourreau / victime mis en scène. Enfin, Bagarres (1948) cache sous son mauvais titre une belle réussite, celle d’un film rigoureux, âpre au ton dur et noir.
Enfin, Tavernier note que Gilles Grangier privilégiait dans ses films le volontarisme face à la dureté. Il prêtait une attention particulière à la description des milieux populaires. Ses longs-métrages forment un corpus très différent des films policiers de l’époque. Ainsi, Le sang à la tête (1956) constitue une des plus remarquables adaptations d’un roman (ici, Georges Simenon) au cinéma. Pour sa part, Alain Corneau tenait Le désordre et la nuit (1958) pour un des étalons-or du cinéma noir français. Il est vrai que ce film ambitieux et tendu porté par Jean Gabin exploite avec brio une vraie histoire d’amour marquée par la drogue et des soupçons de crimes.
Avant l’avènement d’Agnès Varda, Tavernier ne dénombre que cinq réalisatrices dans le cinéma parlant français mais seule Jacqueline Audry est nommément citée et fait l’objet d’un traitement. Longtemps sous-estimée, elle fut la seule cinéaste à aborder sans tabou l’insatisfaction sexuelle féminine. Ainsi, sous des dehors policés, Olivia (1951) cache les scènes les moins prudes du cinéma français de l’époque. Enfin, Tavernier souligne l’unicité des très beaux plans de chevauchées nocturnes ou crépusculaires de La caraque blonde (1953). Ce drame paysan emprunte volontiers aux codes du western. Une courte attention est accordée à la réalisatrice Nelly Kaplan et à son premier film fracassant, La fiancée du pirate (1969).






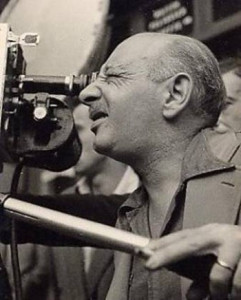
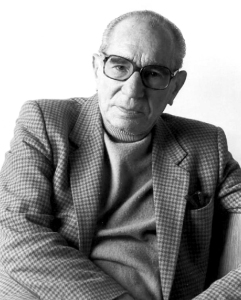
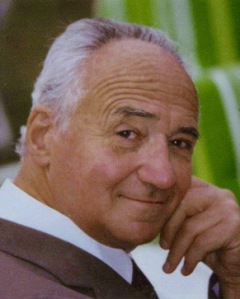









Soyez le premier a laisser un commentaire