Mis à jour le 29 mai, 2016
Devenu un genre à part entière, le film de zombies semble avoir atteint les limites de son invasion cinématographique. Récupérée par la culture mainstream (World War Z, Marc Forster, 2013), parodiée (dès 1985 avec Le retour des morts-vivants de Dan O’Bannon et le plus récent Bienvenue à Zombieland réalisé en 2009 par Ruben Fleischer), la figure du mort-vivant s’est progressivement vidée de la substance théorique qu’avait su lui octroyer l’indétrônable George A. Romero. Mais si le zombie est devenu une formule préconçue, il ne faut pas oublier que les règles d’un genre sont justement conçues pour être transgressées, le spectateur tirant son plaisir de la variation et non d’une application systématiques de codes et de structures. L’espoir est encore permis comme nous le prouve The Battery, premier film de l’acteur-réalisateur Jeremy Gardner. Privée de sortie en salles, cette production indépendante nous arrive avec un an de retard à la faveur d’une édition DVD proposée par Zylo.
Une production déterminante
La genèse de The Battery n’est pas sans rappeler celle de La Nuit des morts-vivants réalisé en 1968 par un certain Romero. Avec ses 6000 dollars de budget, difficile de faire plus fauché, un manque qui se révèle être un avantage par l’obligation donnée au cinéaste de réfléchir chacun de ses plans selon leur nécessité dramatique et esthétique. À l’image de Ben, le personnage qu’il incarne dans le film, Jeremy Gardner se doit d’être pragmatique, fonctionnel, sans oublier sa part créative incarnée par Mickey (Adam Cronheim), rêveur mélancolique répétant inlassablement des gestes devenus inutiles. À défaut de matériel, c’est une caméra portée à l’épaule qui suit les deux protagonistes. Gardner a su éviter la facilité du found footage, dispositif rarement efficace dans le domaine du fantastique. Le mouvement est continu, heurté, obligé comme le quotidien de Ben et Mickey, anciens joueurs de baseball devenus nomades malgré-eux. Budget oblige les zombies sont rares, ce qui permet au cinéaste d’orienter son film vers la problématique trop souvent oubliée du survivant.
L'(im)mobilité
L’un des principaux tropes du film de zombies est d’opposer l’humain au monstre, soit à une image de lui-même réfléchie par la mort et son insupportable survivance. Mais quand le mort fait défaut, que reste-t-il ? Le vivant, seul dans un cadre privé de toute présence. Le voyage connote habituellement la liberté d’un choix, celui du mouvement. Or celui-ci est justement imposé aux deux héros rendant toute sédentarisation et toute attache impossibles. À l’inverse de la plupart des films de zombies, le groupe se réduit ici à un binôme, une équipe trop réduite pour prétendre à la reconstruction d’une civilisation. La présence de l’Autre se résume à une photographie, à l’odeur d’un parfum, à des objets sans valeur car désincarnés. Poussé à ses limites, Mickey fixera son désir sur une voix évanescente, une fréquence fantasmatique captée sur son talkie-walkie. Le mort-vivant symbolise cette perte, pur corps-surface sur lequel aucune pensée, aucune émotion ne peut plus se projeter.
La mobilité sera finalement empêchée. Cloisonnés dans leur voiture, les deux personnages observent l’espace obstrué par la mort stagnante. Ultime subtilité permise par les contingences, Gardner utilisera le hors champ comme lieu du dénouement. L’appel à la suggestivité se révèle efficace, un peu à la manière des séries B de Jacques Tourneur. Gardner prouve une fois encore son aptitude à profiter des références offertes par le cinéma, entendu en son sens topographique.
De la mobilité à l’immobilité, l’espace se réduit jusqu’à son absolution. La lumière inonde le cadre et efface le champ. Le survivant doit alors pénétrer dans un territoire inédit, défiant les lois de la physique. La frontière est franchie, pour lui d’abord, mais pour le film de zombies avant tout.







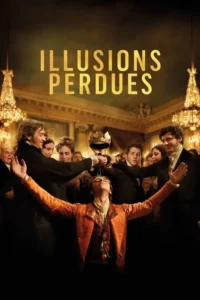
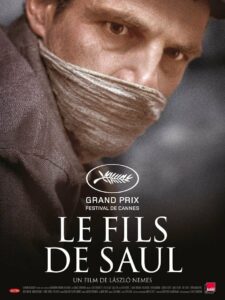

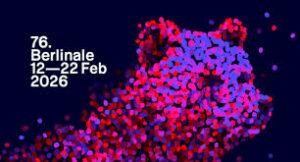
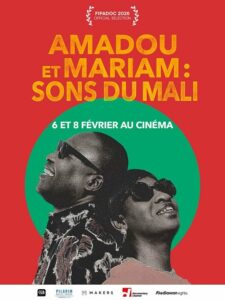


Soyez le premier a laisser un commentaire