Mis à jour le 26 février, 2025
Un film de Brady Corbet
Avec: Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Emma Laird, Jonathan Hyde
Lorsque l’architecte visionnaire László Toth et sa femme Erzsébet fuient l’Europe pour reconstruire leur héritage et assister à la naissance de l’Amérique moderne, leur vie est changée à jamais par un mystérieux et riche client.
Notre avis: **(*)

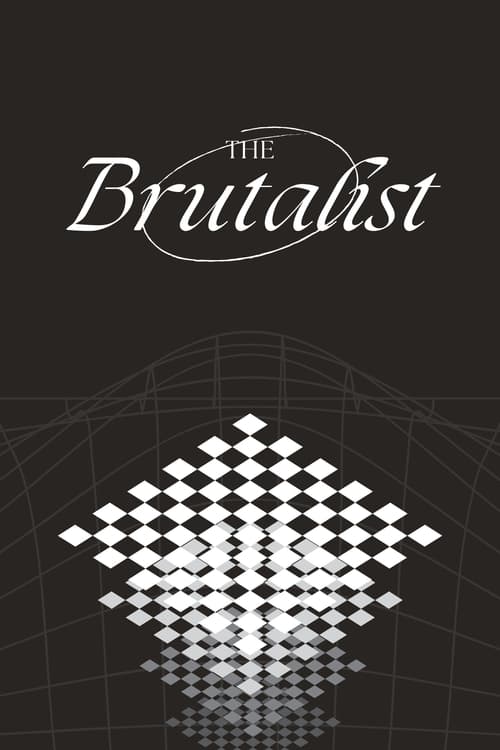



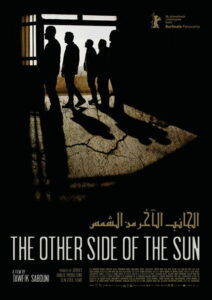




Soyez le premier a laisser un commentaire