Mis à jour le 15 février, 2025
Un film de Florian Pochlatko
Avec: Luisa-Céline Gaffron, Oliver Rosskopf, Cornelius Obonya, Elke Winkens, Felix Pöchhacker, Harald Krassnitzer, Lion Thomas Tatzber, Wesley Joseph Byrne, David Scheid, Jutta Fastian
Tout juste sortie d’un hôpital psychiatrique, Pia retourne vivre chez ses parents pour reprendre sa vie en main. Tiraillée entre un nouveau travail, le mal de l’amour, les psychotropes et la stigmatisation sociale, elle émerge dans un monde où tout semble hors de contrôle.
Notre avis: ***
Le cinéma questionne le regard. Celui du spectateur, invité à rentrer en empathie avec ce qu’il lui est donné à voir, mais peut être plus encore, à l’instar de la plupart des arts, celui de son auteur, qui d’un sujet donné, peut choisir tel ou tel angle, tel ou tel point de vue, quand il ne choisit tout simplement pas de ne pas livrer son point de vue. Cette question se prolonge plus encore à considérer la frontière, souvent mince, entre documentaire et fiction, puisque un documentaire sélectionne des images, les manipule au montage, les commente – ou pas, et en cela, constitue une fiction reconstruite à partir d’images prises ici ou là, au même titre qu’une fiction s’évertue à construire des images pour servir l’oeuvre, mettre en lumière tel ou tel élément, qu’il s’agisse d’un message, d’une question, d’une émotion, ou d’une action/évènement. Le rapport au réel s’invite alors, capter le réel, le représenter, le symboliser, le fuir, ou l’interroger. Ainsi, Nicolas Philibert a pu faire sien le sujet de la psychiatrie, très très mal représenté au cinéma qui véhicule, depuis ses débuts, le mythe du fou, bien utile à des fins de divertissement (qu’il fasse rire, ou peur, qu’il émeuve ou transgresse), très loin de la réalité quotidienne, celle des patients, les psychotiques, ou plus encore, celle de l’entourage proche ou éloigne. Et ce n’est que peu dire que son regard nous a dérangé, plus encore à considérer que celui-ci est loué, tant il prend fait et cause pour un pan de la question, celui des psychiatres, et de leur combat, et manipule les patients, pour attendrir le spectateur, sans jamais se mettre à leur place, sans jamais poser les bonnes questions, celles qui concernent par exemple la société, le regard de la société, la place réservée aux psychotiques par la société, sans nuance (certains psychotiques occupent de très hautes fonctions, d’autres sont totalement inadaptés au monde du travail, laissés pour compte, et envoyés dans des asiles), ou interroger les problèmes rencontrés avec les solutions aujourd’hui mises en oeuvre, la camisole chimique, en de nombreux points critiquables (effets secondaires, parfois graves, impact sur la sociabilité, sur le rapport à la vie, sur la vivacité intellectuelle), sans jamais faire le tour de la question, en la présentant sous son entière complexité. Ces défauts majeurs, nous ne les trouvons pas dans How to be normal and the oddness of the other world de Florian Pochlatko, une fiction d’une heure trente, qui au contraire de Nicolas Philibert, qui revendique sa neutralité en avouant ne pas connaître de près le sujet, et donc une forme de virginité face au sujet, s’avère bien renseigné, précis, adresse différentes perspectives, prend le parti de mimer les voix intérieurs, les images hallucinantes, et n’oublie jamais d’impliquer les autres. Requiem for a dream, quoi qu’il ne fut pas réaliste, jeta à l’époque un pavé dans la marre des tranquillisants, How to be normal and the oddness of the other world en fait de même avec la pharmacopathée, tout en proposant un spectacle divertissant, amusant. En second plan, il questionne, avec justesse. Qui sont les fous, les vrais ? Qui bascule ? Quel mécanisme maintient dans la société, quel mécanisme exclut. Qu’apporte la psychiatrie, que propose-t-elle comme solutions, et pour quels résultats ? Et surtout, il montre la violence de ceux qui ne se considèrent pas psychotiques, entretiennent des mythes, se comportent, de manière décomplexé en garant d’un certain ordre, régit par des peurs excessives et alimentées par ces mythes, d’une manière très comparabes à celles qui mène inexorablement au fascisme, et au racisme. En posant ces questions là, le réalisateur communique son regard, et interroge le notre.


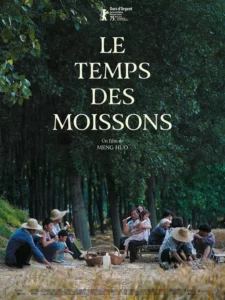
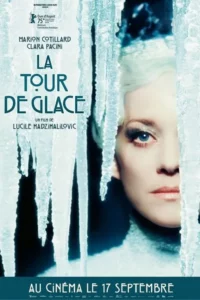
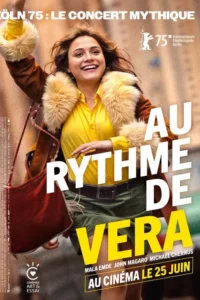

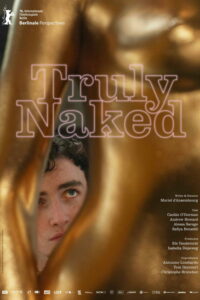

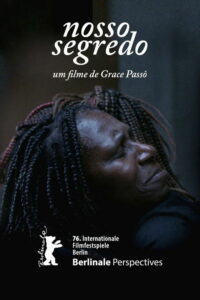

Soyez le premier a laisser un commentaire