Mis à jour le 24 février, 2025
Un film de Léonor Serraille
Avec: Andranic Manet, Pascal Rénéric, Théo Delezenne, Ryad Ferrad, Éva Lallier, Lomane de Dietrich, Mikael-Don Giancarli, Clémence Coullon
Ari, 26 ans, réussit enfin son concours de l’enseignement. Neuf mois plus tard, professeur des écoles stagiaire dans une école maternelle lilloise, il craque nerveusement en pleine séance malgré le soutien constant de Blanche, la directrice. Il se retrouve à l’hôpital et un médecin lui signe un arrêt de travail. Son père, en colère de le voir faillir, le chasse du nid familial qu’il n’a jamais quitté. Fébrile et ébranlé, traversé de visions étranges, Ari erre dans la ville et se lance malgré lui dans une suite de retrouvailles.
Notre avis: **(*)
Leonor Serraille revient à un matériau intime, très personnel et quelque peu singulier, malgré son universalisme, pour nous proposer un étrange objet. Ari naît d’une fascination pour l’œuvre (et la vie) d’Odilon Redon, plus globalement pour un vif intérêt pour la peinture, l’effet quel produit sur l’âme et réciproquement. Pour s’être interrogée de longues minutes et à de nombreuses reprises devant le tableau L’homme endormi de Caroolus-Duran (exposé au palais des beaux-arts de Lille), et son pouvoir médiatique, une évidence est née dans l’esprit de la jeune réalisatrice française, celle de nous proposer une variation (inconsciente) de Jeune Femme, en proposant cette fois-ci une trajectoire qui s’interdise toute trivialité et ose parler simplement de choses simples, la difficulté de vivre un deuil, de se sentir rejeté, la difficulté de vivre et de se confronter au regard des autres, la difficulté de trouver sa voie, la difficulté de s’exprimer librement et d’évoquer ce que l’on a sur le cœur, sans blesser autrui, juste pour rétablir un équilibre, la difficulté de se relever, malgré toutes les idées noires qui peuvent parfois traverser l’esprit quand les vents sont contraires, la nécessité de se construire, de trouver sa place, d’aimer et d’être aimer. Jeune Femme s’appuyait fortement sur Sue Perdue dans Manhattan, c’est dire, si malgré toute la pétillance de Laetitia Dosch et l’énergie qu’elle apportait à son personnage Paula, en perdition psychologique – sur le point de craquer, mais qui parvenait à faire de son malheur sa force – nous ne pouvions qu’entrer en empathie avec un personnage si libre. Un message diffus autour de l’existence traversait déjà l’esprit de Leonor Serraille, sans , pour autant, partager la vision totalement désabusée de Kollek qui n’épargnait rien au sort de Sue, de façon fataliste. Au contraire, Paula refuse la fatalité, s’en remet à sa bonne étoile, croit en ses chances, en elle, dans ce que les autres peuvent lui apporter, en son destin, aux évènements extérieurs bénéfiques, une attitude propice à son rebond intérieur. Kollek en jouait, laissant entrevoir la lumière au pire des instants, pour mieux frapper le spectateur lors du verdict final, couperet d’une rare noirceur. Ce constat morbide, cette éventualité d’une existence dont les rêves seraient brisés les uns après les autres, Serraille le réfute fermement. Elle préfère nourrir une grande foi non dans le présent, mais dans l’avenir, peu importe le poids du passé, les obstacles, traumatismes, empêchements et autres portes fermées. Ainsi, Redon se mit à peindre son deuxième fils, qui survécut au contraire du premier décédé à la naissance, en couleur quand l’ensemble de ses peintures précédentes versaient dans le sombre. Ce retour à la lumière, le destin qui prend sa revanche, voilà le sujet d’Ari, et il ne restait plus qu’à construire un personnage qui en soit le reflet, qui n’emprunte plus cette fois à la personnalité de Laetitia Dosch (Paula ressemblait à Leonor Serraille dans son parcours, mais non pas dans son caractère, nous disaient elles) mais traduise quelque chose de profond appartenant à la réalisatrice, qui se lance ici le défi de parler à cœur ouvert, comme peut le faire un enfant, qui ne se pose la question de son image, mais s’exprime simplement, livre son ressenti, nécessite les autres, cherche leur regard, et plus encore qu’un adulte, montre qu’il a besoin d’être aimé, et d’aimer. Voici un premier point de départ, et le film ouvrira par une scène très explicite, en très gros plans, montrant l’importance pour un enfant, mais aussi pour une mère, de se témoigner l’un pour l’autre une infinie tendresse, mais aussi répàndant dés le départ à la question que le spectateur se serait sans cela poser tout le long du film, pourquoi ce prénom Ari ? De l’aveu de Léonor Serraille, il n’importait pas qu’Ari soit un garçon ou une fille, l’état d’esprit précis que le film intente de traduire à l’écran, la tranche de vie narrée, touche à l’universel et peut tout aussi bien concerner un homme ou une femme. L’homme endormi, l’homme qui a laissé son cœur sortir de son corps, qui a perdu son âme d’enfant, peut à tout instant se réveiller. Cet homme prendra les traits d’Andranic Manet, une évidence qui se dégage au casting, et l’échange que nous aurons avec lui tout autant que le résultat à l’écran ne pourront que le confirmer, Andranic Manet présente cette caractéristique d’avoir en lui une gamme d’émotions allant du plus sombre au plus lumineux, de pouvoir, tel un enfant, passer rapidement d’une émotion très triste à une émotion joyeuse, il suffit d’un signe positif, d’une attention, d’une connexion, et son visage s’illumine, son sourire revient, il parle avec assurance et aisance quand quelques minutes plus tôt il semblait totalement absorber par autre chose, une gêne, une forme de timidité quelque part, ou un manque de confiance en lui – son humilité naturelle ressort elle aussi à tout instant, sentiment que nous avions pu avoir également lorsque nous avions rencontré Karim Leclou à qui il rendait la pareille dans le Roman de Jim. Ainsi à deux, et en s’appuyant sur de nombreux détails et références – là aussi nous vous invitons à écouter nos interviews croisées de Léonor et d’Andranic– , il peaufinent le portrait, Léonor Serraille composant notamment avec une forme de gravité qu’Andranic apporte, sans fard, aux antipodes du masque de Laetitia Dosch, une apparente frivolité, deux réactions possibles aux même stimulus, contraires. Ari explore d’autres donc d’autres possibles, montrent des colères, des libérations, des constructions mentales différentes, tout en reprenant le chemin de croix, le sas dépressif, et l’importance des autres, du hasard, la capacité à rester digne même dans la descente, à ne pas s’effondrer, à ne jamais abandonner. Ari, quelque part, est une version introvertie de Paula, plus qu’il n’en est une évolution ou le prolongement, quelques années plus tard, et Léonor Serraille, sans l’avoir conscientisé, sans que cela n’en fut l’intention, nous livre un envers de Jeune Femme, au potentiel émotionnel qui devrait parler au plus grand nombre.


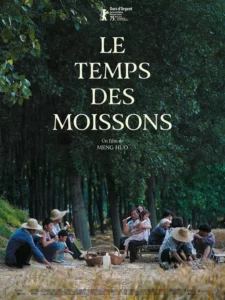
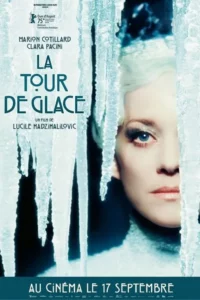
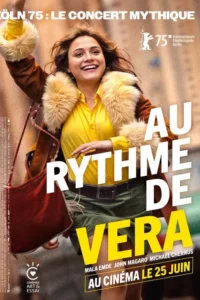



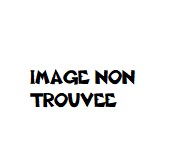
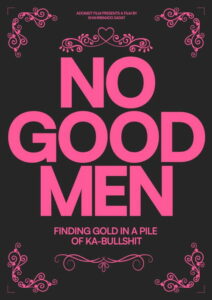
Soyez le premier a laisser un commentaire