Au cinéma du TNB, nous avons eu le privilège de rencontrer François Ozon et Benjamin Voisin, quelques semaines après la présentation de L’Étranger à la Mostra de Venise 2024.
Au fil de cette rencontre, se dessinent les choix audacieux d’un réalisateur confronté à un classique, et la subtilité d’un acteur s’immergeant dans l’intériorité d’un personnage énigmatique.
De la force d’un roman devenu mythique à l’intensité d’une mise en scène où lumière, corps et silence se répondent, ces échanges éclairent la singularité d’un film à la fois fidèle et profondément contemporain.




François Ozon : Quand j’ai relu le bouquin, j’ai été assez frappé par l’invisibilisation de l’arabe. Voilà. Et donc j’ai eu besoin de comprendre quand ce livre a été écrit. Il a été écrit en 1939 en pleine colonisation française. L’Algérie c’est la France, c’étaient deux départements français. Et donc, il me semblait primordial pour les spectateurs d’aujourd’hui et même pour moi-même de contextualiser l’histoire, qu’on comprenne, ce n’est pas un hasard s’il tue un arabe, dans quel univers, dans quel pays finalement ça se passe. Et donc je me suis plongé. Ce qui est génial, c’est qu’il y a plein d’archives, il y a plein de photos, il y a plein de reportages documentaires et je suis tombé sur ces images d’Alger qui sont filmées par des colons français et où j’ai trouvé ce commentaire qui est hyper choquant où on comprend tout de suite quelle est la vision colonialiste des Français par rapport à l’Algérie et qui permet un peu de contextualiser cette histoire et de mieux comprendre pourquoi les choses vont se passer.
Le Mag Cinéma : A Venise, vous disiez que la question de l’Algérie française était présente dans beaucoup de familles françaises et que c’était souvent tabou encore aujourd’hui. Cette réflexion que vous avez eue, c’est une réflexion que vous aviez avant même d’attaquer L’Étranger ou c’est en développant l’adaptation que vous l’avez eue ?
F.O. : En fait en tant que cinéphile j’avais remarqué qu’il y a finalement assez peu de films qui parlent de l’Algérie. Il y a quelques films qui parlent de la guerre d’Algérie, mais on sent que c’est un peu un tabou quand on compare par rapport aux Américains ce qu’ils ont fait sur la guerre du Vietnam. Eux, il y a eu un vrai travail historique mais aussi un travail artistique autour de cette guerre, de la culpabilité des Américains par rapport à ce qui s’est passé, par rapport aux responsabilités. En France, c’est encore très douloureux. Il y a beaucoup de cicatrices et finalement, il y a peu de cinéastes qui se sont emparés de ce sujet et notamment qui ont parlé de la colonisation française avant la guerre. Souvent, on parle de la guerre et après la guerre. Mais la période finalement de la colonisation, il y a peu de films qui parlent de ça. Donc je le savais et en travaillant sur le sujet, en préparant l’adaptation, je m’en suis rendu compte encore plus. Heureusement, il y a beaucoup d’archives et beaucoup d’actualités qui ont été filmées. Donc après, ce sont des images très orientées comme on voit au début du film.
L.M.C. : Comment situez-vous la pensée de Camus par rapport à ce sujet ?
F.O. : C’est très ambiguë en fait. Camus a été très attaqué, il est encore attaqué notamment aux États-Unis par rapport à cette invisibilisation de l’arabe. C’est vrai que c’est ça qui nous choque aujourd’hui. C’est pour ça que je commence par la phrase qui choque pour moi lecteur d’aujourd’hui, c’est « J’ai tué un arabe et pas aujourd’hui maman est morte ». Il me semblait que c’était important de dire ça. Je pense que Camus est tout à fait conscient de ce qui se passe en Algérie, mais il faut savoir que Camus, il est né là-bas, c’est son pays, il adore ce pays. Il a écrit, juste avant d’écrire L’Étranger, il a fait des reportages sur la Kabylie. Il est tout à fait conscient du statut des indigènes, des Arabes qui sont considérés comme des indigènes, qui n’ont pas de statut d’égalité avec les Français. Il sait qu’il y a une misère. Donc je pense qu’il a tout ça en tête quand il écrit L’Étranger. Après une fois que le livre est sorti, qu’il a eu beaucoup de succès, il n’a jamais voulu le relier à ce qui va se passer après la guerre d’Algérie. Mais moi, lecteur d’aujourd’hui, je peux pas m’empêcher de me dire que le livre annonce ce qui va se passer. Alors, j’ai travaillé avec Manu d’Acos qui est mon chef op fréquent. J’avais souvent travaillé avec lui. J’avais fait notamment Grâce à Dieu avec lui. Et très vite, moi l’idée du noir et blanc s’est imposée parce que on voulait pousser les hautes lumières et le noir et blanc permet ça. Il y avait aussi le fait que les archives et toute notre mémoire collective de cette époque qui n’existe plus de cette Algérie française est en noir et blanc. Il me semblait que ça allait apporter une forme de réalisme et permettre aux spectateurs de plus rentrer dans ce monde qui n’existe plus. Et puis il y avait aussi raison économique. On avait pas les moyens de reconstituer l’Alger des années 30 en couleur. Donc c’est vrai que le noir et blanc simplifie beaucoup de choses.
Dans le livre, on ne connaît jamais le nom de l’homme qu’il tue. Justement, il est tout le temps dénommé comme étant l’arabe. Cependant, dans la dernière scène – faut pas le dire –, vous avez décidé de le nommer. Pourquoi ce choix ?
F.O. : Ce qui est important pour moi c’est qu’en faisant mon adaptation c’était impossible de faire une adaptation comme si j’étais encore en 1942. On est en 2025 donc il fallait le regard d’aujourd’hui sur cette histoire et tout ce qui s’est passé depuis la sortie du livre d’une certaine manière, j’essaie de l’intégrer dans ma mise en scène, notamment le livre de Kamel Daoud, Meursault contre-enquête où il raconte l’histoire du point de vue des Arabes, du point de vue du frère de l’arabe qui est tué. Et pour moi, c’est important aussi de lui donner un nom et surtout de développer le personnage de la sœur que j’appelle Jemila, qui n’a pas de nom dans le livre et qui permet de faire entendre la voix des Arabes dans cette histoire. C’était un choix qui me semblait évident, mais c’est un choix politique aussi, mais c’est une manière aussi de voilà quand on adapte un classique forcément on le relie avec notre regard aujourd’hui. C’est comme au théâtre quand quelqu’un va adapter Hamlet ou un Tchekhov, il le relie avec l’époque actuelle. C’était évident de faire ça pour moi.
L.M.C. : Justement, ce travail d’adaptation, comment l’avez-vous construit ? Sachant qu’il y avait déjà Visconti qui s’y était essayé. Et Benjamin tout à l’heure nous disait qu’il avait senti en vous que vous vous mettiez la pression quand même.
F.O. : Je me mets toujours la pression quand je fais un film mais c’est vrai que là les enjeux sont compliqués parce que c’est un livre ultra connu que tout le monde a lu. Vous l’aviez lu avant de voir le film. Voilà. Bon, donc il y a autant de Meursault dans vos têtes que voilà, tout le monde s’est représenté ce personnage, tout le monde a mis en scène dans sa tête cette histoire. Donc forcément, on est très attendu. Donc moi, je savais que j’allais diviser, qu’il y a des gens qui allaient me dire « Meursault est pas du tout comme ça, l’histoire faut pas la raconter comme ça ». Le livre va tomber dans le domaine public. Moi, j’attends les versions de tout le monde sur L’Étranger. Après, c’est ma version que moi je l’ai je l’ai ressentie. Donc c’est une vision du livre. Mais forcément, quand on s’attaque à un best-seller et un chef-d’œuvre, il y a forcément des gens qui s’y retrouvent pas tels qu’ils l’ont imaginé. Pour moi, c’était évident qu’il fallait pas enfin, il m’aurait semblé être une facilité d’utiliser plus de voix off parce que le livre effectivement est raconté à la première personne. Mais ça m’intéressait que le spectateur ne vive pas la même expérience dans la lecture qu’au cinéma. C’est voilà c’est deux langages différents, le langage littéraire et le langage cinématographique. Ça m’intéressait notamment dans cette première partie qu’on soit dans l’observation, dans le ressenti. On n’est pas dans l’identification parce que c’est un personnage quand même qui est auquel on a du mal à s’identifier mais on est plus dans une forme de fascination, de curiosité, essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait ça. Et donc il me semblait que la voix off devait arriver qu’à des moments clés. Et en fait, j’ai choisi deux moments qui sont pour moi les deux plus beaux moments du livre au moment du meurtre et à la fin où la langue de Camus est un peu différente du reste du livre. Si vous connaissez bien le livre, c’est plutôt une écriture blanche au début, très factuelle, behavioriste. Et là, tout d’un coup, on est dans une langue beaucoup plus lyrique d’ailleurs qui pour moi est plus la voix de Camus que la voix de Meursault. Et je trouvais qu’à un moment d’avoir cette trouée de voix off et d’avoir l’intériorité du personnage était très fort. Alors, je savais, on savait pas si on allait l’utiliser ou pas et c’est vraiment au montage que je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien, notamment après le meurtre.
Si on se concentre sur la scène du meurtre à la plage, nous on a vraiment ressenti de l’érotisme quelque chose de très sensuel de l’ambigüité. Est-ce que c’était voulu de filmer cette scène de cette manière ?
F.O. : Oui, c’est une scène très mystérieuse dans le livre. On y a beaucoup réfléchi. Moi, je me demandais comment j’allais la filmer. C’est un peu tout l’enjeu parce que comme on n’est pas du tout dans la psychologie, on est dans quelque chose de très sensoriel puisque Meursault n’exprime quasiment aucune émotion mais il ressent les choses. Donc je me suis demandé comment j’allais tourner cette scène et j’ai beaucoup pensé en fait au western au film de Sergio Leone où vous savez quand il y a un duel, ils sont face à face, il y a des gros plans sur les yeux, sur la main, sur le revolver, tout ça. Une dilatation du temps aussi, un travail sur le rythme, faire un moment un peu abstrait. Et puis il y a cette chose assez mystérieuse dans le livre. Camus dit que Meursault fait un pas vers l’arabe. Alors pourquoi il fait ce pas ? Est-ce que c’est pour échapper au soleil ? C’est impossible parce qu’il rentre pas dans l’ombre. Voilà. En tout cas, c’est ça qui provoque l’arabe qui sort le couteau et après le revolver. Et j’avais envie que ce moment suspendu soit un peu abstrait et effectivement sensoriel parce que parce qu’ils sont tous les deux beaux. Voilà et il fallait l’assumer et il me semblait que de toute façon l’érotisme d’une certaine manière me semble nécessaire dans cette histoire pour mieux la comprendre. Que ce soit avec Marie et Meursault, que ce soit entre l’arabe et Meursault, il me semblait qu’il fallait que le film soit on est dans le ressenti tout le temps et pas dans l’expression d’idée sauf dans la seconde partie, mais toute cette première partie en tout cas, il fallait qu’elle soit sensuelle et sensorielle.
En parlant de plage, elle a un rôle très important dans le film, c’est un tournant et dans beaucoup de vos films, il y a souvent des plages. Qu’est-ce que ça signifie la plage pour vous ?
F.O. : Je ne suis pas dans l’analyse, c’est à vous de le faire hein, c’est votre boulot d’analyser les films les uns par rapport aux autres. Mais c’est vrai que j’aime bien filmer sur des plages. Déjà, j’adore aller à la plage. C’est personnel. Après, quand j’étais plus jeune, je disais « J’aime bien filmer sur les plages parce que ça me permet de demander aux comédiens de se déshabiller, voilà, de filmer les corps. Alors pas forcément nu, mais en maillot de bain. Quand j’ai fait un film comme Sous le sable avec Charlotte Rampling, il y avait le corps de cette femme qui a 50 ans avec son mari et son mari va se baigner, il disparaît. » C’est vrai que la plage c’est un lieu à la fois concret et en même temps ça va vers une forme d’abstraction puisque il y a l’horizon, il y a la mer, le sable, il y a très peu d’éléments et il y a les personnes qui sont là. J’ai l’impression qu’on touche à une forme de vérité de ce qu’est l’être humain sur une plage où en plus on est dénudé, on est voilà, il y a le soleil, les éléments. Donc c’est vrai que quand j’ai décidé de faire l’adaptation de L’Étranger, je me suis dit bah il y a quand même cette scène centrale à la plage. Enfin, j’étais excité par la filmer même si j’étais un peu inquiet parce que je savais pas exactement comment je allais le faire.
Pourquoi vous avez choisi Benjamin Voisin ? On a un semblant de réponse mais qu’est-ce qui a fait que c’est lui en fait votre Meursault ?
F.O. : C’est vrai que j’avais on avait travaillé sur un autre projet sur un jeune homme d’aujourd’hui qui est un peu désabusé par rapport au monde et dans l’incompréhension de ce qui se passe aujourd’hui. C’était un film très contemporain et il commettait une tentative de suicide et bon le film on a pas réussi à le monter financièrement. Personne voulait mettre de l’argent dessus. C’était assez sombre, je dois avouer. Et du coup, j’ai relu le livre et en relisant le livre, je me suis dit en fait, c’est incroyable parce que tout ce que je raconte est tellement plus fort dans L’Étranger. J’avais lu le livre comme tout le monde quand j’avais 16 ans. Je l’avais un peu oublié. J’ai trouvé que le bouquin avait toujours une puissance et un mystère. Et donc j’en ai parlé tout de suite à Benjamin, je lui ai dit « Et si on faisait ça ? » Et il était tout de suite partant. Je pense que vous avez vu Benjamin, c’est quelqu’un d’assez expressif, assez extraverti et là pour lui c’était un vrai défi de jouer un personnage aussi introverti qui masque qui ne doit pas jouer, qui ne joue pas le jeu de la société, qui ne joue pas de manière générale. Donc pour un acteur, je pense que c’est un rôle assez passionnant à faire.
L.M.C. : Sur le fait que ça fonctionne bien, Benjamin nous avouait que vous lui aviez confié les notes du cinématographe de Bresson. Vous l’avez donné qu’à Benjamin ou à tous les acteurs ?
F.O. : Et non, je l’ai donné qu’à lui parce que les autres acteurs en fait, il y a comme j’ai choisi quand il va au cinéma le Schuns où on voit Fernandel qui joue la même phrase sur plein de tons différents et finalement chaque acteur joue sur un ton différent. Rebecca, elle joue plus sur un jeu de l’ordre de la séduction. Benjamin, effectivement, il est très neutre comme un modèle de Bresson. Pierre Lottin, il est dans un jeu un peu second rôle années 30. Lavan, il est dans quelque chose d’un peu clownesque qui va un peu vers le grotesque et donc il fallait que tous les acteurs autour de lui soient très vivants. Donc ma direction d’acteur était très différente pour chaque acteur.
L.M.C. : Et sur la constitution du casting du coup 5 étoiles, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chacun ? Christophe Malavoy, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swan Arlaud, Jean-Charles Clichet par exemple et Nicolas Baude. Pourquoi ces choix, sachant que Camus ne décrit pas beaucoup ses personnages ?
F.O. : Oui. Et vous par contre, vous faites le choix. Si le personnage qui est décrit peut-être le plus, c’est Marie. Enfin Marie il décrit pas son visage. On ne sait pas si elle est brune, elle est bronzée en tout cas et elle porte des robes rouges souvent ou blanches. Voilà, c’est tout ce qu’on sait. Mais c’est vrai que les personnages sont très peu décrits, même les âges des personnages. Donc il fallait que moi je les représente tels que je les imaginais et c’est vrai que sur ce film, j’ai retrouvé beaucoup d’acteurs avec qui j’avais déjà travaillé parce que finalement ça a été un film assez compliqué à faire. On n’a pas eu les financements qu’on souhaitait. On sentait que même si c’est un livre très connu, beaucoup de gens avaient peur du sujet. Beaucoup de financiers n’y croyaient pas forcément et donc j’ai appelé des comédiens avec qui j’avais déjà travaillé, avec qui je m’entendais bien, qui sont pour la plupart des amis et qui m’ont fait confiance. Et notamment, je pense au rôle du prêtre à la fin qui est joué par Swan Arlaud où c’est un petit rôle. Et j’ai mis du temps, on a mis du temps avec Benjamin à oser parce qu’au début je me disais c’est quand même trop petit, je vais pas lui demander de venir pour 2 jours de tournage. Et comme finalement on voyait plein d’acteurs et à chaque fois c’était pas ce que je souhaitais, j’ai appelé Swan et je lui ai dit écoute on fait une lecture avec Benjamin, on voit si ça marche ou pas. Je suis pas sûr que tu sois le rôle, mais si ça marche, j’adorerais que ce soit toi. Et on a fait la lecture et j’ai trouvé ça génial que ce soit un prêtre assez séduisant, plutôt jeune, plutôt que l’image du vieux prêtre comme j’aurais pu dans Grâce à Dieu par exemple.
L.M.C. : Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la construction des décors à Tanger et non pas à Alger pour constituer l’Alger de l’époque ?
F.O. : Là c’est impossible de tourner en Algérie, à Alger et notamment cette histoire là. C’est très compliqué par rapport aux tensions politiques qu’il y a entre la France et l’Algérie et le gouvernement algérien. Donc souvent quand on représente Alger dans les années 30, dans les années 40, on va tourner à Tanger qui est aussi une ville méditerranéenne où il y a beaucoup de points communs d’un point de vue architectural entre les bâtiments mauresques et des bâtiments osmaniens, enfin plutôt hispaniques d’ailleurs à Tanger. Mais bon, en tout cas, ça pouvait faire l’affaire sur certaines choses et puis il y a des effets spéciaux qui ont permis qu’on se croit vraiment à Alger. Et j’ai des amis algériens qui ont vu le film et qui m’ont dit « Mais c’est magnifique ce que tu as fait, c’est beaucoup plus beau qu’Alger. » Mais ils croyaient que j’allais tourner à Alger.
L.M.C. : Camus ne décrit pas beaucoup ses personnages mais il décrit quand même les décors. Je pense au cabanon, je pense aux falaises. C’étaient des choses auxquelles vous étiez très attaché ?
F.O. : Oui. mais ça c’est un cabanon sur une plage. On l’a fabriqué forcément. Mais ce qui est intéressant, c’était de revoir aussi le film de Visconti qui lui a pu tourner à Alger sur les vrais décors, notamment la rue de Lyon où vivait Camus quand il vivait en Algérie. Donc c’est intéressant de voir les vrais décors et nous après on a été obligé de reconstituer et trouver d’autres décors.
L.M.C. : Quelque chose qui s’éloigne un petit peu plus de Camus enfin de base dans la mise en scène, c’est le choix de la bande sonore. Vous faites le choix de Killing an Arab de The Cure par exemple. C’était une évidence pour vous ?
F.O. : Je suis un fan de The Cure. J’avais déjà utilisé un morceau dans Été 85 et c’est vrai que ce morceau qui est l’un des premiers tubes de The Cure bon c’était pas possible de l’intégrer au milieu du film. Quoi que on aurait pu essayer, peut-être ça aurait donné un effet de distanciation très fort mais c’est vrai que ça me plaisait de le mettre à la fin parce que c’est un morceau que j’aime beaucoup et je savais que Robert Smith avait été un peu embêté parce que la chanson a été récupérée par des mouvements d’extrême droite qui le prenaient au mot et qui n’avaient absolument pas connaissance du livre L’Étranger et donc Robert Smith a arrêté pendant longtemps de jouer le morceau. Et d’ailleurs même dans certains concerts, il chantait pas Killing an Arab, il chantait Kissing an Arab. Donc quand je lui ai proposé de l’utiliser dans le film, il a tout de suite accepté parce que ça permet de remettre cette chanson en lien avec le film et que les gens comprennent vraiment les paroles après avoir vu le film. C’est on se rend compte que on comprend tout le sens de la chanson et sa force.
L.M.C. : Est-ce qu’il y a une scène qa été plus difficile qu’une autre à mettre en scène ou à conceptualiser et sur laquelle vous vous êtes heurté ?
F.O. : Je pense que les scènes qui ont été compliquées, c’était les scènes sur la plage déjà parce qu’on a tourné au mois de mars et avril et qu’il faisait pas toujours beau et le soleil, vous avez vu dans le film est très important. Donc, il a fallu attendre le soleil. Les acteurs étaient frigorifiés. Nous, on est tous en doudoune. Eux, ils sont en maillot de bain ou en vêtement très légers. Donc ça a été un peu compliqué mais finalement ça se sent pas à l’image. Donc c’est le principal.
L.M.C. : Le film que vous pensiez faire avant de vous lancer dans le projet de L’Étranger, vous le gardez en carton quelque part, il sortira un jour ?
F.O. : Peut-être, peut-être je le reprendrai un jour, mais là pour l’instant non. Je suis content d’avoir fait L’Étranger. Des fois, il faut des chemins bizarres pour arriver au film qu’on fait et finalement ça fait partie de l’histoire de L’Étranger. Donc d’une certaine manière, je tourne la page.
L.M.C. : Une question sur l’accueil du film à Venise avec la première projection du film. Est-ce que vous étiez content de l’accueil des réactions et surtout pour moi qui ai vu le film à Venise, je pensais qu’il méritait quand même un prix, surtout Benjamin Voisin et pour d’autres mais il n’a malheureusement pas gagné de prix…
F.O. : J’étais très heureux de le présenter à Venise parce qu’il faut savoir qu’il y a 58 ans, Visconti a présenté à Venise sa propre version de L’Étranger. Donc, j’étais très ému d’être sélectionné dans le festival. Après, les prix, c’est vrai qu’on les espère toujours, notamment pour les acteurs, mais après on sait dans les jurys comment ça se passe et souvent politique, c’est des choix. Donc le fait déjà d’être sélectionné, d’être montré à Venise, c’était déjà très bien.
La fameuse phrase « Maman est morte aujourd’hui » n’est pas dans le film.
F.O. : Non mais il la dit quand même. Il dit la phrase à Marie quand il se retrouve au bain, elle voit son brassard et elle lui dit « Mais vous êtes en deuil ? » et il dit « Oui, maman est morte. » C’est très anecdotique par rapport à l’ouverture du roman. C’est un choix d’avoir supprimé cette phrase culte au début. Bah oui, le choix, ce que je disais tout à l’heure, moi en relisant le livre aujourd’hui, ce qui m’a frappé, c’est cette phrase qui arrive dans la seconde partie du livre « J’ai tué un arabe ». Il me semblait que c’était plus fort de commencer par cette phrase. Il faut replacer l’incipit « aujourd’hui maman est morte ». En 1942 en littérature française, on n’avait pas la même en littérature mondiale ce genre de phrase était très moderne de commencer un livre comme ça. Aujourd’hui, ça n’a pas la même force je pense. Donc je trouvais ça plus intéressant de commencer par l’autre phrase. Merci à vous.
Benjamin Voisin : On avait un autre film avec François auparavant qui ne s’est pas fait pour différentes raisons, qui abordait déjà un peu ces thèmes-là qui sont ceux de Meursault, c’est-à-dire un jeune homme pas forcément enclin à jouer le jeu social, pas forcément dans l’idée, simplement même assez proche d’un début de suicide. Enfin bon, on avait déjà quelqu’un qui était assez sombre et pas rattaché à la réalité. Donc pour ce projet, quand François est venu en me disant que ça ressemblait quand même vachement à L’Étranger, il a relu, on a reparlé, il est venu un peu en filigrane doucement et puis ça a été la continuité. Donc il n’y a pas eu le truc violent de « va falloir faire L’Étranger de Meursault au cinéma ». J’avais commencé moi à aborder déjà un peu ces thématiques-là dans le jeu d’acteur. Donc c’était aller moins violemment et plus agréablement.
Le personnage de Meursault est très complexe dans le livre. On a accès à ses pensées, dans le film tout passe par votre jeu. Comment avez-vous travaillé ce rôle ?
B.V. : C’était le truc bien. François m’a dit rapidement qu’il y aurait possiblement un ou deux passages en voix off pour entendre quand même la plume de Camus, la prose, mais qu’il n’en voulait pas. Ce qu’il y a beaucoup sur le film de Visconti, c’est de la voix off et c’est finalement ça qui donne peut-être trop de facilité au film. Ça peut faire un peu page à page, adaptation page à page. Donc le challenge était vraiment d’embarquer dans son esprit mental. Donc on parlait beaucoup et François m’a dit : « Si jamais il y a un moment où tu joues, je pense que la caméra va être hermétique. Ça ne va pas le faire. Faut pas que ça soit du jeu d’acteur. » Donc c’est une préparation où j’ai mis plus de temps que prévu. J’ai dû mettre quatre mois à essayer de… Je crois que l’être humain a toutes les émotions à certains degrés. Moi, je suis allé prendre celles de Meursault qui sont chez moi, qui sont assez à l’opposé, et je suis allé les remonter en faisant disparaître d’autres. Donc du coup, dans ma vie privée, pendant quatre mois, j’étais assez sombre, assez défectueux, un regard beaucoup plus loin, beaucoup moins concret que d’habitude. Comme ça, c’était une sorte de sacrifice un peu pour que je puisse arriver sur le plateau en laissant un peu le personnage jouer par lui-même, en n’ayant pas de contrôle technique, ce que je peux faire parfois sur d’autres films.
L.M.C. : Ici vous aviez un texte culte, est-ce que ça vous a mis une pression ?
B.V. : J’aime bien la pression. J’aime bien déjà par l’idée que mes grands-parents vont avoir l’occasion de voir leur petit-fils jouer Meursault dans L’Étranger qui a été écrit quasiment à leur époque. Donc ça déjà, ça me permet d’enlever beaucoup de pression. Il y a beaucoup de joie là-dedans. Et ensuite, j’aime bien la responsabilité. Je trouve c’est un très beau cadeau que le cinéma me fait parfois en pensant à moi pour des rôles comme ça. J’ai pu aller travailler au théâtre Céline, j’ai pu faire Balzac, Laakamu, il y a aussi des textes contemporains. Je suis très content de ça. Je suis très flatté surtout.
Quelle liberté aviez-vous sur le tournage pour jouer ce rôle ?
B.V. : Ça faudrait lui demander. Moi j’en ai un souvenir. C’était drôle parce qu’on avait déjà fait un film ensemble qui s’appelle Étés 85 où il avait, je pense, 15-16 ans à l’époque en 85. Donc il avait une image très précise de ce qu’il voulait retranscrire dans ce personnage-là que je jouais qui était un peu une forme d’idéalisation de l’être aimé. Donc du coup, je lui faisais confiance et on me faisait du vraiment du « j’allais vers sa pensée à lui ». Alors que là rapidement on se dit : merde, on n’a ni la clé ni je l’ai. On ne sait pas qui est Meursault et on le saura jamais. Nous on a essayé humblement de rajouter une sensualité, un corps dessus en mettant notre point commun en question. Mais du coup sur la direction d’acteur, il n’y en a pas, il y en a quasiment pas eu. Je le voyais plus diriger Pierre Lottin et Rebecca Marder. Nous on était plus curieux de voir après toutes ces discussions qu’on a eu ensemble le personnage en tant que tel. Voyons voir maintenant comment on le met en scène. Ce qui était chiant c’était les scènes où d’un coup on voyait que ça ne marchait pas et il y en a eu peu. Mais les deux-trois scènes où c’est le rôle, on le voyait jouer, on me voyait faire. C’était soit le texte, soit la mise en scène qui devait changer, soit les propositions, soit du montage. Une scène on a beaucoup groupé parce que tout paraît sorti, tout paraît fabriqué justement ce qu’on voulait éviter et c’est comme ça. J’étais pas plus réveillé ou moins réveillé qu’un autre jour. J’étais pas moins bon. C’est la scène qui n’allait pas au rôle. Ça c’est franchement hyper intéressant de voir ça. Quand ça se passait vraiment, il n’y avait aucune question. On fait ça, c’est fait, on enchaîne quoi.
Tous mes personnages sont comme ça, personne ne les connaît mais là ce qui est chiant c’est que personne ne les connaît physiquement mais tout le monde les connaît intellectuellement. On a quand même, quand on projette le film, 95 % des gens ont déjà lu L’Étranger et 100 % dedans ont aimé, adoré, détesté, pas compris différentes choses mais pas ennuyé. Donc chacun a un peu son point de vue sur L’Étranger.
L.M.C. : Et vous, c’était quoi votre point de vue sur ce personnage-là ? À l’époque, aujourd’hui ? Avant et aujourd’hui, est-ce que ça a changé ?
B.V. : Je l’ai lu très tôt quand j’avais 14-15 ans. Je m’ennuyais à l’école. Avant le lycée quoi, je l’ai lu au collège, je lisais beaucoup de trucs différents et il est resté à l’époque assez incompréhensible parce que je voyais complètement ce dont il parlait. Il y a une phrase de Balzac qui dit : « Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement. » Et là, c’est vrai pour beaucoup, ça dépend des gens. Certains ça vient, certains ça ne vient pas. Moi, je sais que quand j’ai passé l’âge de la naïveté, l’âge de l’enfance où en fait on va rentrer dans un monde sérieux, il y a des gens pour qui on va devoir travailler, on va devoir être payé pour survivre, pour ne pas mourir. La différence entre les gens parfois les pointer du dehors, on va jusqu’à en faire des guerres. Le monde dans lequel on vit, par rapport à l’œil que j’avais quand j’étais enfant où j’inventais des pirates et tout, il a évidemment évolué. La lecture est venue comme une solution pour moi. Mais Meursault dedans quand je le découvre, je me dis il comprend ça mais il ne trouve pas de solution justement. Il ne va pas essayer de se débattre. Moi j’ai trouvé par exemple la séduction dans la séduction que ce soit l’amoureuse ou même professionnelle. J’ai fait un métier qui est basé sur le désir de l’autre. Si un metteur en scène ne me désire pas, ce n’est pas moi qui vais m’implanter dans son film. Lui ne va pas jouer du tout de jeu. Il ne va jamais mentir. Moi j’adore mentir. Je peux passer quatre heures dans un bar si je sens que ce mensonge va aider même à créer d’autres vérités à un autre moment. Mais à créer un bon moment, je le fais sans aucun problème. Lui jamais. Donc ça crée quand même des… Je me dis tiens c’est marrant d’avoir accepté ce chemin-là. En gros c’est ça que je me disais. Pendant quatre mois, j’ai pu travailler ça un peu.
L.M.C. : Est-ce que pour vous ce personnage a un sens aujourd’hui dans notre monde contemporain dans sa façon d’être, sa façon de penser ?
B.V. : Ce qui est intéressant je pense et encore plus moi je vais souvent faire des films pour ma génération. Je pense que c’est intéressant justement un jeune d’aujourd’hui qui ne se ment pas, qui ne va pas essayer de correspondre à des cases qu’on lui demande. Il y a évidemment des trucs qui peuvent être trop violents chez lui. Mais moi ce qui m’intéresse, c’est que quand même cet homme-là, on finalement il se retrouve je pense que Camus s’amuse aussi à lui faire vivre dans la deuxième partie du bouquin les choses les plus violentes possibles. Un procès, la demande de se justifier, l’emprisonnement, la solitude puis l’exécution. Malgré ces cinq choses-là à la fin il dit : « Je crois que j’avais été heureux et je le suis encore. » Je me dis c’est intéressant que malgré les péripéties là, elles sont énormes chez Camus mais dans la vie de tous les jours, malgré les péripéties, si on est quand même un peu proche de soi-même et qu’on est affirmé et que je pense que les gens sont plus intéressants quand ils savent qui ils sont pour les autres. Malgré tout, on s’en sort mieux je pense avec soi-même dans la vie en général.
L.M.C. : Et justement cette force de caractère, la détermination, la confiance en soi, qu’il est quelqu’un très fort et qu’il pense toujours qu’il a raison. Comment vous l’avez incarné ?
B.V. : Il ne dit pas qu’il a raison. On lui demande, il dit ça n’a pas d’importance et je ne sais pas. Au contraire, il avoue plein de fois qu’il n’a pas raison et que trouver une raison ça sert à rien. Il y a des choses qui sont concrètes. Le ciel est bleu, je peux vous le dire de 14 façons différentes, le ciel restera bleu. Je t’aime. Je vous le dis de 14 façons différentes. Vous allez penser 14 choses différentes. Expliquer ce qui est visiblement concret c’est facile. Expliquer un sentiment c’est impossible. C’est ça qui est beau. C’est pour ça qu’il faut se fier à l’instinct parce qu’il n’y a pas besoin de l’expliquer. C’est que c’est avec soi-même.
L.M.C. : Dans la pensée de Camus, il y a cette notion que face à l’absurde, il ne faut non pas renoncer, non pas se suicider, mais plutôt se révolter.
B.V. : C’est la suite, c’est le deuxième cycle de sa philosophie. On la touche un tout petit peu dans la scène de fin avec Solal où justement on voit qu’il l’ouvre vers ce que va être plus tard le cycle philosophique de L’Homme révolté. Mais c’est pas du tout ce que… Moi dès que je lisais des trucs autour de L’Homme révolté, je me disais ça ne peut pas correspondre, il faut imaginer Meursault heureux. Non, je ne pouvais pas l’utiliser moi pour jouer L’Étranger de Camus, même si c’est une très belle phrase.
L.M.C. : Justement, cette scène avec Swan Arlaud, c’est une scène qui est explosive par rapport au reste du film où vous êtes plutôt dans la retenue, les émotions. Comment c’est de jouer une scène d’un coup où tout explose où il y a tout qui sort ?
B.V. : En fait, ce qui est assez intéressant, c’est qu’on a tourné le premier jour de tournage et donc on ne savait pas ce qui allait être Meursault. On n’avait pas encore vraiment l’assurance des quelques jours de tournage. Donc on s’est jetés à corps perdu François et moi. La mise en scène était quand même assez découpée, assez François, je pense qu’il invente beaucoup sur le moment. Là, on avait les axes précis. Et au moment où ça monte, c’est un endroit précis où là, je pense qu’on a fait 15-16 prises toutes ultra différentes. Une en rigolant, une en pleurant, une en détresse, une très froide, une gueulée, et je ne sais pas ce qu’il a fait au montage, il a fait un mix de tout ça. Mais l’idée c’était en tout cas de se sécuriser le plus pour que l’explosion aurait pu ne pas en être une. Ça aurait pu être aussi une déclaration calme et froide.
L.M.C. : Est-ce que vous pouvez nous parler de votre alchimie très visible à l’écran avec Rebecca Marder ? Est-ce que c’est quelque chose qui s’est travaillé malgré tout ou est-ce qu’elle était vraiment naturelle dès le départ entre vous ?
B.V. : C’est marrant parce qu’honnêtement je pense que c’est la manière que François a de nous filmer. Moi je n’ai absolument écouté aucun de mes partenaires. Je n’ai jamais vraiment joué avec Rebecca. Je n’ai jamais joué avec Pierre Lottin ni avec Denis Lavant. Un acteur par exemple que j’adore au théâtre et j’étais trop heureux de jouer avec lui. Mais finalement je me suis rendu compte que je n’écoutais pas ces gens-là vu que dans le bouquin il est écrit qu’il se désintéresse un peu de tout ça donc j’étais moins focalisé sur eux. C’est la manière que François a de nous filmer ensemble qui est intéressante je pense.
L.M.C. : Et justement François sur le tournage par rapport au fait qu’il s’attaquait à un mythe de la littérature française en tout cas le roman français le plus lu à l’étranger. Est-ce que vous sentiez une pression en lui par rapport à ça ?
B.V. : C’était bien. C’était émouvant de voir le doute chez cet homme qui connaît le métier du cinéma en fait beaucoup et va dans différents registres. Il est très doué, il est très talentueux. C’est assez cool de voir aussi d’un coup une grosse pression d’adapter quelque chose de peut-être plus majeur que ce qu’il avait l’occasion d’adapter avant. Ça, il va vous en parler. Et concrètement par rapport à Étés 85, du coup, il y a des changements notables. C’est un tout en général. Il ne m’aurait pas montré les rushes pendant qu’on tourne de Étés 85. Là, j’avais accès le soir, on regardait un peu ce que ça donnait. Il était peut-être curieux de beaucoup d’avis différents en préparation. Il a appelé différentes personnes pour lire le scénario, pour en parler, des grands philosophes, différentes personnes, ce qu’il ne fait pas je pense sur tous les films. Parce qu’il veut que ça reste un objet personnel, mais là, je crois qu’il a eu l’intelligence de se dire que l’adaptation ne devait pas qu’être personnelle. Elle devait en plus de ça avoir du sens aujourd’hui. Ce que je trouve très bien. Moi ça m’aurait honnêtement je n’aurais pas fait le film si l’adaptation je l’avais trouvée soit ennuyeuse, poussiéreuse soit même avec du sens en moins. Quand on adapte Camus, on est obligé d’aller trouver le sens sinon ça n’a aucun intérêt.
L.M.C. : Je crois qu’à Venise vous disiez que vous aviez relu les Notes sur le cinématographe de Bresson.
B.V. : Je n’ai pas relu, il m’a envoyé ça. Il m’a envoyé pas mal de passages dessus où la différence que fait Bresson entre un acteur et un modèle, entre celui qui joue et celui qui vit. C’est hyper intéressant, c’est détaillé, ça m’a pris quatre mois de ma vie. La seule chose du coup que je me demande c’est dans ce cas-là le paradoxe, il est pour quoi refaire les mêmes choses dans la vie. Jamais au café on va dire quatre fois la même phrase. Si on vit, c’est très dur de reprendre le texte. Moi la plus grosse difficulté, c’était de refaire des prises. Je ne sais plus quoi faire. On l’a… Non, pour assurer question du soleil, on s’en fout du soleil. Et en fait non, évidemment qu’on s’en fout pas, mais sur le moment si on veut vraiment chercher la vie, personne ne répète quatre fois. Vous n’allez pas me répéter là maintenant la même question plus de quatre fois. Donc ça c’est le truc qui était intéressant qu’il n’a pas trop écrit de ou alors je n’ai pas tout lu donc mais voilà retrouver comment redynamiser de la vie en étant proche de ce qu’on a déjà fait c’est un peu le truc paradoxal. Faudrait faire qu’une seule prise tout le temps.
L.M.C. : Est-ce que ce rôle-là vous l’avez rapproché d’autres rôles que vous avez déjà pu faire ?
B.V. : Non. J’étais content parce qu’André Téchiné quand j’avais fait un film avec lui qui s’appelait Les Âmes sœurs m’avait dit : « Tu es pas mal quand tu as un partenaire avec toi. Si je te demande de prendre un téléphone et qu’il n’y a personne au bout du fil, tu ne seras pas l’acteur que je vais appeler en premier. » Et j’étais allé faire un monologue au théâtre pour justement travailler un peu l’imaginaire. Donc c’était vraiment un truc assez nouveau pour moi d’avoir autant de temps avec François qui me filme et pas de texte, pas de dialogue, juste une pensée mentale. Donc je franchement il me paraît pour l’instant comme un ovni. Je ne vois pas trop ce que j’ai fait de semblable.
L.M.C. : Et vous l’avez vu le film ? Vous vous trouvez comment ?
B.V. : Il y a autant de Meursault qu’il y a d’Étrangers. Donc je peux comprendre pourquoi quelqu’un peut aimer, quelqu’un peut ne pas aimer. Maintenant c’est plus moi, mon métier d’acteur, il s’arrête au moment où le film est fini. Après, si je commence à psychoter sur ce que j’ai fait, ce que je n’ai pas fait, je ne réfléchis pas à ça.
.


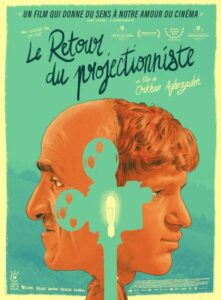


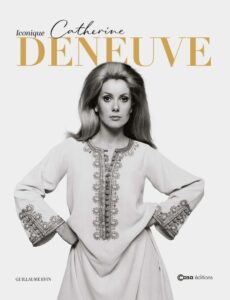
Soyez le premier a laisser un commentaire