Mis à jour le 16 septembre, 2025
Il était l’invité principal du FIDMarseille cette année. Présent pour accompagner la rétrospective que le festival lui accordait (rétrospective également au centre Pompidou cet automne). Cultivé, curieux, cinéphile et très disponible, Radu Jude revient avec élégance et gentillesse sur de nombreux points et nous livre une petite leçon de cinéma, il nous parle également de ses projets à venir, son Dracula, mais pas que, puisqu’il nous apprend s’être lancé dans un projet français , produit par Saïd Ben Saïd.
Le Mag Cinéma (L.M.C.) : Vous connaissiez le festival, comment avez-vous vécu ces quelques jours ?
Radu Jude (R.J.) : Oui, mais de loin. c’était très intense. Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour découvrir la ville, mais j’admire le festival pour la richesse de sa programmation. Il y a des documentaires, de la fiction, de l’essai, des films à gros budget, à petit budget… tout est mélangé. J’aime ça.
L.M.C. : Vous êtes un cinéaste très prolifique ces dernières années. On a vu votre film à la Berlinale cette année, vous présentez un nouveau film à Locarno, Dracula, et vous préparez un tournage en France. Pouvez-vous nous en dire plus ?
R.J. : C’est une proposition d’un producteur que j’admire beaucoup. J’ai été agréablement surpris quand il m’a proposé de travailler ensemble, en français. J’avais une idée et j’ai dit oui immédiatement. Nous avons commencé à développer ce scénario, qui est comme un dialogue lointain avec Journal d’une femme de chambre, mais dans une autre histoire, avec d’autres accents : une femme roumaine qui travaille à Bordeaux, etc. Nous terminons actuellement le financement. Ce n’était pas facile, même avec un producteur expérimenté et respecté comme Saïd Ben Saïd, mais nous allons tourner cet automne.
L.M.C. : Vous avez évoqué ces derniers jours les cinéastes qui vous ont inspiré. Quels films ou cinéastes vous ont donné envie de faire du cinéma ?
R.J. : C’est difficile à répondre, car cela change tout le temps. Ce qui m’intéressait à 20 ans n’était pas ce qui m’intéressait à 30, et ce n’est plus ce qui m’excite aujourd’hui. À 17 ans, j’étais un grand admirateur de Coppola ou Tarantino. Mais l’envie de faire des films m’est surtout venue d’artistes capables d’être à rebours de leur milieu, comme Jonas Mekas. Ce sont des modèles car ils liaient la création aux contraintes de production. Bresson, que j’admire énormément, me fait un peu peur par la perfection de sa vision. Quelqu’un comme Rohmer m’intimide moins, car il a tourné beaucoup, avec parfois de mauvais films, parfois des films extraordinaires. Ce désir d’essayer malgré des conditions imparfaites me parle beaucoup.
L.M.C. : Votre cinéma a beaucoup évolué techniquement. Vous avez commencé en pellicule, vous avez même tourné avec un iPhone. Comment adaptez-vous votre esthétique aux outils ?
R.J. : Pour moi, l’intelligence artistique, c’est de savoir utiliser les outils disponibles : connaître leurs possibilités et leurs limites, et décider consciemment. J’ai toujours voulu expérimenter : 35 mm couleur et noir et blanc, 16 mm, 8 mm, caméras digitales, iPhone… Je voudrais même tourner en 70 mm, si j’en avais les moyens. Je pense qu’il faut accepter tous les outils. Dans l’art plastique, personne ne reproche à Kurt Schwitters d’utiliser des papiers trouvés dans la rue. Mais au cinéma, on entend encore : « un iPhone n’appartient pas au cinéma ». Pourquoi ? Si c’est une image en mouvement, ça appartient au cinéma. Bon ou mauvais, c’est autre chose.
L.M.C. : Le festival nous a permis de revoir vos anciens films, comme The Happiest Girl in the World ou Everybody in Our Family, qui parlent tous deux de la famille. Est-ce, pour vous, le premier système d’oppression sociale et politique ?
R.J. : Oui, on peut dire ça. Sartre disait que les enfants sont les prisonniers politiques de leurs parents. J’ai eu des relations compliquées avec ma propre famille, donc j’étais sensible à ce thème. Je le suis encore, mais d’une autre manière. Peut-être qu’à l’époque, je n’en étais pas pleinement conscient. C’était surtout le désir de parler de ce que je connaissais, et une intuition de l’importance de ces problématiques.
L.M.C. : Comment vous viennent vos idées de films ?
R.J. : Il y a deux réponses opposées. Parfois, une idée naît d’une question ou d’une intuition, qui se développe avec le temps et la recherche. Parfois, c’est plus immédiat : on peut décider de faire un film ici et maintenant. J’aimerais atteindre cet état où je peux faire un film sans attendre l’inspiration. Comme un peintre à qui on demande un portrait : il ne répond pas « revenez dans trois ans ». Il peint. John Cage est une inspiration pour moi dans ce sens.
L.M.C. : Comment nourrissez-vous vos films, votre mise en scène ?
R.J. : Je n’ai pas de méthode fixe. Parfois c’est à priori, parfois à posteriori, parfois une lutte. Mes derniers films sont souvent le résultat d’un combat avec les matériaux ou les idées. Cela donne des formes parfois un peu torturées, mais peut-être que c’est ce qui les rend intéressants.
L.M.C. : Connaissez-vous la théorie du renard et du hérisson, d’Isaiah Berlin ? Certains artistes changent toujours de forme, d’autres poursuivent une seule idée… Où vous situez-vous ?
R.J. : J’aimerais pouvoir répondre clairement, mais je ne peux pas. Je fais avec ce que je peux, dans la direction qui se présente. C’est fatigant, un peu névrotique même. J’ai toujours l’impression de recommencer à zéro, avec les mêmes peurs, les mêmes doutes.
L.M.C. : Votre cinéma est souvent décrit comme réaliste. Quel rapport faites-vous entre documentaire et fiction ?
R.J. : Je ne suis pas sûr que ce soit du réalisme. C’est un cinéma impur, mélangé : documentaire et artificiel à la fois. Cela m’intéresse de créer une distance brechtienne, pour que le spectateur analyse et interprète. J’aime traverser la fiction par des moments documentaires. Par exemple, dans Ne pas attendre trop de la fin du monde, il y a un petit documentaire sur les croix au bord d’une route. Mon prochain projet roumain mélangera directement des séquences fiction et documentaire.
L.M.C. : Vos films sont politiques, historiques, mais aussi littéraires. Vous citez parfois Dostoïevski, ou d’autres écrivains. Pouvez-vous en parler ?
R.J. : J’ai toujours aimé lire. Longtemps, j’ai essayé de garder cette passion séparée du cinéma, influencé par l’idée que chaque art devait rester dans son langage. Mais en découvrant Resnais, Straub-Huillet, Godard, Rohmer, j’ai compris que la littérature pouvait entrer au cinéma, pas comme adaptation, mais comme matière. Rohmer parlait déjà dans les années 50 d’un « cinéma parlant ». Il s’agit d’ouvrir les films à la parole, sans trahir le cinéma.
L.M.C. : Pensez-vous que les grands festivals comme la Berlinale orientent aujourd’hui le travail des cinéastes ?
R.J. : Cela dépend. Certains cinéastes travaillent en marge, d’autres pensent leurs films en fonction des goûts des festivals. Les festivals ont une grande importance dans l’économie du cinéma, ils imposent des noms. Wang Bing, par exemple, n’a été accepté par le mainstream qu’après Berlin. Mais moi, mes goûts personnels ne dépendent pas de ça. J’aime Stan Brakhage, Jonas Mekas, qui n’ont jamais été acceptés par les grands festivals.
L.M.C. : Vous avez souvent un regard double sur vos personnages : tendre et accusateur à la fois. Vous donnez même de la culture à des personnages que vous critiquez. Cherchez-vous à accuser le système ? Quels cinéastes vous inspirent encore aujourd’hui ?
R.J. : J’appartiens à une génération pour qui la forme est aussi importante que le sujet. Même un film hollywoodien comme Barbie est politique, à sa façon. Moi, je tends plutôt vers les thèmes historiques et politiques, mais ils passent toujours par un travail formel. J’ai eu la chance de travailler comme stagiaire sur un film de Costa-Gavras. À l’époque, le sujet m’intéressait moins que l’organisation du travail. Aujourd’hui, j’admire surtout sa cohérence entre ses propos et sa façon d’être. C’était quelqu’un de profondément humain.
L.M.C. : Merci beaucoup.
R.J. : Merci à vous.


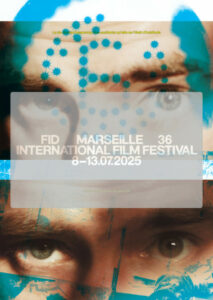

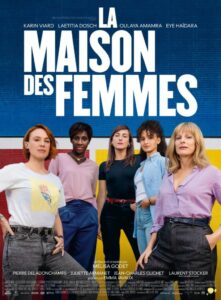

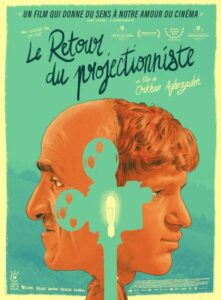
Soyez le premier a laisser un commentaire