Nous vous proposons ici notre journal critique des films en compétition (et de quelques films en avant-première) au 33ème festival du Film Britannique de Dinard.

L’échelle de notation qui y est appliquée est la suivante:
– très mauvais film
* film passable
** bon film
*** très bon film
**** excellent film
***** chef d’oeuvre

Emily de Frances O Connor avec Emma Mackay, Oliver Jackson Cohen, Fionn Whitehead
La vie imaginaire de l’une des autrices les plus célèbres du monde, Emily Brontë. Emily est le voyage initiatique, exaltant et édifiant d’une rebelle et d’une inadaptée vers la maturité féminine. Explorant les relations qui l’ont inspirée – sa relation brute et passionnée avec ses sœurs Charlotte et Anne, son premier amour douloureux et interdit pour Weightman, et l’attention qu’elle porte à son frère Branwell, qu’elle idolâtre, le film dresse le portrait de l’une des écrivaines les plus énigmatiques et provocatrices du monde, disparue trop tôt, à l’âge de 30 ans.
Notre avis: ***
L’influence d’Emily Bronte sur la réalisatrice Frances O Connor n’est pas sans rappeler la relation que Jane Campion entretient avec la littérature (d’une manière générale, mais aussi avec Bronte). Il convient de traduire à l’écran la noblesse de la poésie, de rendre grâce à une forme de romantisme, où la nature accompagne les destins de femmes (ou d’homme) inspirées et inspirantes. Frances O Connor invite le spectateur, un peu moins de deux heures durant, à observer le monde à la manière d’Emily Bronte. Le ressenti occupe une place importante.
La famille également, que ce soit l’attraction et l’amour assumé avec son frère, fanstasque, libre mais superficiel, et inconséquent, ou celle radicalement opposée avec sa soeur Charlotte, bien plus froide, faite de rancœurs, déceptions, rivalités, petites jalousies, et divergences d’opinions mais autrement plus complexe (amour-haine, amour refoulé ou amour complexe en contradiction avec l’amour simple et naturel avec son frère). L’amour, il en est également question, dans la relation qu’Emily Bronte noue avec l’homme à qui l’on confie une part de son éducation, là aussi malgré une grande différence de vision sur la façon d’aborder la vie (l’excès, la passion en opposition à la rigueur, à l’austérité moraliste). Emily aime provoquer, elle aime s’évader, elle aime courir, garder son âme d’enfants, et enfreindre les règles. Le film n’atteint peut-être pas la grâce d’un Bright Star de Jane Campion, mais il réussit cet exercice quasi imposé de nous transposer dans l’œuvre même d’Emily Bronte, dans ces Hauts du Hurlevent, si lyrique,
et de nous en faire ressortir, parfois avec une intéressante habilité et inventivité cinématographique (quelques très jolis plans, quelques jolies transitions, quelques images bien construites qui surgissent d’un ensemble majoritairement plus classique et appliqué). Citons-enfin le remarquable travail sur la langue, les proses empruntés des écrits de Bronte, mais aussi celui sur la langue française, et la remarquable interprétation de l’actrice principale, Emma Mackay particulièrement juste et crédible en Emily Bronte .

The almond and the seahorse de Celyn Jones avec Charlotte Gainsbourg, Rebel Wilson, Trine Dyrholm, Celyn Jones, Meera Syal
Pour Gwen, c’est toujours 1999. Elle ne reconnaît pas le visage qu’elle voit dans le miroir, ni son partenaire, bien qu’ils se réveillent ensemble tous les jours. Le passé de Joe se délite et sa partenaire, Sarah, craint d’être oubliée. Un médecin refuse de les abandonner, déterminé à ne pas les laisser dépérir. Une histoire drôle, poignante et émouvante de deux couples vivant avec une lésion cérébrale et de l’impact de celle-ci sur leurs vies.
Notre avis: *
The almond and the seahorse s’attaque à un sujet difficile, les effets de traumatismes crâniens, à la fois sur les victimes mais aussi et surtout sur leur entourage, en adaptant la pièce éponyme de Kaite O Reilly. Le réalisateur Celyn Jones s’entoure ici d’un casting international attractif, très féminin, pour nous proposer une histoire chorale qui commence par brouiller les pistes, dans une ouverture qui n’annonce pas encore précisément ses thématiques, de façon plutôt habile et intéressante. Le réalisateur, acteur à l’écran et qui interprétait déjà le même rôle dans la pièce, a tenu à changer quelques éléments de la pièce pour la rendre plus acceptable au plus grand nombre. Si sa propre interprétation est convaincante, s’il en est de même de l’ensemble du casting, si quelques instants d’humour très britanniques nous interpellent, le film très rapidement tombe dans une certaine impasse, à trop vouloir précéder le sentiment et les émotions qu’il souhaite véhiculer, de façon trop appuyée et systématique, le tout dans une forme cinématographique manquant d<résolument d’audace.
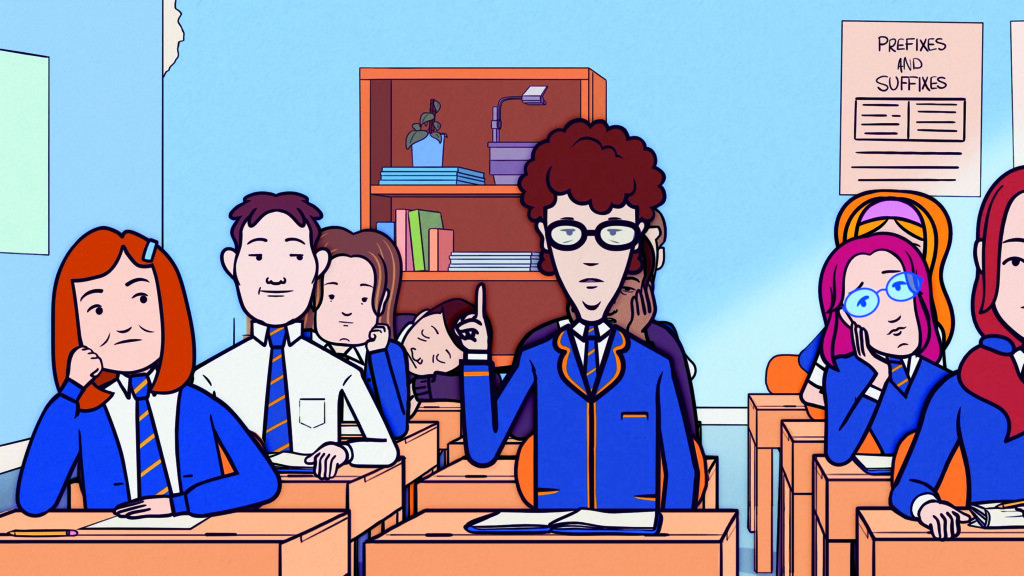
My old school de Jono McLeod avec
L’étonnante et véritable histoire de l’imposteur le plus célèbre d’Écosse. 1993 : Brandon, 16 ans, est le petit nouveau de l’école. Très vite, il devient le premier de la classe, réussit ses examens, se fait des amis et décroche même le rôle principal dans la comédie musicale de l’école. Il est l’élève modèle, jusqu’à ce que son secret soit révélé. Grâce à des animations ludiques, une bande-son parfaite et le talent d’Alan Cumming, ce conte surprenant prend vie.
Notre avis: *(*)
Ce documentaire part d’un sujet intéressant en tant que tel et qui méritait assurément d’être porté à l’écran. Mais le réalisateur en est tellement convaincu qu’il commet l’erreur de le clamer d’entrée et manque ainsi de créer un mystère qui aurait assurément rendu les différents propos collectés plus intéressants. Pourtant, la présentation très graphique, la volonté d’utiliser l’animation pour rendre le récit plus captivant semblait effectivement une excellente idée. Mais le développement très scolaire, la révélation du fait divers dont il est question à mi-film, les répétitions dans les différents discours, et l’absence de bonnes idées de montage ou de moments forts dans les propos en eux même, ne captivent pas et nous laissent à quai. Probablement que la forme fiction aurait permis un traitement plus intéressant, pour s’attarder différemment sur la composante psychiatrique/psychologique qui aurait pu/dû être au centre du développement.

All my friends hate me d’Andrew Gaynord avec Georgina Campbell, Antonia Clarke, Charly Clive, Joshua McGuire, Tom Stourton
C’est l’anniversaire de Pete. Sa bande de copains, rencontrés à la fac, lui organise une fête à la campagne. Néanmoins, Pete est de plus en plus troublé par les blagues et les commentaires sarcastiques de ses amis. Alors que l’atmosphère passe de la gêne à la terreur et au surréalisme, Pete frôle le point de non-retour au cours de ce qui était censé être un joyeux week-end de retrouvailles.
Notre avis: **(*)
All my friends hate me prend le pari de taire son sujet le plus longtemps possible pour dérouter le spectateur, en laissant entrouvertes de fausses pistes. Il s’agit de nous transporter dans l’esprit d’un jeune homme tout heureux de fêter son anniversaire avec ses amis, qu’il retrouve quelques années plus tard. Il s’agit surtout de nous confondre, et de véhiculer tour à tour des sentiments joyeux, craintifs, à instaurer une ambiance trouble, qui risquerait de venir gâcher la fête. La confusion que le réalisateur souhaite traduire et créer quant à l’interprétation que le spectateur peut en faire repose en partie sur les épaules de son acteur principal, ou plus exactement sur son regard que le spectateur est invité à suivre. Les dialogues, au comique très écrit et si anglais, viennent en contraste avec la grande expressivité de l’acteur principal, qui touche tout autant qu’il interroge par son innocence, sa naïveté et ses regards hébétés face à tout ce qui le dépasse mais qu’il cherche malgré tout à conjurer. Le jeu de piste habile dissimulait en fait un sujet plus large, moins léger qu’il n’y parait, et lorsque nous le découvrons, le bon moment passé jusqu’alors nous semble plus conséquent, et si la plastique du film reste quelconque, le prisme narratif nous rappelle quelques belles escapades d’auteurs de renoms dans des univers flirtant avec le genre, de Polanski à Hitchcock. Malin plus que grandiose, à l’instar des films de Sorogoyen, très dans l’ère du temps.

Pirate de Reggie Yates avec Elliot Edusah, Reda Elazouar, Jordan Peters
Le soir du Nouvel An 1999, trois amis, jeunes adultes, s’aventurent dans les rues de Londres, déterminés à terminer l’année en beauté avant que leurs vies ne diffèrent irrémédiablement. Au volant d’une petite Peugeot 205, esquivant les petites amies et les gangs, Cappo, Two Tonne et Kidda sont prêts à tout pour se procurer des billets pour la meilleure fête du millénaire.
Notre avis 1: ***(*)
Notre avis 2: **
Reggie Yates nous propose un cinéma énergique, qui s’appuie sur de bons vieux souvenirs, qui permet de se transporter le temps d’une nuit de réveillon dans le Londres de 1999,
dans un temps de mutation : la vie nocturne très branchée (et électronique) s’installe, des radio pirates voient le jour et véhiculent des sons hip hop,
les premiers téléphones portables commencent à transformer les interactions sociales. Construit tel un film de braquage moderne (qui tendent à se moquer précisément des codes des films de braquage), il souffle sur ce film une énergie vitale que l’on retrouve par exemple dans les premiers films de Spike Lee, auquel on aurait retiré tout militantisme. Avec ce retour à des sentiments simples, et beaucoup d’humilité, Reggie Yates devenu une star de la télévision outre-manche livre un récit plein de peps, oscillant entre moments drôles et tendres.

Winners d’Hassan Nazer avec Hossein Abedini, Parsa Maghami, Helia Mohammadkhani, Reza Naji, Malalai Zikria
Dans une petite ville provinciale iranienne, les enfants travaillent dur pour faire vivre leur famille. Un jour, Yahya, neuf ans, et son amie Leyla trouvent une statuette scintillante dans le désert. Passionné de cinéma, Naser Khan, le patron de Yahya, décide de les aider à retrouver son propriétaire. Une histoire charmante qui démontre le pouvoir du cinéma sur une communauté soudée, dans le monde entier.
Notre avis: **
Winners avance sans surprise dans les pas des cinéastes auxquels il rend hommage, qu’il cite d’emblée. En premier lieu, les paysages iraniens, si chers à Kiarostami, les conversations possibles dans les voitures dont les fenêtres permettent de jeter un regard sur le bouillonnant Téhéran et la société iranienne, rappelant, en mode clin d’oeil, Ten (Kiarostami) ou Taxi Téhéran (Panahi). En second lieu, la reconnaissance internationale obtenue par Majidi et ses acteurs à la Berlinale, mais aussi celle de Farahdi aux Oscars, servent de terrain de jeu à une histoire qui emprunte son principe à Cinéma paradiso de Tornatorre – lui aussi un peu trop directement cité: clamer son amour pour le cinéma,
mettre en place un dispositif immersif qui permette de transmettre cet amour. Amour qui aura conduit Hassan Nazer jusqu’au cinéma nous confiera-t-il, winners étant son histoire personnel, tourné dans les paysages qu’il a connu enfant, lorsqu’il triait les déchets et rêvait de devenir cinéaste comme ses idoles.

