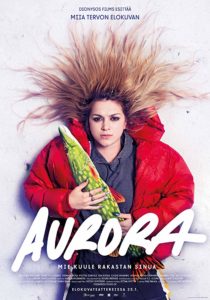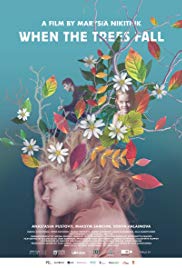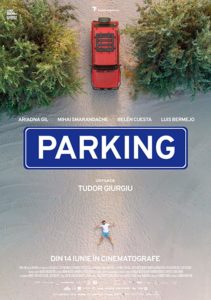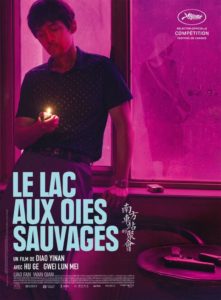Notre couverture vous propose notamment un journal critique de quelques uns des films projetés lors du festival. La note maximale que l’on peut donner est ***** correspondant à nos yeux à un chef d’oeuvre, note que l’on donne très rarement, la note la plus basse est – quand on a trouvé le film très mauvais.
Découvertes européennes
Lola vers la mer (2019, Laurent Micheli)
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Samir Outalbali, Els Deceukelier
La mère de Lola, jeune fille transgenre de 18 ans qui s’apprête à se faire opérer, vient de mourir brutalement. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se voyaient plus, partent pour un drôle de voyage où ils apprendront à mieux se connaître. Loin des clichés, un Road movie chargé d’émotion sur la transidentité et la filiation.
Notre avis *** : Dès sa séquence d’ouverture qui montre au ralenti un adolescent en skateboard, Lola vers la mer emprunte au cinéma de Xavier Dolan. Pour cette introduction, Laurent Micheli s’inspire de Mommy (2014) tout comme, entre autres, pour une scène musicale et dansée dans laquelle Céline Dion est troquée par le groupe Culture club et Boy George chantant Karma chameleon.
Concernant la thématique abordée dans le film, la référence de Micheli est sans aucun doute possible Laurence Anyways (2012). Comme Melvil Poupaud, Lola interprété(e) par Mya Bollaers veut changer de sexe. Ici, la mère n’est plus, le cinéaste décline une relation père-fils conflictuelle : les deux mâles, le père est interprété par Benoît Magimel, ont un point de vue diamétralement opposé sur cette question.
Sur ce sujet propre à railleries et exclusions sociales, Micheli applique un canevas narratif dessinant un parcours d’initiation sur fond de recherche d’identité. Pour ce parcours, le metteur en scène opte pour un film sans fard aux allures de road-movie. Mais pour ces deux hommes, la couleur rose viendra, appliquée à une chevelure ou à une voiture, rappeler que le seul genre visé est féminin. Au bout de la route, pour Lionel (véritable prénom de Lola et révélé tardivement dans le film) et son père, peut-être qu’une réconciliation adviendra.
Madre (2019, Rodrigo Sorogoyen)
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot

Notre avis *** : Remarqué en 2016 avec Que dios nos perdone puis cette année avec El reino, Rodrigo Sorogoyen imagine dans Madre une suite à son court-métrage de même nom. Un magistral plan-séquence multi-récompensé et nommé en 2019 à l’Oscar du meilleur court-métrage. Ce même court-courtage pris dans son intégralité sert d’introduction au film avant que n’apparaisse à l’écran un insert qui portera l’action dix ans plus.
Le film est attendu donc comme une suite à sa version courte et donc une possible œuvre qui viendrait expliquer ce qu’il est advenu dix ans plus tard du jeune fils de Marta (Marta Nieto) laissé seul sur une plage française. Madre dans sa version longue dure plus de deux heures et reconduit dans le rôle principal l’actrice espagnole dans un casting élargi à quelques acteurs français (Frédéric Pierrot, Anne Consigny et le jeune Jules Porier).
Sorogoyen poursuit ses expérimentations dont le réceptacle est souvent de longs plans-séquences savamment orchestrés. Le cinéaste espagnol fait toujours preuve d’une grande maîtrise technique sur ces éléments toujours complexes à mettre en œuvre. Madre se révèle par contre plus laborieux dans sa narration non exempte de répétitions inutiles et qui donnent l’impression d’un film au déroulement empêché.
Aurora (2019, Miia Tervo)
Avec Mimosa Willamo, Amir Escandari, Oona Airola, Hannu-Pekka Björman
Un soir, Aurora, jeune femme désinvolte, rencontre Darian, un immigré iranien. Celui-ci lui demande de l’épouser afin d’obtenir l’asile en Finlande pour lui et sa fille. Aurora refuse, mais elle accepte de l’aider à trouver sa future femme. Une comédie romantique qui décoiffe à l’image de sa touchante héroïne.
Notre avis **(*) : Miia Terco signe avec Aurora son premier long-métrage de fiction. Pour cette première, cette réalisatrice-scénariste finlandaise opte pour une comédie romantique. Mais borner le film à ce seul genre serait trop réducteur. La désinvolture du personnage titre interprété par Mimosa Willamo apporte quelques touches excentriques. L’humour noir construit autour des préjugés raciaux envers les migrants sert d’ultime ingrédient à cette comédie agréable et de bonne facture.
De plus, derrière la comédie émerge des questions plus profondes. Ce film mêle ainsi la question épineuse de l’immigration à celle de l’alcoolisme. Et à la quête d’un pays d’accueil pour Darian, immigré iranien, et sa fille répond la recherche plus classique d’une place dans le monde des adultes pour le personnage-titre. Il fait sens ainsi de faire un parallèle entre d’une part Darian et sa fille, et d’autre part Aurora et son père.
Tu mourras à 20 ans (2019, Amjad Abu Alala)
Avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj, Bunna Khalid, Talal Afifi
Soudan, de nos jours. Peu après la naissance de Mozamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père étant parti travailler à l’étranger, Sakina élève seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, pourtant, Mozamil a 19 ans… Une œuvre forte sur le poids de la religion et des croyances sur la vie d’un individu.
Notre avis *** : Si le réalisateur-scénariste Amjad Abu Alala vit aujourd’hui à Dubaï, il fait partie des rares cinéastes de nationalité soudanaise. Les films soudanais sont rares car ce pays dispose de peu de salles et d’une industrie du cinéma embryonnaire.
Tu mourras à 20 ans est le premier long-métrage de ce réalisateur. Le film s’inscrit dans l’histoire de son pays d’origine mais aussi dans la propre histoire de son auteur. Le titre et le début du film sont prophétiques. Abu Alala oriente les spectateurs vers un film programmatique qu’il ne sera finalement peut-être pas. Les vingt (premières ?) années de la vie de Muzamil (Moatasem Rashed puis Mustafa Shehata) sont livrées par ordre strictement chronologique. Le réalisateur-scénariste privilégie cependant l’adolescence et l’entrée à l’âge adulte de son protagoniste principal dans une quasi unicité de lieu. L’itinéraire suivi se fait initiatique par nécessité alors que les rites ancestraux et religieux forment autant de jalons bornant ce parcours.
Abu Alala porte une attention toute particulière aux couleurs et aux cadres composés avec minutie. Il joue aussi sur l’alternance des séquences entre culture locale ancestrale et projection inévitable vers la modernité. Tu mourras à 20 ans forme ainsi un hymne à la liberté strié de traditions et de malédiction.
Sortie nationale prévue le 12 février 2020.
When the trees fall (2018, Maryssia Nikitiouk)
Avec Anastasiia Pustovit, Maksym Samchik, Sonia Khalaimova
Larysa rêve de fuir le village où elle vit avec sa grand-mère autoritaire et sa jeune cousine, Vitka. Elle projette de s’enfuir avec Scar, un petit voyou, mais rien n’arrive comme prévu et bientôt Larysa se trouve contrainte d’épouser un homme choisi par sa famille. Un conte sur trois générations de femmes, déchirées entre leurs rêves et la tradition.
Notre avis ** : Maryssia Nikitiouk a construit When the trees fall sur la base de nouvelles fantastiques que la réalisatrice-scénariste ukrainienne a écrit sur sa propre enfance. Ainsi le film se pare de textes au caractère enfantin assumé pour restituer une perception pure et magique de la réalité.
Le voyage proposé s’entend tant sur le plan visuel que sur le plan narratif. Il faut reconnaître à Nikitiouk une habileté certaine à la mise en scène. Les cadres et les images produites sont composées avec brio. Mais, parfois démonstrative, parfois posée, cette mise en scène paraît complaisante en regard de la violence souvent gratuite filmée. Et derrière le visuel de ce premier long-métrage, la narration paraît délaissée. Le fil narratif proposé, étiré outre mesure, demeure faible et finalement peu consistant.
Vision de l’Est
La communion (2019, Jan Komasa)
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek
Daniel, 20 ans, s’est découvert une vocation spirituelle en prison. Mais en tant qu’ancien détenu, il ne peut s’engager dans cette voie. Un hasard va cependant lui donner l’occasion d’exercer comme prêtre dans une paroisse où un drame s’est produit quelque temps auparavant. Une œuvre puissante sur la foi, la religion et la rédemption.
Notre avis ***(*) : La communion est le troisième film réalisé par Jan Komasa. Ses deux aînés, La chambre des suicidés (2011) et Insurrection (2014), ont été très remarqués notamment en Pologne, pays du cinéaste. Le scénario du film est inspiré d’une histoire aussi vraie qu’étonnante : un jeune prisonnier se fait passer pour un prêtre. Le parcours tracé, les lieux visités et les personnages secondaires ont été repris en l’état par le scénariste Mateusz Pacewicz.
L’originalité du scénario de La communion est soutenue par une mise en scène dynamique et une narration sans faiblesse. Le film file ainsi à bonne allure au rythme de changements de tons dont Komasa a la maîtrise. Ainsi, le spectateur est surpris tant par l’histoire insolite racontée et les scènes d’une violence crue et explicite.
Parking (2019, Tudor Giurgiu)
Avec Mihai Smarandache, Belen Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo
Adrian rêve de consacrer sa vie à l’écriture. Mais en attendant, il a quitté la Roumanie pour l’Espagne où il travaille comme gardien de nuit d’un grand parking où sont entreposées des centaines de voiture. Sa vie change lorsqu’il rencontre la pétillante Maria, après un concert. Celle-ci décide de tout abandonner pour lui, même si elle ignore bien des choses sur son nouveau compagnon dont le passé ne va tarder à ressurgir au milieu de leur idylle.
Notre avis ***(*) : Tudor Giurgiu, ici scénariste-réalisateur, adapte et porte au cinéma un best-seller roumain publié en 2010. Sous couvert d’une histoire passionnelle, Parking pose un regard singulier sur l’immigration. Adrian, protagoniste principal du film, est roumain et vit depuis six mois en Espagne, loin de sa famille. La singularité de Parking vient du point de vue adopté, à savoir celui d’Adrian. Le film réaliste et âpre n’a pas de velléité qui pourrait le rapprocher de documentaires existants sur ce sujet. Ce qui est porté à l’écran n’est ni plus ni moins que la vérité crue sur la situation commune à de nombreux immigrés : isolement, solitude, exploitation économique.
L’à-propos du film réside dans cette intéressante option narrative. Parking est aussi servi par un bon casting dont la générosité dans le jeu permet au film de sombrer dans la sinistrose. Giurgiu, aussi président de la télévision nationale roumaine, évite cet écueil notamment par sa maîtrise des ruptures de ton et d’ambiance.
Irina (2019, Nadejda Koseva)
Avec Martina Apostolova, Hristo Ushev, Irini Jambonas, Kasiel Noah Asher
Irina travaille comme plongeuse dans un restaurant. Le jour de son licenciement, son mari est victime d’un grave accident. Pour nourrir sa famille, Irina décide de devenir mère porteuse. Mais cela se révèle moins simple qu’elle ne l’avait imaginé. Un premier film maîtrisé qui traduit parfaitement les conflits intérieurs de sa magnifique héroïne.
Notre avis **(*) : Irina est le premier long-métrage réalisé par Nadejda Koseva. La réalisatrice-scénariste bulgare le dédie à toutes les mères et le considère « féminin » mais pas « féministe ». Elle n’épargne pourtant guère son personnage-titre interprété par Martina Apostolova. Irina subit un déluge d’événements contraires qui, même pour ceux ne la concernant pas directement, auront de significatifs impacts sur son quotidien et sa situation déjà précaire.
Cet enchaînement de coups du sort fait un instant craindre un film larmoyant et sans issue. Koseva parvient à éviter ce piège vers lequel semblait s’orienter Irina à toute allure. La réalisatrice inscrit en effet quelques lueurs d’espoir salvatrices dans un film au réalisme et à l’âpreté non feints.
A shelter among the clouds (2019, Robert Budina)
Avec Arben Bajraktaraj, Esela Pysqyli, Irena Cahani, Bruno Shllaku
La quiétude d’un village de montagne où vivent musulmans et chrétiens est soudain brisée par une découverte qui révèle que la mosquée était jadis une église. Un berger, Besnik propose que l’endroit serve de lieu de culte pour les deux religions, mais tous ne sont pas de cet avis. Un hymne à la tolérance religieuse dans un monde qui l’a oubliée.
Notre avis **(*) : A shelter among the clouds, sans distributeur en France, est le deuxième long-métrage de Robert Budina. Avec sa co-scénariste Sabina Kodra, il met en scène une famille partagée entre trois confessions : chrétienne, musulmane et orthodoxe. Cette différence de confession se décline sur le terrain par la mosquée du village qui n’est autre qu’une ancienne église.
Cette église devenue mosquée pourrait constituer un terrain commun et par extension un terrain d’entente entre ces religions. C’est bien là le thème du film. Mais les deux scénaristes s’éloignent de ce sujet dont il faut reconnaître qu’il est délicat à traiter. Le récit s’attarde sur des fils narratifs secondaires rendant l’histoire principale diffuse. Ces éléments ne viennent ainsi pas contrebalancer un personnage principal (Arben Bajraktaraj) peu disserte. Budina s’attarde aussi sur des décors naturels d’une grande beauté que le directeur de la photographie, Marius Panduru, capte avec brio pour générer de magnifiques images qui à elles seules justifient le visionnement du film.
Dans sa narration, les deux scénaristes prennent soin de ne rejeter les torts sur aucune des parties mais ils oublient aussi de prendre position. Nous espérions un plus grand engagement de propos, un message fort et assumé porté plus loin. A shelter among the clouds aurait pu alors être un hymne à la tolérance et aux relations inter-religion. Le film ne reste cependant pas sans issue car il aboutit à une forme de conciliation quelque peu utopique cependant.
Cinémas du monde
Passed by censor (2019, Serhat Karaaslan)
Avec Berkay Ates, Saadet Aksoy, Ipek Türktan, Müfit Kayacan
À la prison d’Istanbul, Zakir, 30 ans, contrôle les lettres que reçoivent les prisonniers. Il s’ennuie ferme jusqu’au jour où sa curiosité le pousse à épier l’épouse d’un détenu, la mystérieuse Selma, convaincu que celle-ci est malheureuse et maltraitée par son beau-père. Les mésaventures d’un doux-rêveur pris au piège de son propre imaginaire.
Notre avis ***(*) : Dans ce premier long-métrage, Serhat Karaaslan bâtit son récit sur la censure des lettres émises ou reçues par les prisonniers turcs. Des agents censeurs comme Zakir (Berkay Ates) lisent ses missives et masquent au stylo les mots ou bouts de phrases soupçonnés de cacher des messages secrets. Passed by censor décrit la réalité d’un environnement carcéral.
De l’aveu du cinéaste-scénariste, Passed by censor est influencé par Fenêtre sur cour (1954, Alfred Hitchcock) notamment par le procédé de créer une histoire à partir d’une image. Tout comme un censure barre des mots, Karaaslan masque certains éléments de son récit pour que celui-ci ne soit pas didactique. Le spectateur se voit chargé d’un travail de reconstitution de l’histoire dans sa complétude sur la base des informations incomplètes délivrées. Le spectateur ne dispose pas de plus d’éléments que le protagoniste principal.
Harcèlement et pression psychologique pèsent de tout leur poids sur le personnage féminin quasi mutique interprété par Saadet Aksoy. Ce personnage est filmé comme une entité fantasmée par Zakir dont l’imagination reste un vecteur inaliénable de sa liberté. Entre les mots, Passed by censor contraint habilement à une lecture entre les lignes qui doit aller au-delà de la dramaturgie mise en œuvre.
Maternal (2019, Maura Delpero)
Avec Lydiya Liberman, Denise Carrizo, Augustina Malale, Renata Palminiello
Lu et Fati, deux jeunes mères adolescentes, vivent dans un foyer au sein d’un couvent de Buenos Aires. Sœur Paola y arrive d’Italie pour prononcer ses vœux perpétuels. Au contact de la maternité des jeunes filles, elle va se confronter à une situation délicate. Un regard bienveillant et nuancé sur l’amour maternel dans un pays où l’avortement demeure illégal.
Notre avis *** : Dans Maternal, Maura Delpero aborde le thème de la maternité en Argentine où l’avortement demeure illégal. Ce premier long-métrage de fiction de la réalisatrice italienne n’a cependant pas vocation documentaire. Delpero axe son scénario selon un point de vue singulier : celui de deux jeunes filles mères placées dans un foyer installé dans un couvent. Entre les murs de ce couvent, deux mondes se confrontent : celui voué à la méditation et à la paix intérieure, et celui fait de conflits intérieurs et de rébellion envers une société où il est difficile de trouver sa place.
Le début de Maternal fait craindre une œuvre binaire avec d’un côté, des jeunes filles en rébellion systématique et de l’autre des sœurs en retrait et silencieuses. Puis Delpero trouve un juste équilibre entre ces deux écosystèmes antinomiques. S’installe alors un récit d’une grande délicatesse même si la violence verbale peut ressurgir à tout moment. Animé d’une mise en scène classique, Maternal relève avant tout d’un pari narratif original que la réalisatrice-scénariste parvient à amener à bon port. Pareil éloge peut être porté aussi à la direction d’acteurs et en l’occurrence d’actrices qui n’en sont pas puisque le casting entièrement féminin est composé de comédiennes non professionnelles.
Le lac aux oies sauvages (2019, Diao Yinan)
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan, Wan Qian, Qi Dao
Un chef de gang recherché par la police, et traqué par une bande rivale, et une prostituée prête à tout pour changer de vie se retrouvent au cœur d’une incroyable chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin. Un film noir virtuose d’une beauté sidérante sur fond d’amour perdu.
Notre avis *** : Présenté au festival de Cannes, Le lac aux oies sauvages n’a pas remporté le Prix de la mise en scène que certains critiques lui voyaient attribuer. Yi’nan Diao, auteur du remarqué de Black coal (2014), propose ici un polar. Un film d’ambiance dont la noirceur n’est pas uniquement liée au fait qu’il soit entièrement nocturne. Le cinéaste chinois inscrit son film au croisement de plusieurs genres. Il y a l’influence du cinéma de Johnny To par les poussées soudaines de violence au traitement graphique. A un degré moindre, le visuel du film et le travail sur sa colorimétrie empruntent à Wong Kar-Wai.
Le lac-titre n’est pas, loin de là, l’unique lieu dans lequel se tient l’action. Devant l’objectif de la caméra de Yi’nan passent de nombreux lieux interlopes et variés. Le travail de repérage effectué sur le terrain est conséquent. Celui relatif à la direction d’acteurs l’est aussi. Les lieux filmés sont ainsi souvent peuplés de nombreux figurants dont les déplacements ne doivent rien au hasard. Il y a dans Le lac aux oies sauvages un vrai travail chorégraphique qui a été mené.
Le scénario ménage de nombreux doubles jeux et va jusqu’à confondre dans leurs méthodes communes, flics et voyous. On est surpris par la quasi absence de musique venant accompagner la narration. La justification de ce choix tient très probablement dans une bande-son très travaillée pleine de sons d’ambiance qui permettent d’élever d’un niveau supplémentaire le caractère anxiogène de certaines séquences. La chasse à l’homme filmée par Yi’nan peut faire écho à M le maudit (1931) de Fritz Lang.
Noura rêve (2019, Hinde Boujemaa)
Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi
Noura a rencontré l’amour de sa vie, Lassad, alors que Sofiane, son mari, est une nouvelle fois en prison. Indépendante, elle travaille dans un hôpital et élève seule ses trois enfants. Les deux amants cachent leur liaison, menacés de 5 ans d’emprisonnement par la loi tunisienne si l’adultère est découvert. Noura a entamé une procédure de divorce, mais Sofiane est soudainement libéré quelques jours avant le jugement…
Notre avis **(*) : Dans Noura rêve, Hinde Boujemaa met en images le combat d’une femme tunisienne (Hind Sabri) mère de trois enfants aux prises avec deux hommes, son mari fraîchement sorti de prison (Lotfi Abdelli) et son amant (Hakim Boumsaoudi). En instance de divorce, Noura vit en cachette son adultère car celui-ci peut être sanctionné d’emprisonnements à l’encontre des amants en Tunisie. Ce rêve doit donc rester caché jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.
Le film assène à Noura de nombreux coups du sort auxquels s’ajoute un mari violent et menteur. L’espoir d’une sortie par la haut fait long feu derrière d’un système kafkaïen où le cynisme fait loi. L’acmé de Noura rêve intervient en fin de film lors d’une longue séquence donnant à voir l’interrogatoire sans complaisance des trois parties par la police. La défense de Noura y apparaît malheureusement affaiblie par son caractère ambigu et en partie incompréhensible. On sent poindre chez Boujemaa une influence certaine en provenance de Asghar Farhadi. Dans ce premier long-métrage de fiction, l’élève ne parvient pas à se hisser à la hauteur de son maître.
Rétrospective : L’Italie de Mussolini
Les années difficiles (1948, Luigi Zampa)
Avec Umberto Spadaro, Massimo Girotti, Ave Ninchi, Delia Scala, Milly Vitale
Sicile, années 1930. Aldo Piscitello, modeste employé municipal, est sommé par le maire de s’inscrire au Parti fasciste sous peine de perdre son emploi. Indécis, il est encouragé par sa femme et sa fille, favorables à Mussolini. Il adhère donc et endosse la chemise noire tandis que les événements s’accélèrent et conduisent, peu à peu, le régime à sa chute.
Notre avis ****(*) : Dès 1948, soit à peine trois ans après la mort de Mussolini et la fin de la seconde Guerre Mondiale, Luigi Zampa fait œuvre pamphlétaire. Son titre ? Les années difficiles, titre programmatique et forcément réducteur, malgré son extrême justesse, par rapport aux souffrances vécues à l’époque. En effet, le cinéaste italien y aborde l’histoire tumultueuse de son pays sur plus d’une décennie courant jusqu’à la fin du second conflit mondial.
Zampa dresse une critique sans fard du régime mussolinien au fil d’événements historiques restitués dans leur ordre chronologique. Il passe tout en revue depuis la montée du fascisme jusqu’à la chute de chef du parti fasciste. Rien n’est oublié de l’implication du régime de Mussolini durant la seconde Guerre Mondiale notamment sur les théâtres d’opération africains mais aussi de l’apport en « oranges » du régime italien au régime franquiste espagnol. De véritables images d’archive et des extraits de bulletins d’information radiophoniques viennent étayer et servir le récit déroulé sereinement sans la moindre baisse de rythme.
L’autre réussite du film réside dans son personnage central singulier. Aldo Piscitello incarné par Umberto Spadaro est un sicilien non politisé. Ce simple agent public se voit menacé de licenciement s’il n’adhère pas au parti fasciste au pouvoir. Alors que son entourage l’encourage à signer cette adhésion, Aldo mène son combat humble de résistant. Jusqu’à quand ? L’irréductibilité d’Aldo place notre héros en marge d’une population italienne, autre cible de la critique menée par Zampa. En ces temps-là, les opinions se faisaient et se défaisaient tout aussi rapidement.
Le jardin des Finzi Contini (1970, Vittorio De Sica)
Avec Dominique Sanda, Fabio Testi, Helmut Berger, Lino Capolicchio
En 1938, le régime fasciste met en place les premières lois raciales. À Ferrare, la jeunesse dorée vit dans l’insouciance et se retrouve pour jouer au tennis chez les Finzi-Contini, une riche famille juive. Entre idylles naissantes, déceptions amoureuses et désirs inavoués, les journées s’écoulent, cependant qu’hors des murs, le pire se prépare.
Notre avis ***(*) : En 1970, Vittorio de Sica réalise Le jardin des Finzi Contini pour traiter du fascisme dans l’Italie à l’aube de la seconde Guerre Mondiale. La famille Finzi Contini est riche, puissante et juive. Elle vit dans une grande maison bourgeoise avec terrain de tennis privé dans un immense parc entouré d’une haute enceinte. La propriété ressemble à une forteresse imprenable. Ces lieux et leurs habitants semblent protégés et isolés du monde extérieur, d’une Italie mussolinienne qui vient de mettre en oeuvre les premières lois raciales.
C’est cette impression d’isolement et de protection qui ressortent du début du film. Le contraste sera fort quand ce commencement sera comparé aux dernières séquences du Jardin des Finzi Contini. L’enceinte paraissait pourtant bel et bien inviolable. Entre ce début et cette fin, les opinions auront changé parfois de façon radicale, nombre de désaccords auront disparu au même titre que certaines illusions.
La mise en scène adoptée par Vittorio de Sica produit quelques images ou scènes datées. Il en va ainsi des gros plans et des zooms avant, surligneurs respectifs des sentiments et les symboles. De même, la préciosité des Finzi Contini et de leurs amis trouve un écrin idéal dans les éclairages mis en œuvre. Enfin, les ralentis composant tout l’épilogue parachèvent ce choix de mise en scène.
La carrière d’une femme de chambre (1976, Dino Risi)
Avec Agostina Belli, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi
En 1935, la jolie Marcella, femme de chambre dans un hôtel à Venise, est fascinée par le monde du cinéma. Elle se rend à Rome pour épouser son fiancé Roberto mais lui préfère un partisan de Mussolini. Sa rencontre avec le Duce fera d’elle une actrice très en vogue. La chute du régime signera la fin de son rêve. Mais Marcella a des ressources.
Notre avis *** : Dans La carrière d’une femme de chambre, la femme de chambre est interprétée par Agostina Belli qui signe dans ce film de Dino Risi l’un de ses plus grands rôles. Tout le récit porte sur son personnage dont la « carrière » va l’emmener à faire de nombreuses rencontres souvent intéressées. Elle croise ainsi le chemin d’hommes plus ou moins célèbres et parmi eux ceux incarnés par Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi.
La carrière d’une femme de chambre s’apparente à un film à sketchs sur le rythme d’une rencontre par sketch. Ce découpage qui ne faisait probablement pas partie des plans initiaux de Risi est contrebalancé par le période couverte : celle d’une Italie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pouvoir politique italien est alors détenu par Mussolini. Avec un humour parfois potache, Risi prend plaisir à critiquer le régime mussolinien et, dès que l’occasion se présente, le tourner en ridicule.