Mis à jour le 13 janvier, 2017
On ne sait pas pour vous, mais au Mag Cinéma, la sortie d’un film de Clint Eastwood c’est toujours un petit événement en soi. Avec Martin Scorsese et quelques autres, Eastwood fait partie de ces rares réalisateurs que l’on peut considérer comme des auteurs à part entière. De film en film, Clint rassure et surprend. Il rassure d’abord de la pérennité de son talent qui s’exprime à travers des thèmes et des motifs devenus de véritables signatures. Il surprend ensuite par sa capacité de renouvellement, partant de ses blasons de prédilection pour proposer une oeuvre en perpétuelle construction. Sully s’intègre donc parfaitement à la filmographie du cinéaste, reprenant et prolongeant à la fois les caractères de ses précédentes productions.
Héros d’Amérique
Eastwood est le conteur d’une Amérique qui se défie des mythes. Chez lui, les petites histoires des héros viennent souvent contre-dire l’épopée nationale. Dès Un frisson dans la nuit (1971), son premier long métrage, l’icône masculine est déceptive, sa légende mensongère et parfois même menaçante. Raconter l’Histoire certes, mais pour la creuser de l’intérieur. Cette persona critique déborde d’ailleurs la seule carrière de réalisateur d’Eastwood et apparaissait dès ses premiers rôles majeurs à l’écran. L’homme sans nom de Sergio Leone ou le Dirty Harry de Don Siegel sont sans doute auréolés de gloire mais celle-ci reste éphémère et se limite en définitive à un acte de violence plus ou moins légitimé et troublant.
Chez Eastwood, il y a toujours quelque chose qui freine les rouages bien huilés de l’élévation programmée. On pourrait classer les héros eastwoodiens en deux catégories. Il y a ceux dont la destinée ne peut se concrétiser que dans la rencontre avec l’Autre. C’est Josey Wales et la communauté de marginaux qu’il fédère (Josey Wales hors-la-loi, 1976) ; Walt Kowalski et l’adolescent coréen qu’il éduque (Gran Torino, 2008) ; Frankie Dunn et la jeune boxeuse qu’il entraîne (Million Dollar Baby, 2004). Et il y a ceux dont les récits sont essentiellement tournés vers eux mêmes, projetant dans l’espace-temps du film leurs blessures intérieures. Il y eut le Jimmy Markum de Mystic River (2003), le Edgar Hoover de J. Edgar (2011), puis le Chris Kyle d’American Sniper (2014), et aujourd’hui Sully Sullenberger qui, d’une certaine manière, formule la synthèse de ces deux classes héroïques.
Pilote de ligne ayant sauvé la vie de 155 passagers en parvenant à atterrir dans la Hudson River, Sully apparaît d’abord comme un modèle d’intégrité. Mais si les médias s’arrachent l’histoire de ce miracle, la société d’assurance ne l’entend pas de la même oreille. Deux sons de cloche qui apparaissent en définitive comme deux formes d’identité. Héros ou escroc ? Sully (s’)interroge. Au sourire satisfait se substitue bientôt le regard plein de détresse. Grâce soit rendue à Eastwood d’avoir choisi Tom Hanks pour le rôle de Sully. Après avoir investit la personnalité de DiCaprio dans J.Edgar, le réalisateur, qui est aussi un grand directeur d’acteurs, a su réemployer à dessein la candeur de Hanks. L’identification opère forcément et la lutte du personnage n’en devient que plus poignante.
Dans un bar, Sully affronte les moqueries de deux ivrognes qui s’amusent de voir double. Il y a le Sully assis au comptoir et celui qui apparaît sur l’écran de la télévision du pub. Modèle et reflet se confondent. Sully arpente les rues new-yorkaise poursuivi par son double. Toute sa quête se résume finalement à récupérer son ombre.
Sully et Eastwood, même combat
En écoutant les propos de la société d’assurance, affirmant que Sully n’a pas suivi la procédure, employant des algorithmes comme preuves, on en vient à penser aux paroles de Steven Soderbergh déclarant dans son état des lieux du cinéma américain contemporain que : « ce qui a des spécificités culturelles et des complexités narratives, et que Dieu pardonne, de l’ambiguïté, va (selon les studios) être un un réel obstacle au succès d’un film » (Positif, n. 645, novembre 2014) avant d’évoquer les fameux algorithmes employés par les majors afin de justifier leur refus de produire un film qui ne répondrait pas à leurs critères d’exigence.
Les simulations de vol comme les projections tests font office d’obstacles à l’art de Sully et Eastwood. Méthodiques, leur approche du cinéma et de l’aviation n’en reste pas moins travaillée par une certaine forme instinctive. Ce que les deux hommes réclament c’est la prise en considération du « facteur humain » à l’intérieur du système déshumanisé du monde moderne.
Sully refuse de changer sa manière de piloter un avion, tandis qu’Eastwood continue coûte que coûte à mettre en scène les projets qu’il aime et qui l’intéresse, soucieux sans doute de donner à sa filmographie la dimension d’une oeuvre pleine et entière. À la manière des grands maîtres du classicisme hollywoodien, Clint infiltre les genres et recycle leurs codes pour servir son discours. Si un Steven Spielberg parvient à légitimer des registres autrefois minorés (animation, science-fiction, film d’aventures, fantastique) en les annoblissant par la reprise du grand geste formel des productions luxueuses types Paramount ou MGM, le procédé d’Eastwood est tout autre. Depuis quelques années, le réalisateur se focalise sur l’un des genres les plus académiques de la profession, le biopic, pour s’en réapproprier l’efficience discursive. Aussi, Sully lui permet d’émettre un discours post-11 septembre, nourri de propos patriotiques mais néanmoins lucides sur l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire américaine.
Eastwood apparaît en fait comme le premier et le plus digne héritier de Frank Capra. C’est ainsi qu’il faut comprendre le paradoxe inhérent à sa persona publique et artistique. Conservateur, Clint l’est sans doute mais dans son versant le plus démocratique. Eastwood et Capra croient en l’Homme, en sa capacité à réagir, à fédérer une communauté, que celle-ci relève d’un enjeu national (M. Smith au Sénat, Invictus) ou d’un acte de survie (l’équipage de Sully qui dans une certaine mesure peut rappeler celui des Horizons perdus). Ce qui intéresse les deux réalisateurs, c’est le rapport ambivalent de l’individu au groupe social. Le second détermine l’humanité du premier, conférant une morale à chacun de ses gestes. Reste à voir si le citoyen se pliera à cette loi, s’il la refusera ou s’il parviendra à la transformer à son avantage. Sully Sullenberger ou le John Doe de notre époque.
Dans cette perspective, le happy-end de Eastwood ne doit pas être perçu comme une concession mais bien comme la volonté de rétablir une justice universelle. Pour optimiste qu’il soit, le dénouement de Sully ne peut faire oublier les tonalités sombres de sa première partie, tout comme la conclusion bienveillante de La Vie est belle (1946) restait marquée par la sinistre séquence du cauchemar. La palette de Tom Stern, chef-opérateur attitré d’Eastwood rappelle celles de George Barnes et Joseph Walker. L’éclairage high-key est progressivement contaminé par les ténèbres conférant aux compositions une valeur picturale oscillant entre le spiritualisme charnel du Caravage et le réalisme esthétisant des toiles de Rembrandt. Entre l’ombre et la lumière plane la figure de Clint qui signe ici l’un des meilleurs films de l’année 2016.
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer








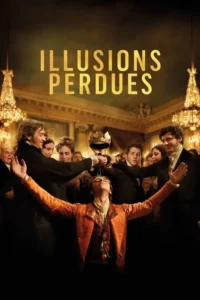
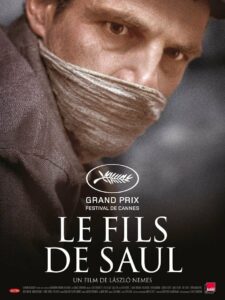





Soyez le premier a laisser un commentaire