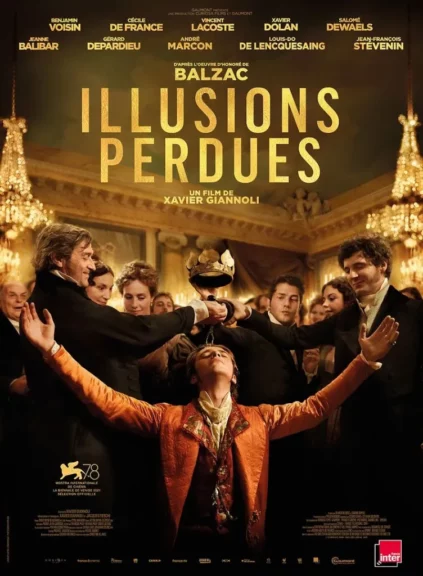
Le 22 août 1850, il pleuvait sur le cercueil d’Honoré de Balzac, emportant sa Comédie Humaine avec lui, et son indéfectible tempérament d’écrivain. Cette légende de la littérature, un abcès à la jambe, qu’Hugo, à son chevet, décrivit comme une « odeur de cadavre [qui] emplissait la maison1 », aurait demandé à son personnage médecin Bianchon de le sauver (Ah oui ! Je sais. Il me faudrait Bianchon, Bianchon me sauverait, lui2). Hugo, toujours, rédigea lors des obsèques de Balzac : « Non, ce n’est pas la nuit, c’est la lumière ! Ce n’est pas le néant, c’est l’éternité. N’est-il pas vrai, vous tous qui m’écoutez ? De pareils cercueils démontrent l’immortalité ». L’auteur des Misérables vit miraculeusement la postérité de Balzac. De nombreux auteurs s’inspireront d’Honoré de Balzac, notamment Emile Zola, qui expliquait dans Les Romanciers Naturalistes, publié en 1881, que « Balzac a créé un monde, non pas sans le vouloir, mais sans savoir au juste quelle serait l’action formidable de ce monde. » Ce monde précisément, les cinéastes pareillement l’utiliseront, si bien que l’on compte aujourd’hui plus de 170 adaptations du petit écran à la grande toile, de la reproduction la plus fidèle que possible (Eugènie Grandet, de Dugain) jusqu’à l’interprétation pure, telle que Peau de chagrin, d’Alain Berliner. L’un des derniers en date, Illusions Perdues (2021), réalisé par Xavier Giannoli, nous intéresse tout particulièrement pour ses rapprochements avec la vie de l’auteur, et, plus largement, son univers.
Un hommage à la Comédie Humaine.

Adapter le roman le plus long de l’écrivain tient de l’hommage à l’œuvre toute entière de Balzac, puisque le roman Illusions Perdues compte près de 70 personnages sur les 2 000 mis en scène dans sa grande fresque, la Comédie Humaine. Bien que le film ne se concentre que sur dix de ses personnages, nous pensons que Xavier Giannoli s’y confronte, notamment par des rotations perpétuelles de caméra sur le plafond du théâtre, où des peintures représentent des archétypes de la commedia dell’arte, (00:48:20), lesquelles rappellent les cercles d’influences et renvoient au jeu théâtral auquel les personnages doivent se plier pour garder leur place dans ce milieu, ou pour y accéder, ce que les mouvements circulaires symbolisent.
Par ailleurs, La Comédie Humaine brille par ses personnages qui, tels des fils tissés dans une vaste tapisserie, réapparaissent et évoluent d’un récit à l’autre. Giannoli en fait l’écho dans Illusions perdues : lors de la scène finale au théâtre (02:17:11), Coralie (Salomé Dewaels), jouant Racine, est piégée dans une mascarade orchestrée contre Lucien de Rubempré. Impuissant, ce dernier voit défiler sous ses yeux les figures marquantes du récit : Lousteau (Vincent Lacoste), Finot (Louis-Do de Lencquesaing), Singalis (Jean-François Stévenin) et Dauriat (Gérard Depardieu).
Des références directes à la littérature balzacienne.

Ensuite, et sur un point plus précis, le film de Xavier Giannoli reprend un thème qui est cher à l’écrivain : la figure de Napoléon. Le réalisateur ne se contente pas d’afficher le visage de l’empereur pour combler une séquence, il l’utilise de façon parabolique, c’est-à-dire qu’il compare la montée sociale de Lucien avec la montée de Napoléon, jusqu’à sa chute, toute aussi brutale. Cette analogie, plutôt discrète, se remarque à l’arrivée de Lucien à Paris par un tableau de Napoléon tendant le doigt, montrant le chemin à une génération nouvelle, elle, en direction de l’homme moderne, concrètement arriviste (18:08). Au départ, le jeune poète part à Paris pour une conquête littéraire, mais qu’il abandonnera vite, à cause de l’influence de Lousteau, et par des désillusions qui pousseront Lucien à la débauche, à l’argent facile, et plus largement poussé par le désir insatiable de pouvoir qui causera sa perte, et que le réalisateur image par à un buste de singe coiffé d’un chapeau napoléonien, à côté d’une bouteille de champagne, tout en tenant une pipe fumante (01:46:43), soit toutes les distractions que Balzac constatait dans Traité Des Excitants Modernes (« L’ivresse est un empressement momentané […] le tabac, l’opium et le café, trois agents d’excitations semblables, sont les causes capitales de la cessation des facultés génératives »). D’ailleurs, cette idée de la société corruptrice s’apparente à un concept philosophique attribué à J.J. Rousseau, très en vogue à l’époque d’Honoré de Balzac, et que le long-métrage appuie.
D’autres références demeurent dans le film, à savoir des livres de l’auteur. Nous notons les affiches éparpillées à plusieurs reprises représentant l’huile de Macassar, que l’on connaît par le roman César Birotteau, un autre arriviste perdu dans les milieux de l’immobilier et de la parfumerie (00:17:08). Plus subtilement encore, une autre affiche, titrée La Sévillane (00:45:13). Celle-ci figure certes dans Illusions Perdues, mais nous la retrouvons aussi dans La Muse Du Département ; où figure d’ailleurs un personnage actif dans le film, en la personne de Lousteau.
Les allusions aux romans de Balzac, outre les décors dans lesquels elles se nichent, se retrouvent plus directement dans les dialogues, notamment à l’incipit de Peau De Chagrin et cette réplique prononcée par Vincent Lacoste (01:55:21) : « Tu serais où sans moi ! Au fond de la Seine ! », puisqu’elle fait référence à la tentative de suicide de Raphaël de Valentin, lui aussi à Paris pour embrasser une carrière littéraire et philosophique qui ne vient pas.
Des fragments de la vie d’Honoré de Balzac dans le film Illusions Perdues.

Naturellement, le film Illusions Perdues réutilise des thèmes que Balzac dénonça avec cynisme, et qu’il connut de son vivant.
Originaire de Tours, le regard d’un provincial débarquant à Paris ne lui est pas étranger ; entrepreneur malchanceux entre ses 25 et 30 ans, il sait tout des activités économiques qui vendent tout et rien à la fois (nous pensons à l’imprimerie, pour rester dans le thème du film et son engagement…) ; il connait la rémunération à la ligne, que ce soit pour des romans ou des articles, dont il tire cette phrase tout aussi fatale que paradoxale : « Si la presse n’existait, il ne faudrait pas l’inventer ».
Xavier Giannoli n’en reste pas là. Il ne cherche pas uniquement des thèmes, mais bien le fait anecdotique, comme l’ananas.
C’est dans la bouche de Depardieu, qui incarne Doriat, un éditeur analphabète, que le cinéaste expose ce fruit exotique : « Moi, je ne jure que par l’ananas ! » (00:43:31). Ce lien avec Balzac s’observe avec éclat, car le père du réalisme, après avoir acheté une résidence en 1837 à Ville-d’Avray, confia vouloir se lancer dans la culture de cette denrée rare, heureusement restée sur le papier !
Nous amenons maintenant une hypothèse, cette fois-ci, sur les costumes ; plus précisément la canne ! Dans l’ensemble du film, rares sont les caractères qui en possèdent ; seul dans ce cas Du Châtelet (André Marcon), par son titre de baron – symbole de pouvoir. Pourtant, Lucien, à l’instar de Du Châtelet, en obtient une, alors lui-même au sommet de sa gloire, se rêvant comte (01:47:11). Ne pourrions-nous pas voir ici une référence à la canne massue du Napoléon des lettres en train de se pavaner à la manière de Lucien ?
De surcroît, dans l’adaptation, le rôle de Depardieu (notons-le, dans le téléfilm de Josée Dayan, sorti en 1999, Depardieu jouait Balzac) pourrait être aussi la voix de l’écrivain, puisqu’il rappelle à Benjamin Voisin la destinée de son personnage (01:32:50) ; et nous le retrouvons, surtout, lors de la scène finale, décrite plus haut, indifférent, détaché, tel un prophète observant la fatalité de ce provincial égaré dans les méandres parisiens. Et Giannoli ne se limite pas à Depardieu, le grand comédien, pour porter cette voix. Tout aussi saisissant, Xavier Dolan, dans le rôle de Nathan – un personnage hybride mêlant D’Arthez et une création originale du cinéaste –, pourrait lui aussi incarner Balzac. Dans la scène finale, où Lucien regagne Angoulême, Nathan se révèle comme l’auteur de son histoire, un rôle esquissé dès l’ouverture par la voix-off.
L’œuvre cinématographique Illusions Perdues s’avère donc une épitome qui surpasse son sujet puisqu’elle rassemble, comme nous l’avons vu, de nombreuses références, d’une part aux larges thèmes de la Comédie Humaine, jusqu’à la vision ciselée de l’écrivain sur la société de son temps, et d’autre part, à la vie de l’auteur proprement.
Cependant, il serait maintenant intéressant de connaître l’implication du réalisateur dans son film, c’est-à-dire s’il existe une part personnelle, biographique, traçable entre son oeuvre et la vie de Balzac ou les thèmes balzaciens, voire (peut-être) avec les deux…
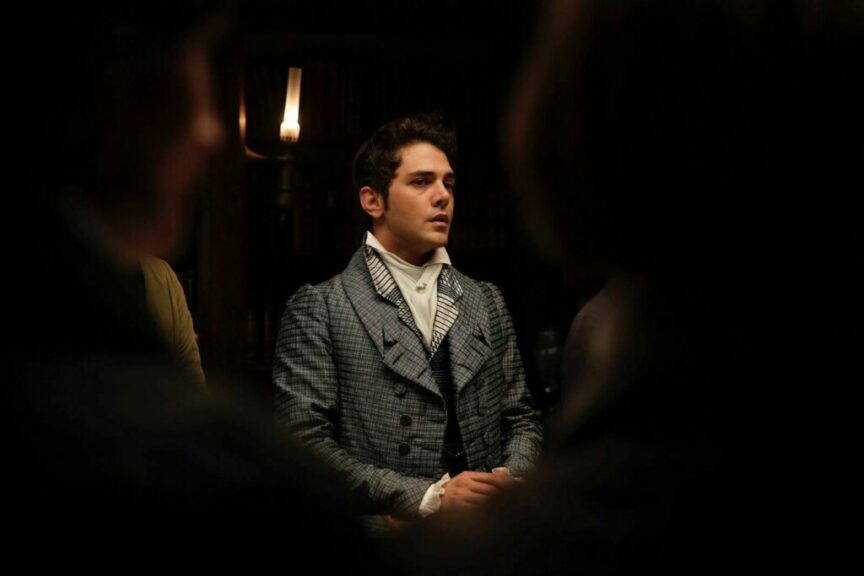

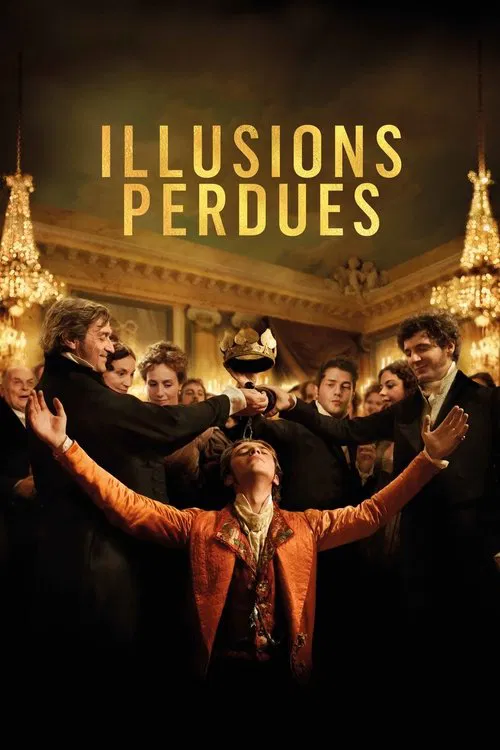

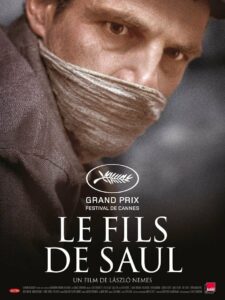


Soyez le premier a laisser un commentaire