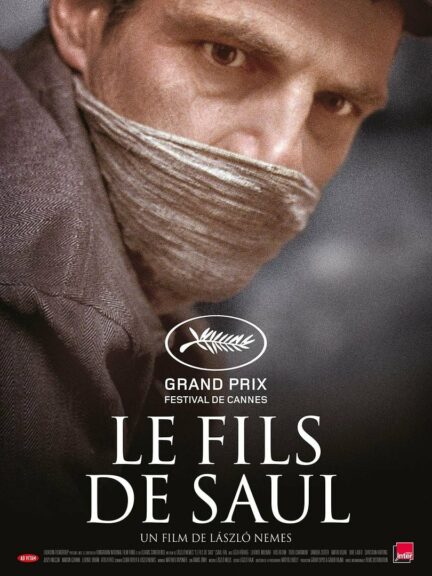
Après seulement deux courts-métrages, László Nemes connut, en 2015, un fier succès avec Le Fils De Saul, récoltant de nombreux prix, dont l’Oscar du meilleur film international. Bien que le réalisateur hongrois n’apprécie pas le terme de « sujet » au cinéma, l’histoire de Saul, un sonderkommando enrôlé dans les camps d’Auschwitz-Birkenau à la fin de la guerre, implique obligatoirement toute la mémoire de cette période, générant un a priori filmique que Nemes dépasse admirablement. L’histoire, qu’il met en scène à l’aide de sa caméra 33mm, peut paraitre modeste vis-à-vis du contexte singulièrement sordide, voire trop modeste ; or, ce parti pris, qui peut en dérouter plus d’un, annonce simplement un père -ou un possible père- qui chercherait à enterrer son fils en plein horreur des camps. Cette idée s’avère soutenue par la suggestion du réalisateur, cassant, par conséquent, tous les codes installés, laissant entrevoir l’horreur par devoir de mémoire (Le Pianiste est un bel exemple pour les ghettos de Varsovie). Ces codes, qui consistent à témoigner de l’horreur par devoir de mémoire, László Nemes les utilise pour son film, mais à contre courant, c’est-à-dire qu’il profite du devoir de mémoire ou sollicite la mémoire et l’imagination du spectateur pour dénoncer les horreurs commises par les Nazis, rendant son propos puissant d’originalité, et surtout, interprétable ! Nous nous intéresserons donc à comprendre les mécanismes de ce film léché, au succès tout aussi brillant que la discrétion médiatique du réalisateur.
Une suggestion visuelle et auditive qui enrichit l’action en second plan.
László Nemes fut l’un des assistants-réalisateur de Béla Tarr – réalisateur hongrois très friand des lents plans-séquences (Le Cheval De Turin, 2011 et reconnu pour son long Sátántangó 7h20) – duquel il tirera sans doute son inspiration ; car le point de départ [du] Fils De Saul comprend des caractéristiques esthétiques et narratives similaires : le flou à l’arrière-plan, une caméra focalisée tantôt sur l’épaule du personnage principal, incarné par Géza Röhrig, tantôt en satellite, gravitant autour de lui, tandis que Saul lui-même se trouve en perpétuel mouvement (les trois premières minutes, qui servent de prologue, amorcent déjà cette envie de brouiller les sens du spectateur), renouvellent le genre, entre drame et film de guerre, invitant le spectateur à mouvoir son imagination de la même façon que les déplacements du personnage.
Quant au son, voire la musique, l’usage classique consiste banalement à accompagner une action ou une émotion pour illustrer l’état d’esprit d’un caractère. Cependant, dans le cinéma de Nemes, les silences, les voix tourbillonnantes, le raclement en cadence des pelles, déconstruisent cet usage pour rénover le tout, avec le travail de Tamas Zanyi, en un véritable personnage ; du moins, un personnage polyphonique et polymorphe, comme le propose, par exemple, la triste scène d’élimination par balle dans laquelle nous pouvons entendre des paroles de nationalités différentes sur des moitiés de corps (1h09).
Ces deux éléments témoignent de la facilité du réalisateur à mettre en scène son film, qu’il enrichit notamment par un va-et-vient hors champ constant, forçant le spectateur à une permanente interprétation spatiale ; si nous devions aller plus loin, nous pourrions même dire que le spectateur doit échafauder une reconstitution historique tant les faits paraissent isolés et supposent donc des liaisons entre eux pour saisir l’ensemble des actions menées, peut-être à l’instar du personnage principal qui, dans toute cette misère, se fraie un chemin jusqu’à sa mission, en oubliant, ou en faisant mine d’oublier, la révolution des sonderkommandos qui gronde et qui éclate à la fin du long-métrage.
Saul, un archétype de la déshumanisation ?

La lenteur des plans-séquences, la concentration sur le point de vue de Saul, les actions en hors champ et le travail sur le son, poussent le spectateur à comprendre majoritairement le film dans les yeux de Saul tant la focalisation dirige le film ; mais pour ce qui s’agit des humeurs, le réalisateur, par sa direction d’acteurs, ne recycle pas le traditionnel stéréotype des émotions, à commencer par la tristesse, que d’aucuns auraient fait ressortir, à outrance, pour « montrer pour montrer » l’ineffable barbarie. Au contraire, pour pointer ce funeste quotidien, László Nemes demande à son acteur un ton essentiellement neutre, ce qui réifie le personnage en un automate appliquant, sous la contrainte bien sûr, un programme infligé ; les rares moments de joie ne se comptent qu’à deux reprises : lorsque Saul nettoie le corps de son fils où il esquisse un début de sourire (1:17:37), ainsi qu’à la fin du film, cette fois-ci, pour un sourire total. En ce qui concerne les autres émotions, évidement la peur se lit sur les visages, surtout sur les visages secondaires ; mais nous aimerions proposer un autre point de vue qui serait la crainte, pour la raison que le personnage principal vacille tantôt de l’automate à l’animal, tantôt de l’animal à l’automate – la scène où Saul feint de réparer la gâche d’une porte pour mieux observer son environnement et pour photographier le camp (29:00/30:50)) l’exemplifie. Enfin, un sonderkommando se sait condamné, sait qu’il va mourir, cette épée de Damoclès, qui flotte au-dessus de la nuque de Saul, le conditionne cependant dans une incertitude telle qu’elle témoignerait aussi d‘une déshumanisation, puisqu’il est réduit à l’état d’esclave, donc privé de libre-arbitre et à la merci des sections secrètes ; Nemes nous le rappelle avec cette fameuse croix rouge inscrite au dos de Saul qui peut symboliser à la fois la focalisation citée plus haut, et à la fois, le sceau, la marque du condamné.
Saul ou la double libérations des camps ?

« T’as été chercher un rabbin chez les morts ? » prononce l’un des personnages qui organise la révolution d’Auschwitz. Cette question oratoire démontre toute la volonté, toute la ténacité de Saul pour sauver l’âme de son fils. Cet ordre qu’il se donne, presque suicidaire, relève d’un courage extraordinaire au même titre que le courage des résistants et résistantes qui préparent leur évasion. De notre point de vue, c’est sur cette double mécanique, presque antithétique, que László Nemes réussit à rendre son film convaincant : Saul répond à cette phrase du Talmud « qui sauve une vie [l’âme de l’enfant] sauve l’humanité entière » ; tandis que les autres tentent de sauver les vivants. Il y aurait, alors, chez Saul, un ordre prophétique, messianique qui sauverait une âme de l’oubli, emportant, avec elle, toutes les autres âmes errantes.
« Mais tu n’as pas de fils », une fin ambiguë ?

Néanmoins le courage que Saul incarne reste à nuancer, car le courage n’entretient pas nécessairement une relation directe avec la vertu, avec le bien. Par exemple, un braqueur de banque fait tout autant preuve de courage pour voler de l’argent qu’un policier pour arrêter des hommes armés. De ce fait, et en lien avec notre première partie, nous pouvons nous questionner sur la rationalité des actes de Saul… plus clairement, ne serait-il pas fou ? Rappelons qu’il met en danger des personnages autant qu’il se met en danger ; la question reste ouverte… En attendant, les prédispositions à la folie semblent trop nombreuses pour que celui-ci vive indemne : assassinat de masse, pression perpétuelle, maltraitance répétée, conditionnement et hygiène de vie insupportable, relatent autant de facteurs qui valideraient la supposition de la folie, ce qui, à notre lecture, expliquerait l’avant-dernière scène du film et soutiendrait le penchant délirant puisque Saul perd le cadavre de son fils dans le fleuve, fleuve qu’il tentait de traverser, quitte à se noyer (d’ailleurs, savait-il nager?) s’il n’avait pas été repêché par le prétendu rabbin (1:37:50). Enfin, une autre interprétation possible concerne l’ultime scène (celle avec le petit garçon qui crée involontairement un sourire fleurissant à Saul avant que celui-ci se fasse éliminer), que nous pouvons inférer comme une allégorie de la vie -jeunesse de l’enfant- face à la mort omniprésente, que Saul incarne, car le personnage s’avère conditionné d’une part en objet, d’autre part en animal, soit une une belle opposition que l’on peut étendre à l’amour « filia » du protagoniste, c’est-à-dire l’amour familial, donc la vie, et la mort, le « thanatos » du nazisme. On aperçoit donc un manichéisme dans l’ensemble du long-métrage que le réalisateur n’hésite pas à trancher, notamment à la fin, puisque Saul meurt sous les balles et que l’enfant est renvoyé à sa liberté. Toutefois, pouvons-nous apercevoir une double libération, c’est-à-dire une libération physique de l’enfant et une libération spirituel de Saul ?

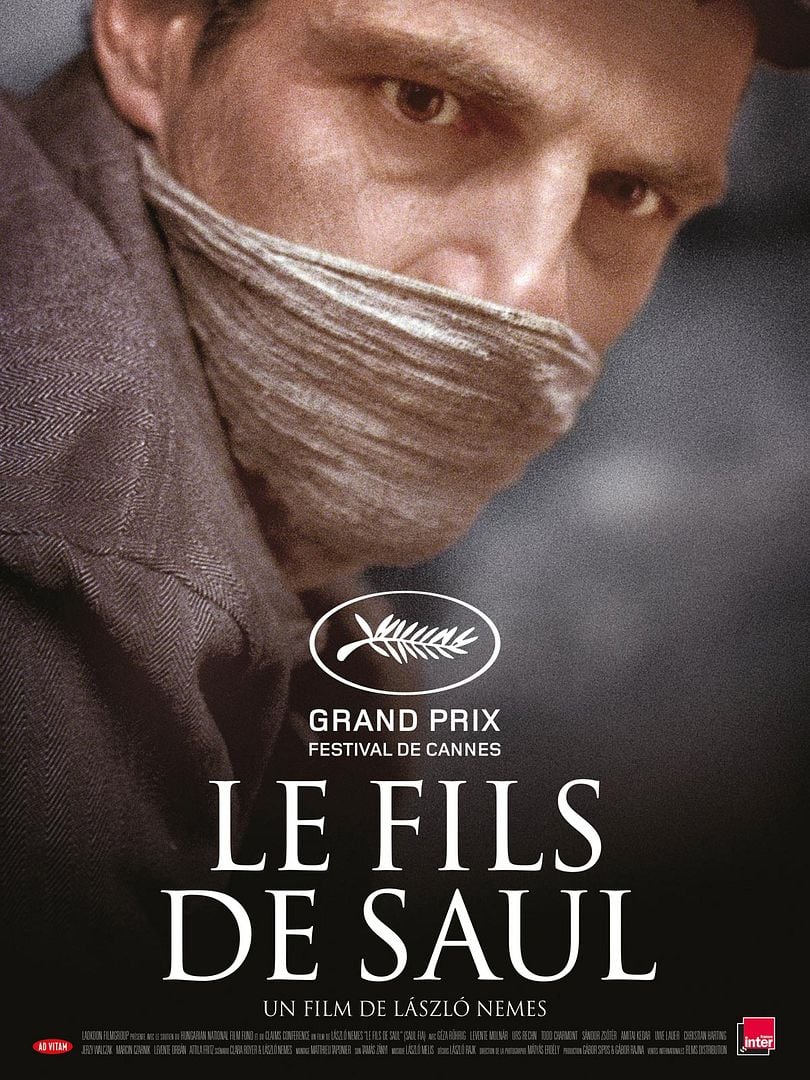

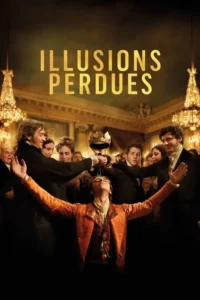


Soyez le premier a laisser un commentaire