Mis à jour le 6 février, 2017
Certains films marquent durablement l’histoire du cinéma. Point de bascule entre deux périodes, œuvre matricielle aux dimensions universelles, ces productions sont peu nombreuses, parfois trompeuses, souvent surévaluées de par leur praticité. Car, faire l’histoire par étapes n’est pas chose aisée. La découverte d’un film oublié peut en effet remettre en cause un parcours parfaitement rôdé. Depuis une dizaine d’années, certaines études consacrées au cinéma du début du XXe siècle forcent l’intérêt de par leur volonté à discuter les fondements de l’histoire du cinéma. Griffith, pionnier ? Pas forcément si l’on se reporte à l’ensemble de la filmographie de Edwin S. Porter (Le Vol du Grand Rapide, 1903). Je crois néanmoins que, si l’on veut bien considérer l’art cinématographique en partie comme une science, les films matriciels sont nécessaires à notre compréhension de l’histoire de ce médium. Et Blow Up (1966), ressorti en salles cette semaine, est de ceux-ci. Sa portée touche autant l’œuvre de Michelangelo Antonioni, son réalisateur, que le cinéma dans son ensemble.
Cinéma expérimental
Blow Up est le premier des trois films que Antonioni réalisa à l’étranger pour le compte de Carlo Ponti, producteur à la MGM. Au début des années soixante, L’Avventura (1960), La Nuit (1961) et L’Éclipse (1962) configuraient une sorte de trilogie prévenant de la rupture définitive du cinéaste avec le néoréalisme (une clôture qu’annonçait déjà, il est vrai, l’inoubliable, Le Cri en 1958). Deux ans plus tard, Le Désert rouge (1964) se présentait comme le premier film en couleurs d’Antonioni, et faisait entrer son œuvre dans une nouvelle ère formelle. Blow Up marque donc le début de son exil. En Angleterre, le réalisateur prend la mesure des (r)évolutions culturelles de son époque. D’une certaine manière, Antonioni échappe grâce à ce voyage au risque de sclérose que suppose toute recherche d’unité. Le cinéaste renoue avec la réalité d’un contexte sociale différent de l’Italie. Ce n’est pas tant les problématiques politiques qui l’intéressent que la question de l’individu, de son rapport avec les autres et avec lui-même. Blow Up, c’est l’histoire d’un photographe et dandy londonien (David Hemmings) qui prend soudain conscience de l’importance de l’image. À l’accumulation des clichés du shooting de mode se substitue la présence d’une image unique sur laquelle se projettent des interprétations sans fin. Photographie en apparence anodine : un parc, un couple, mais qui contient pourtant la présence incongrue d’un cadavre. Comme dans son premier long métrage, Chronique d’un amour (1950), Antonioni et son scénariste Tonino Guerra, inspirés par une nouvelle du romancier argentin Julio Cortazar, dépassent le cadre du film policier pour interroger la condition humaine.
L’Avventura, La Nuit, L’Éclipse et Le Désert rouge s’achevaient sur une note déceptive. Antonioni déclarait alors l’impossibilité de la romance et le déclin inévitable de l’amour. Cette pensée ne disparaît pas tout à fait mais apparaît transformé dans Blow Up. En Angleterre, Antonioni se détache des traditions dramatiques de son pays, et explore davantage la face essentialiste de son cinéma. Plus de mélodrame à combattre, seulement un espace à explorer, défricher pour mieux affirmer son impossible découverte. La célèbre séquence voyant le photographe participer à un jeu de mimes ne doit pas être comprise autrement. Las de son enquête, le personnage renvoie la balle imaginaire. Le son off et le mouvement de caméra figurent la possibilité d’une apparition. Il s’agit ici d’une expérience à laquelle participe le public : nous suivons des yeux un objet qui n’existe pas, et pourtant, par notre déplacement oculaire, nous attestons de sa réalité, et, par ce mouvement même, la séquence nous invite à éprouver notre propre rapport au monde.
À propos du cinéma d’Antonioni, les stéréotypes et formules préconçues ne manquent pas. Antonioni, ce serait l’ascèse, l’errance, le vide, l’incommunicabilité surtout. C’est qu’on réduit souvent son œuvre à quelques passages tirés de l’Avventura, sans doute son film le plus dépouillé, une épure cependant nécessaire à la bonne continuité de son œuvre. C’est un peu vite oublier la photographie baroque de Gianni Di Venanzo pour La Nuit, les jeux chromatiques du Désert rouge, les expérimentations vidéo du Mystère d’Oberwald (1980, sans doute son film le plus mésestimé à ce jour), ou encore la célébration visuelle de Chung Kuo, la Chine (1972). La communication chez Antonioni est autre, et il ne serait pas inutile de rappeler que le silence ne signifie pas toujours une absence de mots. La parole ce peut être un geste, le dialogue un contact avec la matière, aussi insignifiant soit-il. Le déplacement du photographe de Blow Up, s’enfonçant doucement dans le parc, a plus d’éloquence que tout monologue exprimé à l’oral. Cet apparent désistement – que reste-t-il de l’enquête policière ? Plus rien – prend la forme d’une résistance qui se concrétisera tout à fait dans la séquence finale Zabriskie Point (1970) voyant un regard faire exploser par sa seule attention une maison et avec elle toute la société consumériste du monde occidental des années soixante-dix.
Une œuvre internationale

En 1967, Blow Up remporte la palme d’or. Belle revanche pour Antonioni qui avait vu le Festival de Cannes accueillir L’Avventura avec le mépris des huées (le film sera alors soutenu par quelques rares critiques et cinéastes clairvoyants tels que André Bazin et Roberto Rossellini, et remportera le Prix du jury). Succès critique et publique, Blow Up impressionne et sidère. Outre-Atlantique, les jeunes réalisateurs du Nouvel Hollywood sont marqués par l’œuvre au point d’en proposer leur propre version. Ce sera Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola, Blow Out (1981) de Brian De Palma, ou encore les errances spatio-temporelles de Richard C. Sarafian.
Car Blow Up semble s’adresser directement à cette génération touchée par l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy et à son impossible résolution. Pour eux, comme pour Antonioni, le happy-end n’aura pas lieu, et la fin, d’ailleurs, manque à l’appel. Le meurtre, comme la disparition restée inexpliquée de L’Avventura, est une trouée, un vide qu’il faut accepter comme tel. C’est le néant, entendu comme une force positive, qui imprègne le destin de ces nouveaux héros. Mais le réalisateur qui parviendra le plus à se rapprocher de l’atmosphère du film d’Antonioni n’est pas américain. C’est en effet l’italien Dario Argento qui signera avec Profondo Rosso (1975), la plus belle variation. Ce giallo aux tonalités fantastiques place David Hemmings au cœur d’une réflexion sur la représentation artistique. Dans cette œuvre à découvrir ou à redécouvrir absolument, le danger vient des reflets et des portraits, des ombres qui accompagnent la traversée d’un héros parti à la recherche d’une réponse sans forcément connaître la nature de ses propres interrogations.

Blow Up marque le début et la fin d’une époque, d’une manière de considérer le cinéma et ses images. Près de dix ans plus tard, Antonioni réalisera Profession : reporter (1975) qui, dès son ouverture, annonce la clôture du regard. Nulle mort de l’art ici, mais un nouvel appel au voyage. Vers les déserts d’Afrique et d’Espagne cette fois, paysages archaïques qui rappelleront ceux des derniers films de Pier Paolo Pasolini. Comme si, pour ces hérauts de la modernité, la vérité ne pouvait passer que par un retour au primitif.
Blow Up en cela marque bien une étape. La déliaison qu’il faut ici percevoir comme un raccord d’un type nouveau convoque une nouvelle manière de capter le monde. Aujourd’hui encore, le film d’Antonioni apparaît comme un passage inoubliable pour qui souhaite comprendre l’histoire du cinéma, ses évolutions et ses prolongements contemporains. Pour nos lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur l’œuvre d’Antonioni, les références bibliographiques sont nombreuses, et nous n’en retiendrons que quelques-unes. D’abord le Antonioni de Roger Tailleur et Paul-Louis Thirard paru aux Presses Universitaires de France en 1963, monographie rédigée par une main de maître par deux pionniers en la matière et qui synthétise à merveille la première partie de sa filmographie ; ensuite, Le cinéma d’Antonioni d’Alain Bonfand, publié en 2003 aux Images modernes, qui adopte une démarche philosophique tout à fait en phase avec la pensée du réalisateur ; enfin, l’Antonioni publié chez Flammarion en 2015 et placé sous la direction de Dominique Païni, directeur de l’exposition Antonioni à la Cinémathèque française, afin de découvrir les différences facettes de sa personnalité artistique (littérature, photographie, peinture, et cinéma bien sûr).






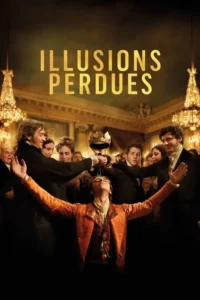
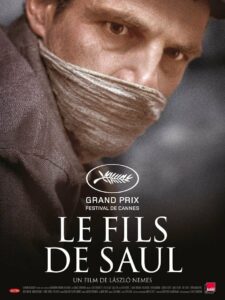





Soyez le premier a laisser un commentaire