Gene Hackman, figure familière du Nouvel Hollywood a été retrouvé mort à son domicile à l’âge 95 ans le 18 février 2025. Sa filmographie riche de 77 films s’étale de 1967 à 2004.
À 16 ans, Gene Hackman falsifie son âge pour s’engager dans les Marines comme opérateur radio. Cinq ans de service, des passages en Chine et au Japon, puis une tentative d’études en journalisme qui tourne court. Il enchaîne les petits boulots, tâtonne, se cherche. Et puis, un soir, une révélation : en regardant Sur les quais, il comprend. Ce sera le cinéma. Il prend des cours de théâtre et se lance dans une décennie de galère où il accumule les petits boulots en attendant de décrocher un rôle à Broadway, ou à la télévision à la quête du cachet pour survivre. Avec son colocataire, un illustre inconnu du nom de Dustin Hoffman, il décide de partir pour la côte ouest.
Il tente de démarrer sa carrière au cinéma sous le soleil californien mais Hackman n’a ni le physique lisse de Paul Newman ni la gueule d’ange de Warren Beatty. Avec sa silhouette massive aux allures d’ancien quarterback, son physique d’Américain ordinaire de la middle class, il est aux antipodes des canons hollywoodiens de l’époque. Il persévère, malgré tout et fait une rencontre déterminante en la personne de Warren Beatty sur le tournage de Lilith de Robert Rossen en 1964.

Et puis vient Bonnie and Clyde (1967). Warren Beatty, star et producteur du film, s’acharne à imposer Arthur Penn à la réalisation. Le résultat explose tout sur son passage, traçant les contours du Nouvel Hollywood. Gene Hackman y décroche sa première nomination aux Oscars, prélude à une carrière fulgurante. Il trouve l’un de ses plus beaux rôles dans le trop méconnu Les Parachutistes arrivent (1969) de John Frankenheimer, aux côtés de Burt Lancaster. Dans ce film intimiste au cœur de l’Americana, il démontre qu’il peut passer de la grande gueule qui fera sa marque de fabrique à une tendresse touchante. En 1971, French Connection le propulse au sommet. Sous la direction de William Friedkin, il incarne Popeye Doyle, flic brutal, raciste virant à l’obsession et rafle l’Oscar sous le nez et à la barbe de Walter Matthau et George C. Scott. French Connection II (1975), cette fois mis en scène par John Frankenheimer, prolonge la légende : fracassé et drogué sur la Canebière par un impitoyable Fernando Rey, sous l’œil de Bernard Fresson, Doyle devient une figure absolue du flic borderline, un héros fatigué avant l’heure.

Mais s’il est une décennie qui propulse Hackman, c’est bien les années 1970. Il y brille autant que Pacino, De Niro ou Hoffman, sans pour autant leur ressembler. Là où ces derniers jouent les cérébraux, torturés, lui propose tout autre chose : pas de performance, juste une vérité brute. Il n’incarne pas, il est. Sa force réside dans cette authenticité, cette crédibilité totale. Conversation secrète (1974) en est le sommet. Sous la caméra de Francis Ford Coppola, Hackman devient Harry Caul, silhouette fantomatique, presque transparente jusque dans ses vêtements, rongée par la paranoïa, engloutie par un monde qui l’écrase. Un grand rôle pour un grand acteur dans cette palme d’Or 1974.

Les années 1980 s’avéreront plus inégales. Il y alterne les projets alimentaires et les rôles de prestige. Il confirme son rang d’acteur populaire dans la comédie sur le basket (Le Grand Défi, 1986), mais c’est Mississippi Burning (1988) d’Alan Parker qui reste dans les mémoires et le remet au centre du jeu. Face à Willem Dafoe, il incarne un agent du FBI confronté à la violence raciste du Sud profond qui lui vaut un prix d’interprétation à la Berlinale.
S’il accepte parfois des projets moins ambitieux dans leurs intentions artistiques à Hollywood, il saisit les opportunités de tourner à New York avec Woody Allen (Une autre femme) et Sidney Lumet (Les Coulisses du pouvoir).
Puis Clint Eastwood lui offre, en 1992, l’un de ses plus grands rôles : Impitoyable, grand succès public et critique. Little Bill Daggett, shérif impitoyable et cruel, vaut à Hackman son deuxième Oscar. Un salaud monumental, à la hauteur de l’Amérique désabusée et crépusculaire qu’il incarne depuis ses débuts.
Hackman a toujours été du côté des marginaux (Bonnie and Clyde, L’Épouvantail) et des hommes aux méthodes brutales pour défendre leurs idéaux (French Connection, USS Alabama). Il porte en lui une certaine mauvaise conscience de l’Amérique, sa violence omniprésente.
Et puis, en 2004, soudainement, il décide de mettre un terme à sa carrière. Hollywood a beau insister, Hackman ne reviendra pas sur sa décision. Il prête toutefois encore sa voix à deux documentaires sur les Marines, comme pour boucler la boucle, puis disparaît de la vie publique et hollywoodienne.
Une sortie discrète, à son image. Un dernier pied de nez à une industrie qui, au fond, n’a jamais su où le ranger ailleurs que dans la caste des légendes.




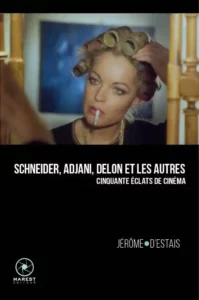
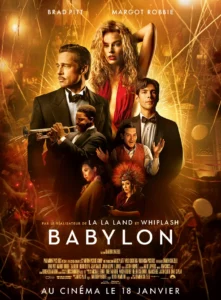
Soyez le premier a laisser un commentaire