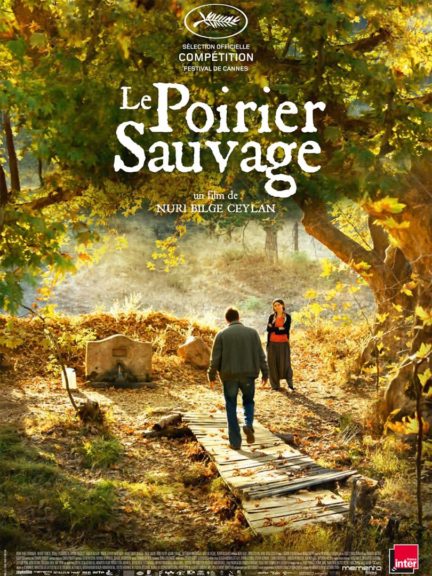Le poirier sauvage s’inscrit dans la continuité de l’oeuvre de Nuri Bilge Ceylan, qui film après film, dresse des portraits et des tableaux qui se répondent les uns aux autres, se confrontent ou se prolongent. Lorsque nous l’interrogeons en conférence de presse sur ses secrets de fabrication, il nous avoue longuement et humblement, qu’il n’en a pas plus que cela, qu’il cherche la précision, à toute étape, dans toutes les composantes de son cinéma, qu’il recherche tout simplement l’inspiration en permanence là où son histoire l’emmène. Il cite facilement son attrait pour Doistoievski, ou Tchekov; mais nous pourrions tout aussi bien rapprocher son travail de celui d’un Zola (Les Rougon Macquart) ou d’un Balzac (La comédie humaine) qui accorderait une large place à l’impression, au visuel [dit autrement au cinéma], tant son regard semble se fixer sur l’homme d’une manière générale, inscrit dans une contemporanéité: une temporalité à la frontière entre tradition et modernité, un pays et une géographie que le maître connait, puisqu’il s’agit de la Turquie. A contrario d’Hugo, il fait évidence que quand Bilge Ceylan nous parlent des autres, il nous parle de lui, de ce qu’il observe, de ce qu’il connaît, de ce qui l’intéresse, le nourrit, et de ce qu’il ressent et pense.
Le langage cinématographique lui sied parfaitement, il lui permet de croiser les arts, de rendre hommage à des auteurs. Son travail est profond, intemporel, et intelligent – à une époque où la chose devient rare, voire turpide. S’asseoir dans son siège bien confortablement, se laisser déconcentré par quelques bruits de popcorn, s’attendre à vibrer, à rire, pleurer, frissonner, voire à être étonné n’est pas exactement ce à quoi le cinéma exigeant de Bilge Ceylan invite – sic. La promesse est bien plus celle d’un voyage philosophique, intérieur, qui s’autorise des pauses, des arrêts sur images, des contrastes, des évolutions, et quelques saillies souriantes inattendues.
Verbeux , on peut même dire bavard, « Le poirier sauvage » bénéficie d’un très bel habillage musical, tout en justesse et délicatesse, parfaitement adapté pour marquer l’intemporalité possible du récit, tout comme la magnifique photographie si constante dans toute son oeuvre.
Nous suivons les pas d’un jeune homme 3 heures durant, pour mieux le connaître, découvrir ses pensées, ses relations à ses parents, à son pays. Tel un petit précis de philosophie en soi, seront brassées tour à tour les thématiques de l’amour, de l’art, de l’argent, de la religion, du rapport au père, du rapport aux autres d’une manière générale, du temps, de la nature … Bilge Ceylan en profite pour livrer un regard acerbe, et raille tout à la fois la modernité et la tradition, moquant tour à tour les tartufes, les corrompus, les auto-satisfaits, les profiteurs – la marche forcée de la société, où la notion même de valeur tend à disparaître . Quelques moments de pur cinéma viennent compléter ce très beau récit, assurément très écrit -tiré d’un roman puis reconstruit à plusieurs mains – conçu tout entier comme un tableau.
S’il s’agit de tenter un tant soit plus de vous convaincre de l’expérience, sachez que Bilge Ceylan, cet excellent peintre, ce très bon dramaturge, sait en outre user de quelques artifices oniriques, de quelques ficelles narratives elliptiques intelligentes et du plus bel effet (les saisons, les changements de climat, la musique utilisée à très petite dose) pour intensifier sa narration, rendre plus accessible la réflexion qu’il nous propose.
Certes, le film est verbeux, long, et ce pourrait être un reproche, mais le réalisateur turc maîtrise si bien son récit, qu’il réussit à ce que les interstices, dans les quelques vides laissées ici ou là, soient chargées de sens. A l’instar d’un Faulkner, il se pourrait même que la matière -le message subliminal – même de son récit s’y glisse.