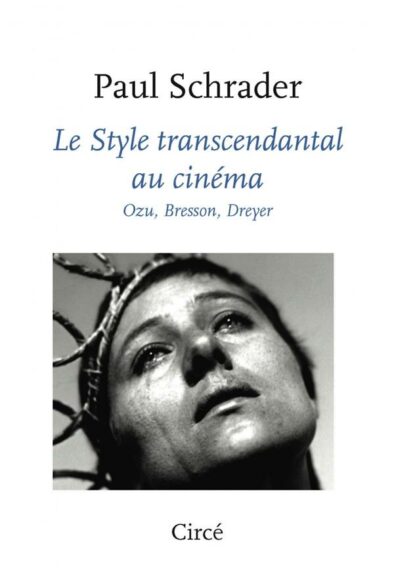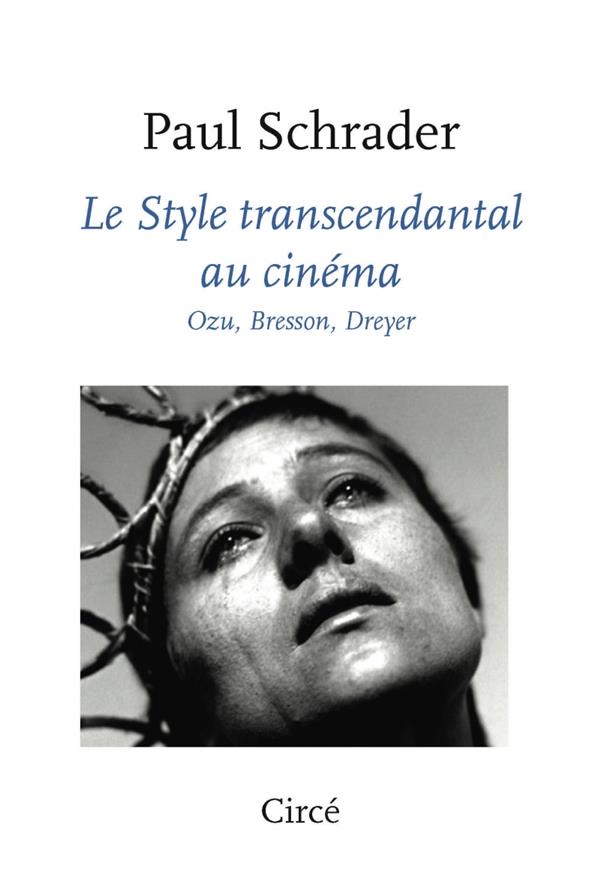
Pierre Rodrigo est philosophe, Professeur émérite de l’Université de Bourgogne (Dijon). Ses recherches portent sur la philosophie antique, la phénoménologie et l’esthétique. Publications principales :
- Aristote, l’eidétique et la phénoménologie, 1995
- Aristote et les « choses humaines », 1998
- L’Étoffe de l’art, 2001
- Intentionnalité créatrice. 2009
- Sur l’ontologie de Marx. Auto-production, travail aliéné et capital, 2014
- Les Montages du sens(Philosophie, cinéma, arts plastiques) 2017
- Post-phénoménologies, 2021
– Bonjour, et merci d’avoir accepté cet entretien. Vous êtes philosophe, et outre vos ouvrages dédiés à la philosophie, vous avez écrit un livre consacré au cinéma : « Les Montages du sens ». Est-ce que vous analysez le cinéma d’un point de vue philosophique ? Vous qualifiez-vous d’une manière générale de cinéphile ? Pourriez-vous nommer, s’il vous plaît, vos cinéastes préférés ?
Je dirais, pour commencer par vos deux dernières questions, que j’ai été cinéphile avant toute autre chose. Il ne fait pas de doute pour moi que mes premières émotions esthétiques ont été liées aux films de la Nouvelle Vague. Mon goût a été formé par Godard, Truffaut, Rivette etc., sans oublier Duras, Rozier et Eustache. C’était, en somme, la formation de la jeunesse d’une époque (celle des années 68), une époque gaie et généreuse que Schrader a vécu lui aussi à New York et Los Angeles et qui l’a entièrement modelé. Je me suis ensuite familiarisé avec l’histoire du cinéma en fréquentant assidûment la Cinémathèque de Toulouse qui, sous la direction de Raymond Bordes, Guy-Claude Rochemont et Jean-Paul Gorce, présentait des programmes somptueux.
C’est alors qu’est apparue la nécessité de conceptualiser, si possible, à hauteur de cette liberté créatrice. D’où la philosophie ; en particulier Deleuze, Bergson et Merleau-Ponty, qui ont tous trois théorisé l’expérience cinématographique et ses rapports avec les notions philosophiques de mobilité, d’être et de devenir. Je ne dirais néanmoins pas que j’aborde le cinéma, et l’art en général, « d’un point de vue philosophique », car ce serait placer les concepts philosophiques en surplomb de l’expérience cinématographique, comme si la philosophie détenait le dernier mot quant au cinéma. Deleuze a été très clair sur ce point : entre philosophie et cinéma il y a résonance réciproque des problèmes, déstabilisation des certitudes et relance des questions, mais jamais application au cinéma d’un savoir philosophique préalable.
– Comment avez-vous connu la thèse de Schrader ? qu’est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce texte et vous a donné envie de le traduire ?
Mon essai de 2001 sur « L’Étoffe de l’art » insistait, dans une veine anti-idéaliste, sur les aspects matériels du style. J’avais tenté de montrer comment l’image peinte ou sculptée produit du sens à même sa matérialité, et pas seulement (voire pas principalement) en référence à l’idée qu’elle est censée rendre sensible. Un exemple frappant, et tout à fait récurrent en art, en est l’effet de montage des plans, des angles, des formes et des couleurs que ménage le style de tout grand artiste (entre mille autres Carpaccio, Michel-Ange, Rodin, Cézanne, les dadaïstes et les expressionnistes).
D’où mon intérêt pour une note de l’ouvrage de Deleuze sur le cinéma dans laquelle figure une allusion (rapide mais suggestive) à un livre de 1972, quasi inconnu en France, du cinéaste américain Paul Schrader, dont le titre « Transcendental style in Film. Ozu, Bresson, Dreyer » semblait inscrire son auteur dans une tradition clairement idéaliste, sinon même mystique, en tout point opposée à ce que je pensais du cinéma. La lecture de ce brillant essai d’un jeune homme de 26 ans frais émoulu de l’Institut de Cinéma de l’UCLA et futur scénariste de Martin Scorsese, puis lui-même cinéaste, m’a fait découvrir une analyse fascinante des pouvoirs de l’image et du style cinématographiques lorsqu’ils affrontent ce qui constitue assurément pour tout art son plus haut défi : exprimerle sacré, le « Tout Autre », sans jamais le réduire à une signification, en rendre la présence patente sans jamais le représenter. C’est ce que Schrader a appelé « le style transcendantal » : un travail dans la structure même des images, dans leur logique la plus concrète, la plus matérielle, comme c’est le cas chez Ozu, Bresson et, dans une moindre mesure, Dreyer.
– Depuis quand projetez-vous de le traduire ? D’après vous, pourquoi n’était-il pas traduit et publié jusqu’ici alors que c’est une œuvre théorique fondamentale ?
En 2016 j’ai contacté un éditeur pour envisager la traduction et la publication française du livre de Schrader. J’étais déjà engagé à cette époque avec les éditions Circé dans la mise au point finale de mon essai sur « Les montages du sens », paru l’année suivante. Dès le début Claude Lutz, le directeur de Circé, m’a apporté tout son appui. Il a le goût des défis éditoriaux, et je pense que l’idée de rendre justice à un texte effectivement fondamental dans le champ de la théorie cinématographique, mais néanmoins injustement méconnu en France, l’a séduit. Je tiens à rendre hommage à sa confiance. L’essai de Paul Schrader avait été rapidement traduit en italien et en espagnol, mais rien n’avait été fait dans le domaine francophone (traditionnellement frileux en la matière) sinon la traduction de quelques extraits du livre dans les « Cahiers du cinéma » en mars 1978.
– Avez-vous pu rencontrer Paul Schrader et lui parler de votre traduction ?
Cela aurait pu se faire au Festival de Venise en 2022, à l’occasion de la remise du « Lion d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière » que lui avait décerné le jury. Mais ça n’a pas été possible, en partie parce que Schrader était tombé assez gravement malade sur le tournage de son dernier film, « Master Gardener ».
– Schrader parle de Deleuze et de son livre en deux tomes « L’image-temps » et « L’image-mouvement ». Personnellement, je trouve que Deleuze s’est inspiré de la thèse de Schrader pour son ouvrage ; est-ce que pour vous les deux textes sont complémentaires ?
« L’Image-mouvement » et « L’Image-temps » ont respectivement paru en 1983 et 1985. Dans « L’Image-temps » Deleuze fait seulement deux allusions rapides au livre de Schrader, dont il ne connaît que la traduction partielle d’une vingtaine de pages du chap. I due à Dominique Villain dans les « Cahiers du cinéma » (1978). La tonalité de ces deux notes de bas de page est en fait négative, dans la mesure où Deleuze y déplore que (selon lui) Schrader semble confondre à tort le « transcendantal » au sens kantien avec une « irruption du transcendant ». Cette confusion est, ajoute-t-il avec une certaine désinvolture, commune aux « Américains » et à leur « goût (sic) pour le transcendant ». Quelles que soient les immenses qualités de l’analyse deleuzienne du cinéma, il faut bien reconnaître que ces deux notes sont tout à fait injustes. J’espère que l’accès à la traduction intégrale du « Style transcendantal au cinéma » permettra au public francophone de s’en rendre mieux compte. On pourra alors considérer l’approche kantienne de Deleuze et celle de Schrader comme complémentaires et non plus opposées.
– Est-ce que le texte de Schrader s’inscrit dans une tradition critique (critique de cinéma au sens large) ou est-ce simplement un texte théorique ?
Ce livre s’inscrit clairement dans une tradition critique de type européen : chez le jeune Schrader comme chez les jeunes critiques des « Cahiers du cinéma » qui deviendront les réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, la critique appelle l’engagement dans la réalisation – car, comme l’écrivait Godard, ce serait une faute morale d’abandonner le film aux « professionnels de la profession » ! Dans son milieu Schrader est d’ailleurs un polémiste né, ainsi que ses divers démêlés juridico-financiers avec les studios hollywoodiens en témoignent. Loin d’être seulement théoriques, les prises de position du « Style transcendantal… » appellent donc déjà, et justifient, la noirceur sociale épurée, la rupture décisive du quotidien et la présence finale du sacré qui caractérisent le splendide scénario de « Taxi driver » écrit pour Martin Scorsese (Palme d’or à Cannes, 1976).
– Le spectateur cinéphile connaît Paul Schrader en tant que scénariste/cinéaste. Est-ce que vous établissez un lien entre cette thèse, qu’il a écrit très jeune, et les films qu’il a écrits et réalisés plus tard ?
Oui, bien sûr. Ce lien est évident ; il est même consubstantiel à son style cinématographique. Schrader a certes dit et répété que le premier de ses films à avoir mis explicitement en œuvre les principes théoriques exposés en 1972 dans « Le Style transcendantal… » a été, en 2017 seulement, « First reformed » (distribué en France en 2018 sous le titre « Sur le chemin de la rédemption »), qui est un hommage direct au « Journal d’un curé de campagne » de Robert Bresson. Mais cette référence appuyée à l’un des trois cinéastes qu’il avait étudiés en détail dans sa thèse ne masque nullement le fait que chacun des films réalisés par Paul Schrader met très clairement l’accent sur l’inexplicable irruption du sacré dans un quotidien stylistiquement épuré. C’est vrai, par excellence, de « Taxi driver », mais aussi bien de « Hardcore », « Blue collar », « Mishima », « The Card counter » ou « Master gardener ».
– Schrader propose sa propre définition de l’art (en l’occurrence le cinéma) transcendantal, et applique sa théorie à trois exemples précis. Dans quelle mesure cette théorie vous semble-t-elle pertinente aujourd’hui, et applicable aux autres cinéastes (ou artistes) ?
En 1972 il s’agissait pour Schrader d’élaborer des concepts théoriques inédits et une nouvelle méthode d’analyse pour rendre compte avec précision des divers essais de manifestation du sacré au cinéma. Il touchait par là à la question tout à fait centrale de la limite des pouvoirs de l’image devant l’Absolu ou l’imprésentable. Ozu, Bresson et Dreyer se sont alors imposés à Schrader par la rigueur avec laquelle ils ont cherché à mettre œuvre un style voué à l’expression du sacré. Schrader a analysé en détail la logique interne de la construction des images chez ces trois cinéastes, et a ainsi construit sa doctrine du « style transcendantal ». À aucun moment cependant il n’a songé à limiter cette doctrine à ces trois auteurs seulement, qui avaient valeur « d’exemples » particulièrement suggestifs par leur rigueur logique – on pourrait aussi dire par leur ascèse stylistique. Schrader s’en est clairement expliqué dans l’importante Introduction à la deuxième édition de sa thèse, en 2018, dans laquelle il a rappelé sa formation à l’UCLA et ses ambitions de jeune critique, puis de jeune cinéaste marginal. Mais cette nouvelle Introduction lui a surtout donné l’occasion d’une vaste synthèse critique passionnante sur la période de temps et de création qui s’étend de la cinéphilie et de la nébuleuse « art et essai » des années 70’ jusqu’à l’émergence et la consolidation actuelle de ce que l’on nomme le « slow cinéma ». L’actualité de son interprétation apparaît en toute clarté à la lecture de cette Introduction, que j’ai traduite elle aussi, et qui figure en « Postface » de l’édition Circé.
– Schrader a été l’élève de Rudolf Arnheim et il a soutenu sa thèse sous sa direction. Comment la pensée et le travail de ce théoricien a-t-il inspiré les recherches esthétiques de Schrader ?
La pensée multiforme de Rufolf Arnheim et l’intérêt de ce chercheur pour la logique des phénomènes visuels dans la perception humaine, au cinéma ou encore en architecture, a nécessairement dû influencer Schrader durant ses études sous sa direction. Il a trouvé chez cet éminent intellectuel allemand, émigré aux USA pour fuir le nazisme, une théorie d’ensemble de type gestaltiste de la « structure » des phénomènes visuels – théorie exposée en particulier dans des ouvrages aussi essentiels que « La Pensée visuelle » ou « Dynamique de la forme architecturale ». Mais l’ouvrage de Arnheim qui fut sans doute déterminant pour Schrader est « Film as Art », publié en 1932 (trad. fr. « Le cinéma est un art », 1989).
– Schrader raconte qu’on écrivant ce texte il cherchait à concilier son amour du cinéma et son éducation religieuse. S’il en est ainsi, est-il nécessaire d’avoir une croyance religieuse (ou spirituelle), ou en tout cas de croire au sacré, pour comprendre le propos de Schrader concernant l’art transcendantal ?
Étudier, comme il l’a fait, les exigences logiques qui pèsent sur l’image de cinéma lorsqu’elle ose se mesurer au divin et au sacré c’est évidemment, pour un cinéaste d’éducation religieuse stricte (comme ce fut le cas de Schrader auprès de l’église réformée de Grand Rapids, Michigan), rechercher une conciliation ou un moyen terme dialectique entre Présence et représentation, ou entre l’Absolu et ses éventuelles images. Cependant, considérée et développée du strict point de vue de l’histoire de l’art et de ses formes, cette recherche est toute différente de l’expérience vécue de la foi. Elle implique simplement de ne pas trahir esthétiquement l’expression propre du sacré quand il se manifeste, c’est-à-dire de ne pas lui imposer des formes visuelles inadéquates, par exemple trop spectaculaires (cf. « Les Dix commandements » de Cecil B. deMille).
– Comment, selon Schrader, les notions de « quotidienneté », « disparité », et « stase », structurent-elles les images transcendantales ?
Tel que Schrader le définit et l’analyse le « style transcendantal » met en lumière, dans un premier temps, la structure même du quotidien. Il en donne donc une sorte d’épure stylisée. Cette opération de « réduction » est particulièrement nette chez Yasujiro Ozu et chez Robert Bresson. Sur cette base structurelle le sacré peut venir se manifester de façon abrupte en rompant de manière inattendue voire traumatique, la trame de la « quotidienneté ». Cet instant disruptif est celui de la « disparité », celui de la présence imprévisible d’une altérité radicale au sein du quotidien : l’irruption du « Tout Autre », la révélation amoureuse, la soudaine évidence d’une mission, etc. Le troisième moment structurel du style transcendantal est constitué par la « stase ». C’est le moment d’acceptation du mystère de la présence efficace de l’inexplicable.
– Comment Schrader analyse-t-il et remet-il en question la notion de transcendantal chez Kant ?
À vrai dire, il n’en parle nulle part explicitement dans sa thèse. Il précise simplement dans l’Introduction de 1972 dans quel sens il convient d’entendre ce qu’il nomme « transcendantal » : « Le présent essai centrera ses analyses sur l’art transcendantal, l’art qui exprime le Transcendant au miroir de l’humain ; des œuvres fabriquées de main d’homme qui sont davantage expressives du Tout Autre que de leurs créateurs individuels ». La différence avec la notion kantienne de « transcendantal » est patente, puisque chez Kant cet adjectif s’applique à la possibilité a priori qu’a le sujethumain de donner sens par lui-même, et donc de connaître, les phénomènes dont il fait l’expérience et qu’il comprend dès lors comme ses phénomènes. Selon Schrader au contraire, cette maîtrise de la signification par la connaissance subjective est justement ce que l’expérience du sacré (et le film de style transcendantal) dément.
– Quel sens donnez-vous à la formule : « exprimer n’est pas signifier » lorsque vous l’appliquez au cas de Schrader ?
J’ai employé cette formule pour synthétiser ce qui est à mes yeux le projet fondamental de Schrader : établir et justifier la distinction qui doit être faite entre la signification, dont l’origine, ou la source, est humaine (c’est le niveau du « transcendantal » kantien) et l’expression qui, elle, trouve son origine et sa puissance du côté de la manifestation du sacré elle-même, indépendamment de nos facultés à la circonscrire, ou non, par notre sensibilité et notre entendement. L’expression est donc tout autre chose que la signification : la première est caractérisée par une puissance d’effraction in-humaine à jamais incompréhensible ; la seconde, par la dimension humaine de la donation de sens.
– Comment Schrader explique-t-il la différence entre le style et la forme ?
À proprement parler, le style est forme, c’est même la forme par excellence puisqu’il constitue, en quelque sorte, la signature du travail singulier d’un auteur dans la langue commune. À cet égard, le style est bien, comme André Malraux l’a écrit, la « déformation cohérente du langage » qu’un auteur cherche à imposer. D’après Schrader, le « style transcendantal » se singularise par le fait qu’il se voue à l’expression du Tout Autre et non à la signification d’un sens produit par la connaissance humaine. Une série de « déformations cohérentes » s’ensuit, qui rend patente – mais non pas connue – une Présence qui fait brèche.
– Dans la Postface, Schrader revient de façon très sincère sur sa jeunesse et sur l’époque où il a écrit ce livre. Il parle aussi de Tarkovski. Quelle analyse porte-t-il sur l’œuvre de ce cinéaste en tant qu’auteur d’une importance cruciale pour le développement de sa propre pensée théorique ?
Il reconnaît à Andreï Tarkovski un rôle de « point pivot » dans le changement d’orientation du cinéma vers ce qui s’est ensuite appelé le « slow cinéma ». Deleuze avait déjà accordé à l’œuvre de Tarkovski un statut éminent dans la transformation de « l’image-mouvement » du cinéma classique en « image-temps ». Il est en effet certain que les écrits théoriques et les films de ce réalisateur mettent avec constance l’accent sur la dimension temporelle qu’un plan de cinéma devrait avoir (thèse que Tarkovski développe en opposition frontale aux premiers cinéastes russes, Eisenstein et Vertov en particulier, et à leurs théories de la préséance du montage temporel sur le plan statique). Ce n’est donc plus au seul montage qu’il incombe d’agencer la structure temporelle du film, mais bel et bien aux plans. On devine combien cette conception tarkovskienne a pesé sur le développement ultérieur du slow cinéma, dans lequel chaque plan est étiré temporellement bien au-delà de ce que la simple signification narrative imposerait – et, par là même, exprime bien plus qu’il ne signifie.
– Quel est le lien entre le « slow cinéma » et le « style transcendantale », et comment Schrader applique-t-il la notion de « slow cinéma » aux œuvres contemporaines ?
Dans son Introduction de 2018 à la deuxième édition du « Style transcendantal… », Schrader reconnaît une réelle convergence dans les effets produits par ces deux styles. Mais il ne soutient à aucun moment que le slow cinéma aurait pu dériver d’une façon ou d’une autre du style « transcendantal » tel qu’il l’avait analysé en 1972, ou qu’il pourrait en être une application. Son idée est plutôt qu’on a assisté à partir des années 80’ à l’explosion d’une sorte de bouquet d’expériences cinématographiques dont la direction principale a été à chaque fois l’éloignement progressif des contraintes et de la logique de la narration, et donc de la signification. C’est toute la contemporanéité de la création cinématographique qui est ainsi parcourue (Andreï Tarkovski, Chantal Akerman, Bruno Dumont, Abbas Kiarostami, Belà Tarr, etc.). Ce point permet de souligner, au passage, toute la portée et l’actualité de la pensée théorique et de l’œuvre filmique de Paul Schrader.