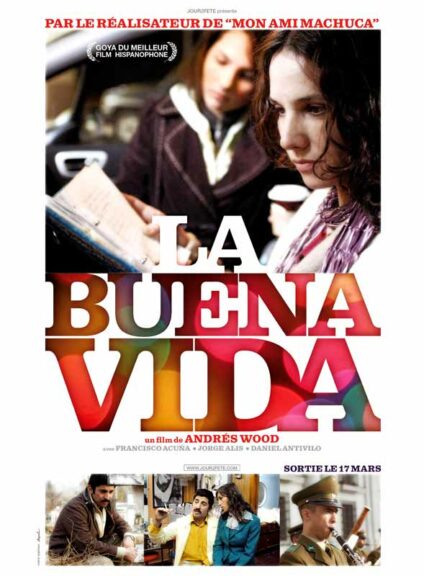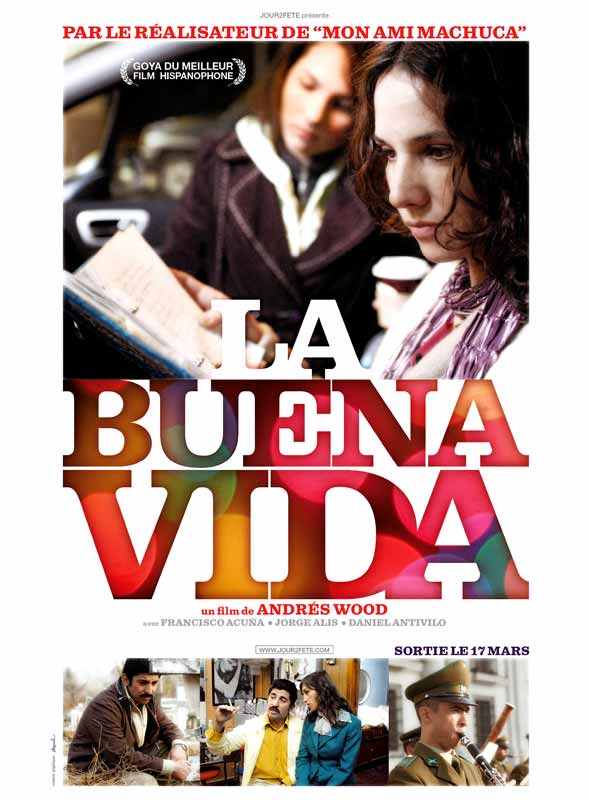
Santiago du Chili, aujourd’hui. Teresa, assistante sociale spécialisée dans la contraception, croit tout contrôler dans sa vie jusqu’au jour où elle apprend que sa fille de 15 ans est enceinte. Edmundo, un coiffeur de 40 ans sans ambition vit encore chez sa mère et veut s’acheter une voiture ou… renouveler le caveau familial. Mario, clarinettiste, postule à l’orchestre philharmonique mais finit dans celui des carabineros. Quant à Patricia, mère d’un jeune bébé, elle se laisse aller à la dérive, emportée par le courant de la vie. Ces habitants se croisent dans la cité en mouvement sans se voir, absorbés par le quotidien de leur propre existence. Des hommes et des femmes que seul le désir d’accomplir leur destin réunit.
La Buena Vida, dés ses premiers plans, dévoile ses intentions narratives: brasser différents destins, différents horizons pour dresser un portrait implacable d’une ville, d’un pays à un instant T. Les différents portraits, en mouvement, se dessinent petit à petit, éclairés sous un angle commun, celui des tracas quotidiens, des difficultés et des blessures. Chaque personnage est ainsi tour à tour dévoilé en action vis à vis de ce qui l’empêche. Les difficultés économiques touchent tout le monde, mais les vies sentimentales, les rapports familiaux se découvrent, et s’entrecroisent. Andres Wood ici choisit la forme chorale, si chère à Altman, mais il y glisse une intention toute personnelle, mélancolique, quoi qu’une énergie vitale se dégage inexorablement. Les personnages évoluent dans des sphères qui leurs sont majoritairement contraires, mais ils restent debout et avancent, s’évadent, s’illusionnent. Une forme de spleen s’instaure inexorablement et nous captive dans ces quelques instants de vérité où des regards pris sur le vif nous renvoient à un universalisme, du côté de l’humanité.