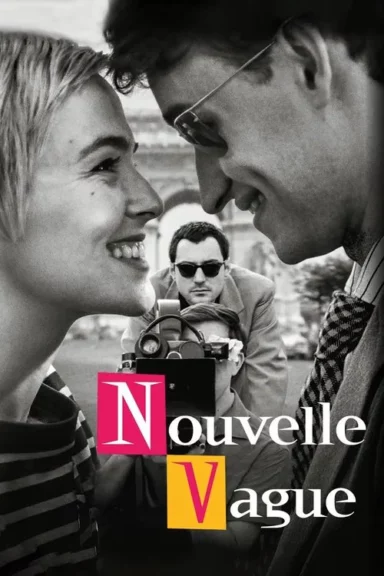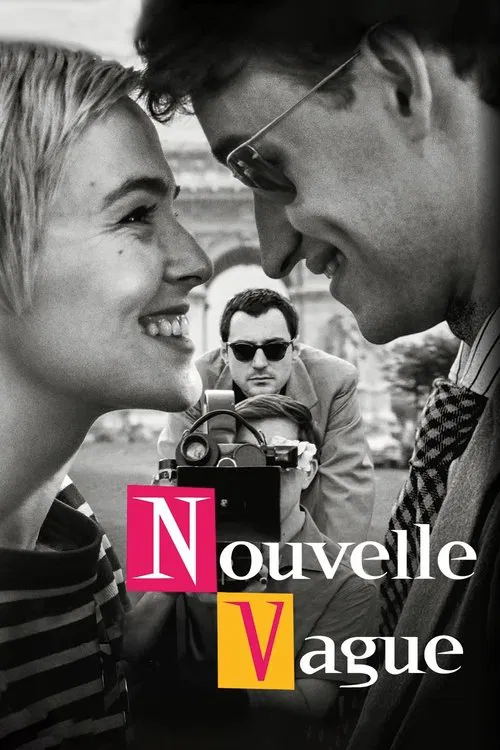
Le projet de Richard Linklater cinéaste prolifique américain, sur La Nouvelle Vague paraissait très ambitieux dès le départ, souhaitant reproduire une période historique (dans un pays « lointain », vis à vis des Etats-Unis) qui remonte plus de 60 ans en arrière, et saisir toute une ambiance, tout un milieu artistique et intellectuel, en redonnant vie aux figures emblématiques de celui-ci à ce moment précis – critiques, cinéastes, amis et compagnons. L’originalité de l’idée tient à ce qu’il ne s’agit pas d’un biopic à proprement parler, en tout cas il ne s’agit pas de la biographie d’une personne (même si le personnage de Jean-Luc Godard occupe la place centrale) mais de celle d’une mouvance. Pari particulièrement risqué; le résultat aurait pu se rapprocher d’une carte postale, étant donné l’implication d’un regard étranger sur un phénomène culturel français, voire quelque chose de snob et fade dans le pire des cas.
Mais le film s’avère précis et juste, bien rythmé (surtout au début), rempli de détails intéressants, convaincants au niveau du scénario, de l’image (en noir et blanc), des décors et des costumes. Plusieurs personnalités célèbres de La Nouvelle Vague sont incarnées par des acteurs avec plus ou moins de réussite, mais le plus grand atout du film de tout évidence se trouve dans le travail de son acteur principal, Guillaume Marbeck, photographe fraîchement devenu acteur: non seulement il propose une belle interprétation et semble crédible dans son rôle (Il suffirait de le comparer avec Louis Garrel dans le pitoyable Le Redoutable), mais aussi sa ressemblance avec le cinéaste défunt (voix, visage, gestes) est tellement évidente qu’on peut le considérer comme le sosie officiel de Jean-Luc Godard (Tout le contraire d’Aubry Dullin dans le rôle de Belmondo). Le deuxième atout important du film est l’équilibre entre le ton sérieux et le ton comique, créé subtilement, au fur et à mesure des situations.
Le film débute très dynamiquement en présentant une par une toutes les personnalités et les acteurs majeurs de La Nouvelle Vague de l’époque, il nous introduit Monsieur Godard et son ambitieux mais déroutant projet, multipliant les traits d’humour, les bonnes idées de mise en scène. Quand le tournage d’A bout de souffle commence à proprement parler, il perd un peu en intensité, s’enlisant quelque peu, du fait du caractère répétitif des scènes, mais aussi des motifs de mise en scène. Au final, Linklater réussit le plus difficile et le plus important, à savoir restituer un portrait juste et charmant d’un jeune critique cinéphile, ambitieux et révolutionnaire dans son approche et son esprit, qui devient d’emblée un grand cinéaste par un coup de force, à y rajouter de petites touches personnelles, et à nous montrer, avec une approche quasi documentaire, les différentes étapes de la fabrication d’un des films piliers de La Nouvelle Vague.